Hommage à Bernard Stiegler | « Panser signifie nuire à la bêtise » et à la lâcheté #6

Bernard Stiegler, philosophe français, dans sa maison à Epineuil-le-Fleuriel (Cher) le 10/07/2017 © Joseph Melin
Bernard Stiegler est mort. Il n’est pas
exagéré de dire que la philosophie (française) en est dévastée. Au sens
propre de ce terme : là où Stiegler se tenait singulièrement, se tient
désormais un vide inouï. Le désert croît, et ne cessera de croître. La
grande séquence philosophique française des années 60, à laquelle
Stiegler, s’il n’y appartenait pas déjà, était le plus ardent héritier,
touche à sa fin. Il faut le regretter. D’autant plus que ce qui se
prépare après sera ni plus ni moins que le règne du quelconque, et de la
bêtise rendue systémique (que Stiegler avait diagnostiqué dans Etats de chocs. Bêtise et savoir au XXI° siècle).
La philosophie n’y échappera pas : elle est déjà pleinement affectée.
Tout le discours sur la mort de la philosophie, sur son incapacité à
forger des propositions d’orientation pour la pensée, la vie ou la
politique ; tout ce qui, en elle, la mésestime, la discrédite – voilà
déjà des mots stieglériens ! –, au profit d’autres disciplines pouvant,
dit-on, la supplanter (comme s’il y avait à opposer l’anthropologie,
l’ethnologie, la sociologie, et la philosophie!), en vertu des nouvelles
modes de la fashion week culturelle (lesquelles ne dureront
pas plus qu’une saison printemps-été) ; tout ce qui, encore, la cantonne
à n’être qu’une spiritualité méditante qui conviendrait à tous les
anxieux de la Terre ; ou pis encore, ce qui, la niant, avec toute
l’ironie et la dérision dont le nihilisme mondain est capable, veut en
faire un instrument d’happening, ou de sémiologie du
dérisoire ; tout cela abêtit la philosophie, et ne la destine à n’être
rien de plus qu’une rubrique journalistique. Si Stiegler laisse dès lors
un paysage dévasté derrière lui, c’est au sens où bientôt ce seront les
falsificateurs (les apôtres de la post-vérité, qu’il critiquait tant!),
les lâches et les crétins (soit ceux qui, n’ayant pas le courage de
penser, découragent ceux qui pensent de penser), qui deviendront les
gardiens de ce continent à la dérive. Que les derniers capitaines
d’espoir (Nancy, Badiou, Rancière, Balibar, Milner…) tiennent bon d’ici
là ! Et que la relève s’assure et s’assume pour éviter le pire !
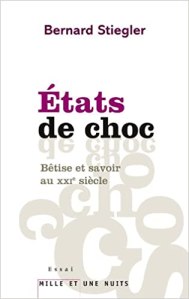
« Etats de choc : Bêtise et savoir au XXIe siècle », Bernard Stiegler (Mille et Une Nuits, 2012)
Avant d’en venir au fond des choses,
j’aimerais dire ce que Stiegler évoquait pour moi – ou pour certains de
ma génération de trentenaires. Et ce qu’il évoquait, avant toute chose,
c’était le courage de la pensée, la vie comme force de
proposition, la ténacité et la persévérance comme mode d’existence. « Je
soutiens que… » : le verbe « soutenir » hantait sa langue et son
écriture ; il se soutenait en soutenant des hypothèses, en cherchant un
arsenal conceptuel pour mener la guerre à son temps de bêtise. Constat :
« face à la catastrophe en cours : – nous sommes gravement désarmés ; –
il est urgent de reconstituer notre arsenal conceptuel »[1].
Tous les pense-petit s’en offusquaient : Stiegler était « trop » – trop
philosophe, trop conceptuel, trop jargonneux ; il était trop aux yeux
de ceux qui ne sont pas assez, c’est-à-dire pas assez digne de la
philosophie, pour savoir qu’elle ne les a pas attendue pour recevoir les
compte-rendus des petits inspecteurs des travaux finis, devenus
inspecteurs pour n’avoir pas les moyens de devenir des investigateurs,
c’est-à-dire des pa/enseurs. Puisque penser n’est pas panser,
pour eux (oh le vilain jeu de mots qui suffit, comme toujours, pour tous
ces impuissants, à discréditer une pensée!), penser, c’est dès lors
déprécier, ironiser, abêtir, rabaisser à leur bassesse ; et donc, tout
sauf penser, mais à la rigueur, ré-fléchir, au sens de faire fléchir
tout ce qui s’élève au-dessus d’eux (soit, à peu près tout). Si ma plume
est si méchante, c’est que ce qui arrivera après la pensée de nos
maîtres, est l’apensée, la destruction de toute pensée, sa privation ou
son impossibilisation par les lâches ricaneurs.
Autrement dit, rien n’arrivera sinon ce que Stiegler annonçait déjà sous le terme d’ « anthropie »[2].
Qu’est-ce que l’anthropie ? Terme forgé sur l’homophonie d’avec
« entropie » (concept de la thermodynamique exprimant la tendance pour
l’énergie de se dégrader et de se disperser), il indique la manière dont
l’humanité – anthropos , « l’homme » – crée une dynamique
destructrice, tant au niveau de l’esprit (destruction de l’attention, de
l’individuation et de la transindividuation, toxicité des dépendances
aux techniques amenant à la dépression), que de l’environnement.
L’anthropie est donc la tendance fondamentale de l’Anthropocène,
entendu, selon la conceptualité stieglerienne, comme Entropocène,
c’est-à-dire période géologique où la technique humaine a dégradé non
seulement nos capacités noétiques (de pensée), mais encore l’habitat de
vie des vivants. Dès lors, la bêtise, dont je parlais, tout à l’heure,
et qui règnera, si elle ne règne pas déjà, en maîtresse sur l’im-monde
qui vient, est conditionnée par l’anthropie de notre époque.
Ce à quoi nous assistons, par conséquent,
c’est à une destruction réglée de la pensée et du monde. Stiegler
n’envisageait pas simplement l’écologie comme relation du vivant à son
milieu naturel, mais également comme « écologie de l’esprit »[3],
relation du vivant humain à son environnement technique. Il n’y a pas à
opposer les écosystèmes de la Nature aux sociétés de culture, puisque
l’écologie qui cherche à préserver les premiers est mise sous condition
de la seconde, en ceci que cette dernière est le lieu ou l’élément de
l’anthropie, et donc de l’Entropocène, lesquels sont la cause de
l’anéantissement de la vie terrestre. Dès lors, si l’anthropie détermine
l’Anthropocène, c’est que l’écologie de l’esprit détermine l’écologie
naturelle. Autre version pour dire : que la régression psychique
humaine, causée par la disruption (le web comme instrument du
consumérisme, etc.), la conduit à se suicider, par cette compulsion
d’achat – la fameuse fièvre acheteuse – congénitale à une pulsion de
mort, pour ceci que ce consumérisme nécessite la dépense d’énergie
inutile et polluante (pétrole pour faire un pull, kérosène pour
l’acheminer de manière aérienne, etc.) déréglant le climat, et par
conséquent, l’équilibre de la vie sur Terre. Il n’y aura donc d’écologie
politique, digne de ce nom, que si l’on commence à panser cette
relation de l’individu à son milieu technique, lieu de toutes les
addictions de consommation, provoquées par le « psychopouvoir » du
numérique ou de la publicité, et pilotant les individus à n’être rien de
plus que des consommateurs, c’est-à-dire de proche en loin, à n’être
rien de moins que les propres destructeurs de leur milieu naturel de vie
et d’existence. Une écologie de l’esprit tendrait ainsi à faire de
l’économie libidinale, conditionnant l’économie politique, non pas une
alliée de l’anthropie, mais une alliée de la néguanthropie, permettant
de mettre un terme, ou à tout le moins, de mettre un coup d’arrêt à la
marche funèbre de l’Entropocène. La néguantropie indique ainsi, chez
Stiegler, l’anthropie négative, soit la capacité positive pour un
individu ou un collectif de s’organiser et de produire une énergie afin
de nous sauver du danger qui croît.

Jacques Derrida chez lui, Ris-Orangis, mars 2004. © Laure Vasconi
Ce qu’il y a d’admirable dans les travaux
de Stiegler, dans son œuvre, c’est qu’il n’a pas simplement été, dans
la droite ligne de Derrida, un grand déconstructeur de la philosophie,
ruinant les oppositions figées et abêtissantes de la tradition, mais
aussi l’archéologue des restes irréductibles restant à penser afin de
panser le monde qui vient. Déconstructeur, il fut donc également
restitueur. En tant que restituer, c’est aussi proposer et non pas
seulement s’opposer ; c’est affirmer, et non pas seulement infirmer.
Partout a-t-il cherché, dans tous les domaines du savoir (la biologie,
la physique, l’informatique, etc.), ce qui était resté en reste à la
philosophie, afin de l’en nourrir, de l’en aviver, de l’en inspirer, de
resituer le débat, de l’innerver jusqu’à son point névralgique, et ce,
en vue d’endiguer la destruction systémique à l’œuvre. Que nous
reste-t-il à penser et à panser ? Qu’est-ce qui demeure en reste à la
pensée pour se dépasser et éviter le désastre ? Ce sont ces questions
qui animèrent, de toujours, Bernard Stiegler, et qui l’amenèrent à
s’aventurer sur tant de terrains sur lesquels les philosophes ne
s’aventuraient pas. Sonder ce qui reste à panser, la restance de la
pensée comme ce qui demeure à inventer pour prendre soin des générations
à venir, était la manière dont Stiegler résistait. Car ce qui reste
résiste et persiste : penser ce qui subsiste en reste à la pensée, comme
son dehors qui pourrait venir l’affecter pour la faire bifurquer (autre
mot de Stiegler), c’était pour lui penser la résistance et panser pour
résister.
Le crétin dira que ce ne sont que des
mots. Je ne les justifierai pas. S’il n’était pas déjà pris dans la
bêtise systémique – soit la haine de la pensée –, cela ne lui
traverserait même pas l’esprit (ou ce qu’il en reste). Aussi pourrait-il
apercevoir – mais pour cela, encore faudrait-il qu’il lise –, que tous
ces concepts ont une nécessité. Chaque concept stieglérien – et Stiegler
était une machine à créer des concepts, ou des idiomes pour répondre,
justement, des et aux problèmes de son temps – s’inscrit dans un système
de pensée où l’anthropie figure le point nodal de celui-ci. Pierre de
touche de tant de concepts stieglériens (disruption, mécroissance,
prolétarisation, consumérisme, addiction, automatisation, misère
symbolique, etc.), l’anthropie lui permettait de diagnostiquer la
maladie époquale du présent, maladie humaine, trop humaine, qu’il
tentait d’inverser ou de réfréner par ce qu’il appelait de toujours : la
pharmacologie positive, thérapeutique alternative au système actuel de
l’économie disruptive et entropique (cette économie, donc, de
l’accélération de l’innovation prenant le pouvoir sur nos esprits, par
tant de procédés de captation de l’attention nous abêtissant – ce qu’on
appelle la gamification ou ludification –, ou d’automatisation nous vidant de nos savoir-faire).

« De la misère symbolique », Bernard Stiegler (Champs-Essais Flammarion, 2013)
Son style – presque un non-style, si l’on
peut dire, nerveux, sec, peu enrobé ni affecté, rugueux et
quasi-austère (son amour de Luther, et de la Réforme protestante s’y
reconnaissait) – figure cette tentative : à lire Stiegler, on constate
qu’en plus d’être un grand lecteur de la tradition philosophique (mais
pas que !, également historique, technique, scientifique, etc.), il est
aussi un lecteur de lui-même. A chaque livre, il branche l’essai qu’il
écrit, et le marque et le souligne, à son système tout entier : il crée
par là des embranchements, des réseaux signifiants, de résistance, comme
autant de résistances électriques cherchant à empêcher la disruption du
système (« mes livres veulent servir des luttes », écrivait-il dans De la misère symbolique) ;
il couple les concepts entre eux, pénètre toujours davantage dans les
boyaux de l’impensé en éclairant cette trouée ou ce frayage par les
flambeaux conceptuels qu’il a laissés dans sa traversée en amont de sa
galerie en forme de galère. L’œuvre de Stiegler est une œuvre de
frayage : un travail monstrueux, nécessitant tant de courage, un travail
de sape et de refondation inouï, qui l’aura aussi emporté (il ne faut
pas se voiler les yeux), même si dans sa mort elle-même, il nous aura
démontré encore une fois tout son courage.
Désormais, il nous faut – c’est un impératif ! – avoir son courage, le courage de sa pensée, soit le courage de panser, le courage de sa parrêsia,
c’est-à-dire de son « franc-parler », de son parler-vrai, de son
éthique de vérité. Le courage était son mot et sa chose, car pour la
pensée, écrivait-il : « (…) le courage est requis. Le courage est ce qui craint un danger sans en avoir peur,
c’est-à-dire : sans chercher à lui échapper, mais en le combattant
comme tel. Ce combat comme tel (…), c’est ce qu’après le 11 septembre
2001 j’ai appelé la pharmacologie. Le courage de cette pensée qui panse
est précisément celui de la parrêsia. »[4]
Qu’importe si des crétins détestent le « il faut », ne sachant pas ce
qu’il y a de fragile et de risqué dans cette injonction – puisque
« falloir » a la même étymologie que « faillir » – ; car pour pouvoir
écrire « il faut », pour pouvoir saisir l’injonction de pensée et
d’action d’une époque, il en faut du courage, et beaucoup de courage,
pour ne pas défaillir devant le poids écrasant de la charge. Ceux qui
soutiennent, sans rien soutenir comme responsabilité (ni comme
orientation de pensée), que la philosophie doit cesser avec ce « il
faut », ceux-là même n’ont pas commencé à penser, et à penser ce que
signifie, au sens de Stiegler : panser[5]. Il nous faut
nous tenir à sa hauteur, c’est-à-dire à la hauteur de l’urgence de
notre époque en détresse, sans nous décourager, afin de nuire à sa
bêtise, en cela que « nuire à la bêtise est d’abord combattre la
lâcheté »[6]. Bernard Stiegler sera, en vue de cette tâche, notre meilleur frère d’armes, notre meilleur allié.
© Valentin Husson
*Le titre est un extrait de Stiegler, Qu’appelle-t-on panser ? 1. L’immense régression, Paris, LLL, 2018, p.311
[1] Stiegler, Etats de chocs. Bêtise et savoir au XXI° siècle, Paris, Mille et une nuits, 2012, p. 58.
[2] Stiegler, Qu’appelle-t-on panser ?, op.cit., p.19.
[3] Stiegler, « L’hyperindustrialisation de la culture et le temps des attrapes–nigauds. Manifeste pour une « écologie de l’esprit » », Art press.
[4] Stiegler, Qu’appelle-t-on panser ?, op.cit., p.7.
[5] En
cela, faudrait-il appeler crétin : toute personne qui, impuissante pour
soutenir toute responsabilité de la pensée, tente de rendre impuissante
toute personne qui essaye d’en endosser la charge et le poids. Le
crétin, non seulement ne peut pas ne pas se signaler comme crétin, mais
ne peut pas ne pas abêtir ceux qui font. Esprit de vengeance :
le crétin abaisse pour n’être point en mesure de s’élever à la hauteur
des responsabilités. D’où sa dérision constante : il lui faut ricaner de
tout pour ne rien avoir à prendre au sérieux. Le crétin est un lâche,
ni plus ni moins.
[6] Stiegler, Qu’appelle-t-on panser ?, p.237. Ce qu’il disait dans De la misère symbolique (p.194) ainsi : « la pensée est plus que jamais ce dont la vertu première est justement le courage. »