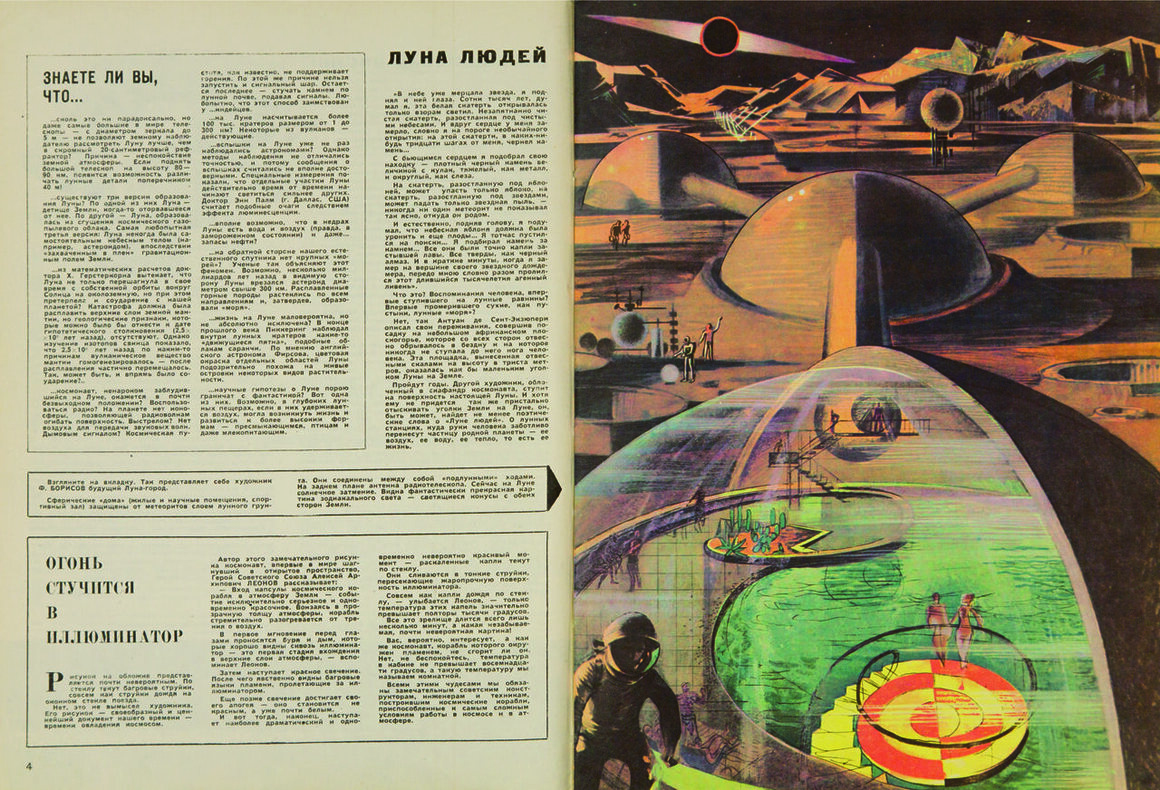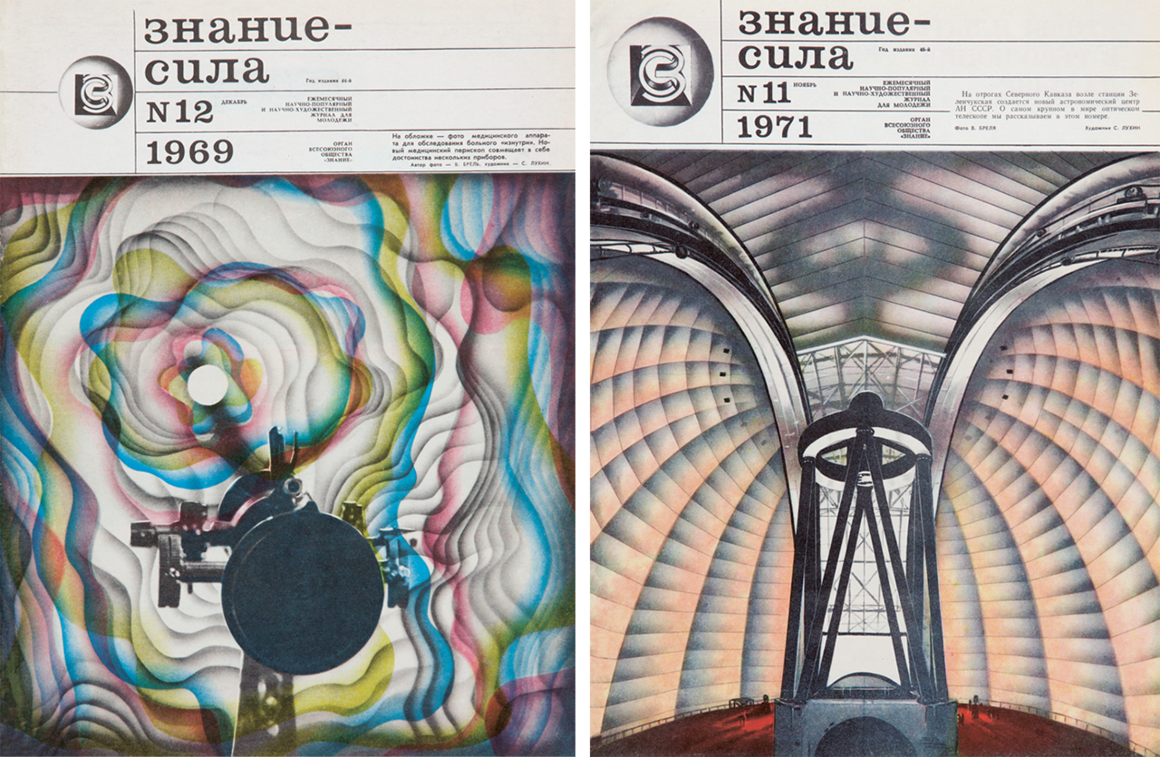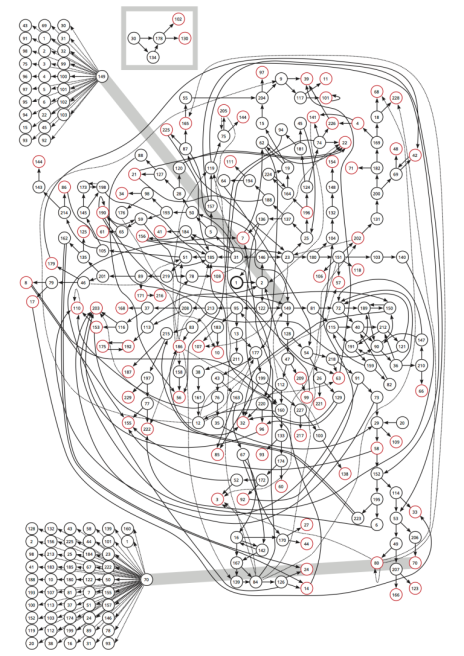Ce qu’on s’amusait ! (1951)
mars 26th, 2021L’enseignement à distance, l’enseignement assisté par des dispositifs électroniques, la disparition du papier, l’apprentissage en autonomie, tout ça sont des idées avec lesquelles on joue depuis bien longtemps mais qui ont gagné une forte actualité pendant toute l’année écoulée, avec la fermeture temporaire des écoles, des universités et des activités parascolaires, événements qui ont rendu banal l’emploi de l’adjectif et même parfois substantif « distanciel » — utilisions-nous seulement ce mot avant 2020 ? J’ai oublié. C’est l’occasion de lire ou de relire une courte nouvelle d’Isaac Asimov sur le sujet, The Fun They Had, qui s’inscrit dans une longue tradition (les premières occurrences que j’ai en tête datent du XIXe siècle) de prédictions consacrées au devenir technologique de l’apprentissage scolaire.

The Fun They Had (1951) a été publié dans un journal pour enfants, Boys and Girls Page, puis amené au public adulte des amateurs de science-fiction dans le recueil Earth is Room Enough — mais pas dans sa traduction française, Espace Vital, ce qui explique sans doute que je n’aie pas gardé souvenir de ce texte bien que j’aie dévoré l’œuvre science-fictionnelle de son auteur pendant mon adolescence. On trouve tout de même ce texte traduit en français sous le titre Ce qu’on s’amusait ! par Roger Durand, notamment dans le numéro 35 de la revue Fiction (1956), et dans le volume Isaac Asimov de la collection anthologique Le livre d’or de la science-fiction.

En 2155, la petite Margie découvre un livre constitué de papier, objet qui l’intrigue, car à l’époque lointaine où elle vivra, si l’on en croit Asimov, la lecture n’existera plus que sur écran. On supposera que l’écran que pouvait s’imaginer le lecteur de l’époque était plutôt un poste de télévision (c’est le mot qu’emploie l’auteur, du reste) qu’un moniteur d’ordinateur, car au moment de la rédaction de la nouvelle, l’interface des ordinateurs, objet que personne n’avait chez soi, était avant tout la carte perforée. Le clavier et l’imprimante ne se sont imposés que progressivement, et quant à l’écran tel que nous l’entendons, il n’a commencé à se généraliser que vingt-cinq ans plus tard. Pourtant la description d’Asimov (des mots qui se déplacent) ne semble pas être celle d’une captation vidéo de livres transmise par télé-vision — au contraire de ce que proposait Vannevar Bush dans son célèbre As we may think1, où les documents à consulter étaient des microfilms, manipulés à distance par des automates, filmés et transmis en direct.
Une belle intuition de la part d’Asimov, donc, qui précède de près de deux décennies ans The mother of all demos2.
Revenons à la description du livre :
On tournait les pages, qui étaient jaunes et craquantes, et il était joliment drôle de lire des mots qui restaient immobiles au lieu de se déplacer comme ils le font maintenant
— sur un écran, comme il est normal. Et puis, quand on revenait à la page précédente, on y retrouvait les mêmes mots que lorsqu’on l’avait lue pour la première fois.
— Sapristi, dit Tommy, quel gaspillage ! Quand on a fini le livre, on le jette et puis c’est tout, je suppose. Il a dû passer des millions de livres sur notre poste de télévision, et il en passera encore bien plus. Et je ne voudrais pas le jeter, le poste.
Le procédé est classique, c’est aussi celui des Lettres Persanes, de Montesquieu : on décrit un objet ou un fait contemporain de l’écriture du texte (ici : le livre) par le regard de quelqu’un qui s’en trouve éloigné culturellement, dans le temps ou dans l’espace3. La fiction confère alors une valeur exotique ou historique au présent, et ce faisant, permet de considérer avec d’autres yeux des notion que nous tenons pour acquises. Puisqu’il s’agit de science-fiction, l’observation étonnée de ce qui constituait le présent des lecteurs se double d’une réflexion prospective sur ce que pourrait être l’éducation du futur. La nouvelle ne fait pas que décrire le livre électronique et le « bureau sans papier » (expression et prédiction qui ne datent que de 1975, soit près de vingt-cinq ans après la nouvelle d’Asimov), elle s’intéresse à l’avenir de l’école. Ici, le professeur est remplacé par un robot, un « maître mécanique », une machine :
(…) avec un grand écran sur lequel les leçons apparaissaient et les questions étaient posées. Et ce n’était pas cela le pire. Ce qu’elle maudissait le plus, c’était la fente par où elle devait introduire ses devoirs du soir et ses compositions. Elle devait les écrire en un code perforé qu’on lui avait fait apprendre quand elle avait six ans et le maître mécanique calculait les points en moins de rien.
On notera un point qui existe toujours dans l’imaginaire collectif : l’idée que les enfants du futur auront été adaptés de manière précoce aux ordinateurs, et même formés à leurs limites : ici, on nous dit que dès six ans on apprend à manipuler le codage de cartes perforées, opération fort laborieuse qui était imposée aux informaticiens jusques aux années 1970. Ici, Asimov n’évoque pas les systèmes de questionnaire à choix multiple où l’on répond en perforant les bonnes cases4, il précise bien qu’il s’agit d’un code à apprendre. Or nous savons que c’est, au contraire, en grande partie les ordinateurs qui ont été adaptés à nous, et c’est même une tendance qui a constamment accompagné la diffusion de l’ordinateur et qui va, aujourd’hui, jusqu’à dissimuler à leurs utilisateurs la nature des dispositifs informatiques qu’ils manipulent. C’est le destin de nombreux objets techniques, du reste.
Aujourd’hui encore, pourtant, de nombreux adultes restent convaincus que la jeunesse qui leur succède dispose de compétences presque innées en programmation informatique ou en hacking — c’est le fameux mythe des digital natives —, alors que les choses ne se passent pas ainsi : si les jeunes générations (comme les autres) acquièrent des compétences particulières liées à leur environnement technologique, c’est au niveau de l’utilisation d’interfaces numériques voire au niveau des règles sociales de leur usage, plutôt qu’au niveau de leur conception5, de leur connaissance théorique ou de leur manipulation savante.
Continuons notre lecture.

Ce que les enfants de 2155 persistent à nommer « école » est une pièce située à côté de leur chambre, où on allume le « maître » cinq jours par semaine. On imagine que dans l’idée de l’auteur (qui ne le décrit pas vraiment), ce « maître » est un gros meuble, avec une fonction unique, n’ayant rien à voir avec nos ordinateurs actuels, machines versatiles qui ne cessent d’acquérir de nouvelles fonctions6. Il fait la leçon, pose des questions et collecte les réponses.
Les enfants du siècle prochain, évidemment, sont particulièrement intrigués par ce que pouvait être un maître d’école du XXe siècle :
— Bien sûr qu’ils avaient un maître, mais ce n’était pas un maître normal. C’était un homme.
— Un homme? Comment un homme pouvait-il faire la classe ?
— Eh bien, il apprenait simplement des choses aux garçons et aux filles et il leur donnait des devoirs à faire à la maison et leur posait des questions.
— Un homme n’est pas assez intelligent pour ça?
— Sûrement que si. Mon père en sait autant que mon maître.
— Pas vrai. Un homme ne peut pas en savoir autant qu’un maître.
Je trouve assez intéressante l’idée formulée par les enfants protagonistes du récit qu’un simple humain ne saurait en savoir suffisamment pour pouvoir enseigner tous les sujets et évaluer les connaissances de ses élèves. Mais il me semble qu’Asimov ne pousse pas jusqu’à proposer une réactivation des théories pédagogiques de Comenius, Jacotot7, Montessori ou Freinet, qui défendaient l’apprentissage comme un processus actif de la part de l’élève, où le maître est plus un accompagnateur qu’une figure d’autorité omnisciente. Il me semble que c’est surtout l’impossibilité de maîtriser un savoir toujours plus étendu qui motive cette réflexion. Du reste, les descriptions des cours (apprendre / restituer) relèvent du traditionnel bourrage de crâne.
L’idée d’un professeur de chair et d’os semble complètement inimaginable à la petite Margie, pour qui le « maître » est une entité qui se trouve sous le même toit que ses élèves.
Tommy se mit à rire aux éclats.
— Ce que tu peux être bête, Margie. Les maîtres ne vivaient pas dans la maison. Ils avaient un bâtiment spécial et tous les enfants y allaient.
— Et tous les enfants apprenaient la même chose?
— Bien sûr, s’ils avaient le même âge.
— Mais maman dit qu’un maître doit être réglé d’après le cerveau de chaque garçon et de chaque fille et qu’il ne doit pas leur apprendre la même chose à tous
Pour terminer, Margie se sent nostalgique de cette époque d’éducation non-technologique qu’elle n’a pas connu, car l’école, ça ne sert pas qu’à apprendre, c’est aussi un espace de vie sociale. Elle en est certaine, les écoliers du XXe siècle devaient s’amuser bien plus qu’elle :
L’écran était allumé et proclamait : «La leçon d’arithmétique d’aujourd’hui concerne l’addition des fractions. Veuillez insérer votre devoir d’hier dans la fente appropriée.»
Margie s’exécuta avec un soupir. Elle pensait aux anciennes écoles qu’il y avait, du temps que le grand-père de son grand-père était encore enfant. Tous les enfants du voisinage arrivaient alors en riant et en criant dans la cour de l’école, s’asseyaient ensemble dans la classe et partaient ensemble pour rentrer chez eux à la fin de la journée. Et comme ils apprenaient les mêmes choses, ils pouvaient s’aider pour faire leurs devoirs du soir et en parler entre eux.Et les maîtres étaient des gens…
Sur l’écran du maître mécanique, on lisait maintenant en lettres lumineuses : « Quand nous additionnons les fractions 1/2 et 1/4…»
Et Margie réfléchissait : comme les enfants devaient aimer l’école au bon vieux temps ! Comme ils devaient la trouver drôle…
Oui, en ce temps-là, ce qu’on s’amusait !

Chacun d’entre nous aura en tout cas eu l’occasion, cette année, de se forger une opinion propre sur ces sujets (apprentissage distanciel, apprentissage en autonomie, cours en ligne, école à la maison, maintien de la vie sociale des élèves…), devenus brusquement l’objet de débats d’opinion et la motivation d’arbitrages politiques.
- Le texte As we may think, publié en 1945, est souvent considéré comme prémonitoire du World Wide Web et plus généralement des interfaces hypertextuelles. [
]
- The mother of all demos (1968) est une célèbre démonstration, par Douglas Engelbart et son équipe, d’une interface informatique permettant de manipuler des documents sur un écran à l’aide d’une « souris », de travailler de manière hypertexte et collaborative, d’échanger en visioconférence, etc. [
]
- En science-fiction, un modèle précoce du genre est Un regard en arrière (Looking backward, 1888), par Edward Bellamy, utopie socialiste (quoique l’auteur évite le mot, qu’il remplace par « nationaliste », ce qui produit un contresens pour les lecteurs actuels) où un homme du XIXe siècle découvre un futur pacifié et prospère. Les gens de l’an 2000, où il s’est réveillé après plus d’un siècle de léthargie, sont curieux de se faire raconter les injustices de l’époque de la Révolution industrielle, car ils en connaissent l’Histoire, mais la mentalité capitaliste est à ce point éloignée de leur manière de penser qu’ils sont friands de ce qu’un témoin direct peut leur apprendre.
Ce livre étonnant a été un des best-sellers étasuniens de la fin du XIXe siècle, aux côtés de Ben Hur ou de la Case de l’oncle Tom, et il a été traité comme un ouvrage politique, suscitant même un large mouvement de réflexion politique, les Bellamy clubs. []
- Inventées pour le tissage mécanique au XVIIIe siècle, inspirant les prémices de l’ordinateur par Charles Babbage, les cartes perforées ont été utilisées pour traiter le recensement de 1890 aux États-Unis, faisant naître la société à présent nommée IBM. Si les cartes perforées ne sont plus employées en informatique, elles servaient encore pour des machines à voter lors de la première élection de George Bush Jr., en 2000. [
]
- Le mythe qui affirme que l’enfant du futur manipulera avec naturel des notions (scientifiques, technologiques) complexes ne date pas de l’informatique moderne, puisqu’en 1896, Albert Robida imaginait que les enfants du XXe siècle recevraient comme cadeaux de Noël des livres de mathématiques et des instruments scientifiques — l’un et l’autre se peuvent, mais ne constituent pas vraiment une règle. [
]
- Au passage, je remarque qu’aujourd’hui encore, beaucoup de gens continuent à imaginer que le futur des objets est la spécialisation, avec un appareil par fonction. Mais l’ordinateur personnel, et plus encore ses avatars mobiles, les smartphones et les tablettes, s’orientent au contraire vers une accumulation constante de nouvelles fonctions. [
]
- cf. Le maître ignorant, par Jacques Rancière [
]