Utopie et désenchantement chez Claudio Magris

« La Tour de Babel », Pieter Bruegel (vers 1563, huile sur panneau de bois de chêne
Dans Utopia e disincanto, 1999, Claudio Magris s’oppose au chaos catastrophiste, soutenu par la collapsologie radicale. Le Dialogue du passant et du marchand d’almanachs, de Giacomo Leopardi, lui sert de paradigme.
Pour Leopardi, personne ne souhaite revivre son passé exactement comme il a eu lieu. Non seulement nous ne souhaitons pas revivre la vie passée à l’identique, mais même lorsque l’année recommence, nous souhaitons qu’elle soit différente de celle qui vient de s’écouler. Cela signifie que le destin, jusqu’au jour où nous sommes, nous a mal traités, selon l’opinion générale. Le mal dans le passé l’emporte sur le bien. Ainsi, personne ne consentirait à renaître pour refaire le même chemin. De plus, une vie identique, vécue deux fois, n’offrirait plus de curiosité.
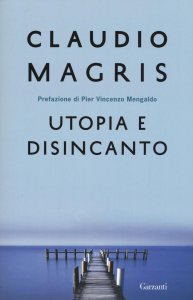
« Utopia e disincanto. Saggi 1974-1998 », Claudio Magris (Gazzardi, 2016)
Nous sommes ici aux antipodes de l’idéal nietzschéen, celui du surhomme, qui est prêt à revivre ce qu’il a vécu, dans le détail et à l’infini, dans le caractère affirmatif de la vie. « Agis toujours de telle sorte, que tu acceptes l’éternel retour de tes actes » : il s’agit ici d’une acceptation inconditionnelle de la vie.
Mais en attendant, loin de l’idéal du surhomme de Nietzsche, il faut vivre et dès que l’on a choisi de vivre, il faut faire son possible pour s’en accommoder. Loin de se complaire dans la souffrance, la désespérance, nous pouvons trouver des raisons à cette complaisance, mais continuons à vivre pour autant. Ainsi, le pessimisme radical tout comme l’optimisme béat ne sont pas recevables, Héraclite (philosophe du devenir) et Démocrite (philosophe de l’être) doivent être surmontés. Si ce dialogue de Léopardi nous met en garde contre l’attente d’une année meilleure, il reste porteur d’un amour, certes timide, pour la vie, associé à une discrète attente du bonheur.
Au tournant du siècle et du millénaire, une inflation démesurée de commémorations et d’anniversaires a eu lieu. Peut-on encore raisonnablement célébrer l’arc de Triomphe du Temps, la mise en scène du progrès ou au contraire sa caducité ? La crainte apocalyptique de la fin du monde, au seuil de l’An 2000, s’est vue entretenue par les discours annonçant l’effondrement inéluctable.
La transformation inexorable de l’humanité ne va-t-elle pas permettre l’apparition d’un homme nouveau, associé à son auto-dépassement ? En attendant, le nihilisme domine. Claudio Magris établit alors un parallèle entre le nihilisme nietzschéen et celui de Dostoïevski. « L’homme du souterrain » n’est pas sans évoquer « le dernier homme » de Nietzsche (Der letzte Mensch).
Dans les Carnets du sous-sol, Dostoïevski expose le journal d’un narrateur amer, isolé. Il est rempli de haine, de ressentiment, malade et ne se soigne pas par méchanceté envers lui-même. Il se complaît dans sa déchéance et éprouve même une certaine volupté dans la souffrance. Nous pouvons y voir une expression de la philosophie de Schopenhauer au sens de Nietzsche, une volonté de négation de la vie, ou une volonté de néantisation de sa propre existence. Le nihilisme se décline ici comme dévaluation de toutes les valeurs, perte irrémédiable du sens, poussée jusqu’à l’absurde ressentiment dans la culpabilité de l’ascète, selon la Généalogie de la morale. Nietzsche fit d’ailleurs la connaissance de Dostoïevski par les Carnets du sous-sol en février 1887 à Nice. Il confie alors à Franz Overbeck que « l’affinité instinctive a parlé tout de suite ; ma joie a été extraordinaire ». Dostoïevski, explorateur du nihilisme, en opposition à Pascal, souligne que le moi contient en lui-même la mort et le désir de sa propre destruction, mais il ne se résout pas pour autant, à l’instar de Nietzsche, au caractère inexorable du nihilisme. Alors que Nietzche en appelle à une nouvelle « Aurore », l’adhésion à de nouvelles valeurs, qui ne sont plus des valeurs de mort mais des valeurs de vie, Dostoïevski évoque ouvertement sa foi, sa conversion totale au Christianisme, veut favoriser le retour à la pensée mystique du Dieu-homme.
Certes, Dostoïevski est d’autant plus clairvoyant qu’il voit le mal partout, cet irréductible qui dissout l’idéalisme optimiste. Mais Claudio Magris ne peut se résoudre à réduire l’histoire, et le XXème siècle en particulier, à une suite d’hécatombes et d’exterminations. Le XXème siècle a apporté ses indéniables progrès, d’une part matériels et d’autre part l’extension des droits à des catégories jusqu’à lors ignorées ou mises à l’écart. Autant on ne peut plus croire au progrès aveuglément, à l’instar des positivistes du XIXème siècle, autant on ne peut se résigner à l’idéalisation d’un passé révolu ou au catastrophisme ambiant.

Claudio Magris (2009)
Si les brumes du futur renforcent notre regard myope, celui-ci doit toutefois être corrigé par humilité et ironie. Nous mettant en garde contre une prétendue fin de l’histoire, soit-disant opérée en 1989 avec la chute du mur de Berlin, les événements constituent un enchevêtrement inachevé ou intrication de régressions et d’émancipations, comme les deux côtés d’une médaille. Au niveau européen, la contradiction opère aussi entre des forces centripètes et centrifuges, l’unification s’accompagne de revendications particularistes, régionalistes. Si le nouveau millénaire a suivi la défaite de nombreux totalitarismes, la survenue d’un totalitarisme « soft et gélatineux » est toujours possible. Claudio Magris s’inscrit ici dans la lignée de Tocqueville. Au totalitarisme fondé sur des idéologies fortes, risque de succéder un totalitarisme mou, promu par le pouvoir des moyens de communication.
Chez Tocqueville, la démocratie, conduisant à un nivellement des conditions, peut générer la médiocrité de l’homme, replié sur sa vie privée et finalement soumis à un Etat-providence par rapport auquel il a perdu toute autonomie. La médiocrité se traduit ici par une recherche de petits plaisirs dont chacun remplit son âme. Ici, l’Etat tutélaire aime que les citoyens se réjouissent pourvu qu’ils ne pensent qu’à se réjouir. Tocqueville propose par conséquent le développement d’un quatrième pouvoir, celui de la presse.
Afin de résister à ce totalitarisme, Claudio Magris souligne l’importance de défendre la mémoire historique et refuse le faux réalisme qui absolutise le présent et ne le croit plus susceptible de mutation ; ceux qui estiment possible de changer le monde étant alors stigmatisés et traités d’utopistes naïfs. Si la chute du communisme a entraîné la fin du mythe de la Révolution et du Grand Soir, les idéaux de justice perdurent, bien que libérés de l’idolâtrie. Autrement dit, les utopies révolutionnaires sont un levain, insuffisant à lui-seul pour faire le pain, mais utile. Claudio Magris s’inscrit ici en faux contre l’adage selon lequel l’enfer serait pavé de bonnes intentions. Si le monde ne peut être sauvé dans l’absolu, l’humanité doit accéder à la maturité ; en couplant à la fois la nécessité de l’utopie et du désenchantement. L’utopie implique de ne pas se résigner et se soumettre aux choses telles qu’elles sont. Chaque génération, tel Sisyphe, doit pousser son rocher pour éviter qu’il ne lui tombe dessus. L’utopie, c’est aussi ne pas oublier les victimes anonymes, absentes de l’Histoire Universelle. Ecrire, c’est en ce sens marcher le long du fleuve (Danube), remonter son cours, en extraire les existences naufragées, retrouver les épaves et les embarquer sur une arche de Noé en papier.
La volonté de redonner vie aux oubliés se retrouve aussi dans la philosophie de l’histoire de Walter Benjamin et de Simone Weil. Dans L’enracinement, la philosophe souligne que les vaincus échappent à l’attention de l’histoire. Ils disparaissent, sont néant, dans un processus darwinien le plus impitoyable qui soit. Dans le même sens, Walter Benjamin affirme dans sa 7ème thèse de sa philosophie de l’histoire que « tous ceux qui ont remporté la victoire participent à un cortège triomphal où les maîtres … marchent sur les corps des vaincus d’aujourd’hui ».
Cependant, l’utopie est dangereuse lorsqu’elle est déconnectée du réel. Don Quichotte a besoin de Sancho Pança. Utopie et désenchantement doivent se corriger mutuellement. Le salut qui n’a pas été assuré par les utopies doit encore être cherché, mais avec plus de patience et de modestie. Les idéaux de solidarité et de justice ne peuvent pas être annihilés par le désenchantement. Le désenchantement, c’est la conscience qu’il n’y aura pas de parousie (seconde venue du Christ sur la Terre, dans sa gloire) ou de venue du Paraclet, expression de l’Esprit Saint, comme défenseur, intercesseur et consolateur, or l’esprit consolateur se fait toujours attendre, mais ce désenchantement du monde, si bien décrit par Max Weber (Entzauberung der Welt) ne peut coïncider avec la fin de l’histoire. En effet, si le désenchantement corrige l’utopie, il n’en renforce pas moins son élément fondamental : l’espérance. A la fin du XVIème siècle, le mouvement baroque, accompagnant la crise de l’empire espagnol, les guerres, la paupérisation et les conflits religieux, se distingue par son pessimisme, en opposition à la pensée de la Renaissance. L’homme est alors plongé dans le disengaño, perte d’illusions, suivie d’une prise de conscience de la vanité humaine. Il s’agit ici de prendre ses distances avec un monde trompeur, exprimé dans le roman picaresque (le picaro), gueux à l’origine, s’opposant au héros chevaleresque. Claudio Magris ne peut se résoudre à cette désillusion radicale, mais revendique au contraire l’esprit messianique, enfoui au fond des ténèbres. L’esprit messianique, synonyme d’espérance, perdure par- delà les malédictions qui se sont répandues, générant le désenchantement, à l’image du mythe de Pandore.
L’espérance, vertu théologale, se distingue de l’espoir, vertu immanente, terrestre. L’espérance a l’avantage de nous dire non seulement comment les choses sont, mais aussi comment elles devraient être. Si l’histoire est le lieu du désenchantement prosaïque, la fonction de la poésie semble être celle du « réenchantement » ou de l’utopie. L’ironie de Cervantès, démasquant la chevalerie, a produit l’enchantement de la poésie de la chevalerie. Claudio Magris est ici l’héritier d’Aristote pour lequel la poésie vaut plus que l’histoire. Alors que l’histoire nous décrit la réalité plutôt telle qu’elle est, la poésie, source de rêve et d’utopie, nous décrirait la réalité telle qu’elle pourrait être. Bref, elle élargit le champ des possibles, en ce sens, la poésie est plus philosophique que l’histoire.

Portrait de Dostoievski, Vassili Perov (huile sur toile, 1872)
Cet esprit de l’utopie, revendiqué par Ernst Bloch, insiste sur les potentialités enfouies derrière le réel, potentialités demandant à être libérées. Ecrit d’avril 1915 à mai 1917, l’esprit de l’utopie est porté par le mouvement de la révolte et de l’espérance. La musique lui paraît être alors la voie principale de cette révolte. A nous de déchiffrer des signes tangibles, des traces d’utopies concrètes, en renouant avec la tradition millénariste. Cet esprit de l’utopie hante encore l’histoire contemporaine comme spectre, associé selon Ernst Bloch au principe espérance (Prinzip Hoffnung).
Finalement, pour Claudio Magris, « le désenchantement est une forme ironique, mélancolique et aguerrie de l’existence ».
Dans l’esprit de l’utopie contemporaine, Aymeric Caron tente de redonner vitalité à l’Utopie de Thomas More dans Utopia XXI, 2017, alors que Michel Maffesoli en appelait à un réenchantement du monde en 2007. Aymeric Caron oppose l’utopie au néolibéralisme dominant, identifié de nouveau à un totalitarisme soft, notre système actuel provoquant l’anesthésie des citoyens, leur servitude, en échange de plaisirs et de tranquillité minimale.
Force est de constater cependant que le principe de responsabilité, au sens de Hans Jonas, semble l’emporter sur le principe espérance, dans un monde confronté à de multiples défis, à l’urgence climatique, démographique, ou sanitaire. Cette urgence s’exprime comme impératif suivant : « Agis de telle sorte que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d’une vie authentiquement humaine sur terre ».
La mort de l’idéologie du progrès ne fait-elle pas de nous des orphelins des Lumières, vides et angoissés ?
Telle est la question posée par un article de Sylvain Besson dans le journal suisse Le Temps publié le 27 décembre 2018. Les deux périls essentiels qui guettent sont les conséquences du réchauffement climatique, pointé par Pablo Servigne et l’intelligence artificielle. Pour Pablo Servigne, nous sommes entrés dans l’âge des menaces, l’effondrement pouvant se produire autour de 2030. Le réchauffement climatique accéléré, la prolifération du plastique dans les océans, la disparition de certaines espèces dont les insectes pollinisateurs, et la récente actualité (les feux en Méditerranée) corroborent l’hypothèse d’une apocalypse imminente. En cas de réchauffement global de 4 degrés, certaines régions du globe pourraient devenir inhabitables, y compris en France. Ces arguments plaident en faveur de la collapsologie. La menace de l’intelligence artificelle, quant à elle , semble plus théorique. Les robots consacreraient l’obsolescence de l’homme. L’idéologie transhumaniste joue sur le même registre.
Etienne Klein, dans Sauvons le progrès, et Yuval Noah Harari, dans Homo Deus et dans 21 leçons pour le 21ème siècle, dénoncent l’absence de vision pour 2050. Etienne Klein insiste sur les difficultés de compréhension des implications du Big Data, de l’intelligence artificielle ou de l’ubérisation. Des scientifiques renoncent même à l’idée de progrès et le futur envisagé n’est plus attractif. Les dystopies écologiques ou technologiques s’ajoutent au désenchantement radical envers le libéralisme.
Avec l’obscurcissement de l’idée de progrès, nous aurions perdu notre boussole. L’hypothèse de l’effondrement radical est toutefois paralysante et alors il n’y aurait plus de raisons d’agir. Or, la politique est l’anti-destin, ce qui implique de ne pas céder à la fatalité mais au contraire d’ouvrir l’horizon des possibles, de l’action et du mouvement ; tel est aussi l’esprit de l’utopie qui ne peut pas se contenter du désenchantement radical. Sans pour autant nier l’ampleur du changement que l’homme inflige à la terre – l’anthropocène – , il nous faut réinventer notre rapport à la nature sans retourner à l’état de nature, mais plutôt en changeant la voie du progrès qui ne peut plus être considérée comme linéaire ou illimitée. Sans régresser, nous pourrions peut-être rétrogresser ou encore changer la voie du progrès, à travers des expérimentations alternatives s’inscrivant dans la durabilité ou soutenabilité. Ainsi, le futur doit demeurer un objet de pensée collective au-delà du catastrophisme.
© Philippe Fleury