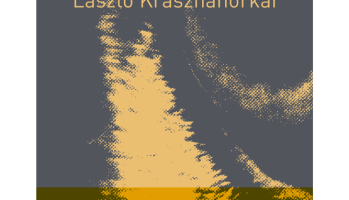Au nord par une montagne, au sud par un lac, à l’ouest par des chemins, à l’est par un cours d’eau Laszlo Krasznahorkai

Errance en quête d’un jardin préservé, inventé dans sa perfection, à la poursuite de ce qui n’aura lieu qu’une fois, d’un sacré que Laszlo Krasznahorkai décrit dans son abandon, dans la matérialité aussi de ses divinités détournées. Livre immense où sans cesse la matière s’anime, où le sens se dérobe et se retient entre panique et déréliction, Au nord par une montagne, au sud par un lac, à l’ouest par des chemins, à l’est par un cours d’eau sous ses allures de contes japonais est un récit de l’apparition de l’image.
Sauf erreur de ma part, c’est le seul livre de Krasznahorkai qui me restait à lire (hors Sous le coup de la grâce, un recueil de nouvelles que j’avais laissé inachevé et dont je vous parle bientôt). L’illumination, une fois de plus, inquiète, fonctionne totalement. Avant d’évoquer les manières dont l’auteur dépasse son sujet, le fait résonner et le laisse interpréter par son lecteur, il faut souligner son attention à la matérialité de son récit, à son érudition si flamboyante qu’elle en devient fantaisiste. Dans ce livre, traduit en français en 2010 et publié pour la première fois, on retrouve le tropisme japonais cher à l’auteur si bien mis en œuvre dans Seiobo est descendue sur terre. Ici aussi, en termes souvent techniques mais dont l’étrange poésie est toujours préservée, il s’agit d’assister à la naissance de quelque-chose, toujours au surgissement de ce qui trop nous dépasse pour être acceptable, pour n’être pas fui. Qu’il parle du choix d’un arbre, la lente maturation de sa pousse, pour construire un temple ou des différentes techniques de pliages du papier pour un livre sacré à conserver dans un temple, Au nord par une montagne,… montre une très renseignée et sensible fascination pour ce qui perdure, ce qui reste mais toujours dans une forme d’abandon, à l’écart de toute dévotion. Il ne s’agit pas pour Krasznahorkai de vanter une tradition perdue, un savoir-faire envolé, la proverbiale décadence de notre époque. Lui se concentre sur les signes, les moments de bascule où cette patience millénaire surgit pour nous indiquer quelque-chose, mais quoi ?
un signal l’exhortant à quitter le sordide de l’existence humaine pour devenir le sujet privilégié de questionnements où l’homme ne serait plus jamais évoqué.
On doit le dire, la très grande matérialité de ce roman devient alors une façon d’expulser l’humain, de construire un récit où les vents, un chien qui meurt, la perfection d’un jardin sont les protagonistes non d’une action mais ce drame qui passe sans que personne n’en soit conscient, cette sorte de manquement, d’illumination toujours non pas ratée mais repoussée. Assumer que ce qui passe une fois ne revient plus et que, comme pour les vents, il est radicalement impossible de dire de ces moments de sacrés, d’épreuves de l’insuffisance de notre humanité, ils sont là « car leur existence s’était écoulée sur un mode exclusivement indirect, fantomatique, réels mais inaccessibles, présents mais insaisissables, ils incarnaient l’existence mais en étaient exclus, étaient si proches de l’existence qu’ils se confondaient avec elle, oui mais l’existence n’est jamais visible ». Désolé pour la longueur de la citation, il est pratiquement impossible de couper la perfection des phrases de Krasznahorkai, de rompre avec l’enchantement qui nous porte sur leur longueur en agitant leur contradiction et leur réserve. Au nord par une montagne… est un roman où l’existence sera captée toujours dans un regard détourné. Comme à son habitude, comme dans Le dernier loup pour ne donner qu’un exemple, Krasznahorakai excelle à dessiner des paysages désertés, pleins de peurs et d’une absence en tout point signifiante. Ici le petit-fils du prince Genji (peut-on y voir une allusion au Dit du Genji, sans doute un des plus anciens romans existants ?) erre dans une ville japonaise, à l’extérieur de Kyôto, on comprend que cet être fantomatique est touché par une « forme hystérique d’attraction compulsive » pour la recherche d’un jardin de rêve ou simplement d’un rien de secours. Bien sûr, il ne sera à rien, à une pauvre cabane près, d’une découverte possiblement révélatrice. Tous les personnages de cet immense romancier en sont là, au seuil d’une révélation, dans une fuite qui souvent nous révèle la pénible hallucination que sont nos vies. Le roman évoque alors un bouddha au retour détourné, une incarnation possible de la vision de Krasznarhorkai :
ce visage tourné de côté évoquait de façon manifeste l’irrémédiable histoire de l’infamie, ce visage tourné de côté parlerait à jamais de la beauté, de la noblesse impuissante, de l’incorrigible méchanceté, de l’irréductible vulgarité, de la hauteur d’esprit que la simple présence humaine réduisait en poussière, de l’inextricable bêtise et de la compassion infinie
Sans doute est-ce l’objet de toute littérature. Surtout quand elle sait bifurquer vers autre chose. Au nord par une montagne… évoque ensuite la possibilité de l’infini. On retrouve d’ailleurs ici l’humour ravageur de l’auteur. Au lieu de trouver un jardin qui incarnerait la perfection, le petit-fils du prince Genji trouve un livre où, entre imprécations et constructions mentales baroques où tout l’univers de Krasznahorkai se reconnaît, l’auteur passablement fou veut prouver, à l’aide d’une suite de nombre, l’inexistence de l’infini. On peut se demander si ce n’est pas la seule façon – comme pour la divinité, le sacré ou la transcendance – d’en préserver non la possibilité mais la sourde inquiétude. Ou peut-être faut-il simplement se laisser porter par la longue perfection de cette prose envoûtante.