Le secret comme condition de la création : la chambre à soi de Virginia Woolf

Virginia Woolf assise dans un fauteuil à la Monk’s House (début des années 1940, Harvard University Library)
Ce texte n’aborde pas frontalement la question du secret en matière politique, mais opère de manière plus indirecte, en insérant le problème du rapport secret/politique dans le cadre d’une interrogation plus large sur les conditions de la création artistique et son lien avec le mouvement d’émancipation des femmes, particulièrement au début du vingtième siècle. Son objet est de faire ressortir ce qui s’est joué d’essentiel autour de la revendication par les femmes d’un droit au secret, à travers le désir d’avoir à sa disposition un espace séparé des contraintes de la vie domestique et conjugale, explicité par l’écrivaine anglaise Virginia Woolf en termes de « chambre à soi »[1]. Ce mouvement d’appropriation d’un espace pour soi ne doit pas se comprendre comme l’expression d’une recherche d’intimité déconnectée de la sphère sociale et politique, mais en tant que possibilité d’une dimension de retrait où les femmes peuvent cultiver, au même titre que les hommes, leurs dispositions créatrices en matière artistique, particulièrement sur le plan de l’écriture. Il s’agit donc de penser la mise à l’écart, la séparation, l’opacité impliquées par le secret, non comme ce lieu où rien d’important ne se joue en termes publics, mais comme un espace réservé à vocation cependant publique, une dimension protégée des regards extérieurs, par où celle qui aspire à devenir écrivaine conquiert, à l’abri des sollicitations émanant de l’univers domestique, les moyens pour créer une œuvre littéraire qui sollicite la reconnaissance des lecteurs.
Bref, sans isolement, sans espace séparé, pas de création possible, pas d’œuvre littéraire reconnue à titre public : car c’est d’abord à condition de pouvoir vivre sereinement sans être surveillé ses moments de solitude que l’individu peut s’insérer dans le monde public, pour y participer et chercher à le transformer en un sens créatif. Loin d’être un handicap rédhibitoire pour qui veut se situer avec vérité au sein du monde public, la part assumée de secret constitue donc la condition de possibilité d’une activité qui produit des effets visibles et donc échappent en définitive à l’ordre du strict secret. En ce sens, le secret ne doit pas être pensé pour lui-même, comme s’il était absolument séparé du domaine du visible mais doit être au contraire interrogé dans son lien avec ce qu’il prépare, ce qu’il conditionne et rend possible. C’est pourquoi il y a dans « le microcosme de la chambre », pour reprendre la formule employée par l’historienne Michelle Perrot[2], une dimension intrinsèquement politique. Il y aurait, selon elle, à écrire, en référence à Michel Foucault, une histoire politique des espaces[3]. D’où l’intérêt, dans ces conditions, de penser cet espace clos qu’est la chambre, rempart contre les intrusions aussi bien que refuge protecteur[4], ce lieu propice à la jouissance et à la garde des secrets, à travers précisément les liens que tissent monde privé et monde public.
Une hétérotopie créatrice
Si la chambre constitue donc un refuge (comme tout espace à dimension privative), elle ne doit pas se réduire à cette caractéristique « négative ». Elle est aussi le lieu d’une possible subjectivation nouvelle, l’occasion d’expérimenter des formes originales à l’écart du monde domestique et du formatage qu’il impose aux femmes, dans le but d’investir le monde public de significations neuves et ainsi le transformer. En ce sens, il constitue ce que Foucault nomme une « hétérotopie[5] » – c’est-à-dire un lieu dessiné dans l’institution même de la société, ou si l’on préfère, un contre-emplacement à partir duquel sont contestés et inversés tous les espaces habituels que l’on fréquente au quotidien[6]. Une chambre à soi, séparée du reste de la maisonnée, fermée quant il le faut, interroge la hiérarchie instituée qui organise l’espace domestique : si une femme doit être protégée, c’est d’abord du contrôle familial sur ses occupations et sur son temps libre, pour pouvoir s’adonner à une activité artistique réclamant un certain isolement. Il ne s’agit pas pour elle d’être la victime d’un geste d’exclusion mais de revendiquer un droit à la solitude créatrice.

Michelle Perrot (Photo Vincent Muller. Opale. Leemage, septembre 2018)
Du coup, il semble nécessaire d’articuler un questionnement sur l’espace privé et un questionnement sur l’espace public, en montrant en quoi une expérience secrète n’est pas séparable d’une épreuve de soi en lien avec un univers de significations publiques. Ceci d’ailleurs, pour des raisons qui ne sont pas simplement philosophiques mais tiennent également à l’histoire : selon Michelle Perrot, le privé est devenu aujourd’hui une expérience historique, « l’expérience de notre temps »[7], qui ne peut se concevoir sans référence à des transformations sociales et politiques de grande ampleur. En-deçà de la grande histoire, celle des États, des économies et des sociétés, existe en effet un espace, celui de la « vie privée », qui a gagné au vingtième siècle, et notamment dans sa seconde moitié, sa pleine et entière légitimité. La vie privée ne peut donc plus être considérée à l’heure actuelle comme « une zone maudite, interdite et obscure », car elle tend à devenir en quelque sorte le centre de notre vie[8]. D’après Michelle Perrot, cette mise en avant de la thématique de l’intime et la centralité désormais reconnue à la sphère privée, s’expliquerait pour des motifs explicitement politiques : la primauté accordée à la vie privée serait née d’un fort mouvement de résistance des individus confrontés au cours du vingtième siècle à la domination bureaucratique et totalitaire. Ceci leur permettant de tenir à distance un pouvoir omniprésent et cherchant à s’immiscer dans toutes les sphères de l’existence[9]. Par conséquent, la plongée vers la vie privée en général, et l’intime en particulier, peut se comprendre comme le point d’aboutissement d’un mouvement historique et social d’individuation et de privatisation, repéré et analysé par le sociologue Norbert Élias, par où l’individu prend conscience de son intimité, la revendication d’une sphère de l’intime préservée des regards et du jugement social allant de pair avec la naissance du sentiment de pudeur[10].
Il ne faut pas cependant se méprendre sur cette idée d’une centralité désormais reconnue à la vie privée. En effet, dire que les thématiques de l’intimité personnelle, d’un droit au respect de la vie privée, et donc de son caractère secret, ont pris une importance considérable dans le monde moderne ne revient nullement à affirmer que l’espace public et le domaine de la politique seraient devenus des sphères secondaires, l’essentiel se jouant désormais dans le privé. On peut tout aussi bien, à l’inverse, faire avec Michael Foessel l’hypothèse que l’intime constitue le soubassement originaire portant l’ensemble des expériences faites par l’homme en tant qu’être socialisé[11]. S’il y a donc bel et bien un mouvement de tension entre le pôle de l’intériorité la plus secrète et celui du public, cette tension ne doit pas s’entendre au sens d’une opposition entre des exigences étroitement et strictement individualistes et le nécessaire oubli de soi dans la sphère politique. Il y a au contraire un lien indissoluble entre les deux domaines, au sens où la politique doit notamment, d’après Foessel, garantir la possibilité institutionnelle d’un espace secret à l’abri du social et de son jugement normatif[12]. Ce n’est selon lui que dans la seule mesure où la politique fournit à chacun les conditions d’une libre expression de soi que le sujet peut parvenir à une élaboration de soi originale et créatrice. Si l’intime est un affect relativement moderne, et qu’il n’a donc pas toujours existé, cela ne tient pas seulement à une défaillance dans l’ordre de l’individuation, au sens où pendant des siècles les sujets auraient été intégralement imprégnés par le conformisme ambiant, mais également à un phénomène politique : revendiquer des droits concernant son intimité revient à exiger des institutions politiques qu’elles rendent légitime la possibilité d’un espace secret, préservé des regards extérieurs, donnant au sujet la possibilité de créer quelque chose de lui qui, en vertu précisément de son originalité, peut-être en mesure d’intéresser un public. Et ce qui vaut concernant sa subjectivité propre vaut pour les œuvres littéraires que cette subjectivité est susceptible de créer, à mesure de son talent et de son ambition.
La conquête féminine de l’intime contre l’intimité du foyer familial
Cette conquête de l’intimité contre la normativité des mœurs et le contrôle social, qui a impliqué la revendication d’un droit au secret, doit se comprendre dans le cas des femmes comme le point d’aboutissement d’un mouvement de contestation du statut traditionnel dévolu au féminin. Ainsi, lorsque les femmes ont souhaité affirmer leur personnalité hors du cadre étouffant que représentait le foyer familial, lorsqu’elles ont refusé d’être réduites à leur destin de ventres maternels et ont cherché à déterminer par elles-mêmes le sens de leur existence, elles ont plus généralement lutté pour imposer une représentation de l’intime autre que celle les enfermant dans leur traditionnel rôle de mère au foyer. On pourrait dire qu’elles se sont battues pour conquérir un espace d’intimité et de secret contre une conception antagoniste de l’intime qui les maintenait en position d’infériorité. On aurait de ce point de vue tort d’identifier une bonne fois pour toutes une sphère dite du secret séparée de la sphère dite publique. Au contraire, il semble nécessaire de penser la question du secret en termes de conflictualité. Il y a en effet une pluralité irréductible des configurations du secret, renvoyant à des situations tellement diverses, à des façons de les vivre et de les réfléchir à ce point singulières qu’il est comme impossible de les référer à une représentation sociale unitaire du secret. Cette irréductible hétérogénéité passe par un conflit mettant aux prises des représentations concurrentes ayant pour objet le contenu de ce qui doit rester secret : le statut et la place des femmes dans la société ne seront pas définis d’une manière similaire selon la façon dont est déterminé ce qu’elles doivent ou non garder secret et ce qu’elles ont le droit de faire et de ne pas faire en public.
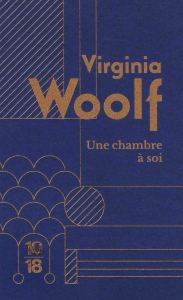
« Une chambre à soi », Virginia Woolf (10/18, paru initialement en anglais sous le titre « A Room of One’s Own’ en 1929)
Ainsi ce qui est digne d’être valorisé comme jardin secret féminin ne sera pas le même selon que l’on se situe dans une société religieuse ou dans une société démocratique reconnaissant le principe de la pluralité des conceptions de la vie bonne : dans une société traditionnelle, la part de secret dévolu au féminin s’entend au sens où une femme devra faire preuve en toute occasion de réserve et de discrétion, se rendre la moins visible possible, ou à défaut, ne pas transformer sa visibilité en signes ostentatoires. Mais certainement pas au sens où, dans l’intimité de sa chambre, elle pourrait s’adonner à la pratique d’une activité artistique, l’écriture par exemple, dans le but éventuel de publier ce qu’elle écrit. Dans une société moderne, la part de secret conféré au féminin ne peut plus se définir selon les mêmes termes : non seulement les femmes n’ont pas à faire spécialement preuve de réserve ou de discrétion, mais elle doivent pouvoir se vivre en tant qu’artistes si elles pensent en avoir les talents et pour cela, conquérir leur indépendance par rapport à l’ordre domestique où elles sont censées occuper une place bien particulière – maîtresses de maison, et aucune autre. Et surtout ce sera à elles de déterminer la part de retrait légitime qu’elles peuvent exiger, sans se laisser imposer passivement une conception de secret qui tendrait à minorer leurs facultés créatrices : autrement dit, d’après Virginia Woolf, avoir un espace à soi, où il est possible de rêver et d’écrire sans être dérangé, sans avoir de comptes à rendre, ni même sans se sentir coupable d’éprouver tel ou tel sentiment, tel ou tel désir[13].
On doit donc prendre garde à ne pas essentialiser la notion d’intimité, en croyant qu’elle serait en elle-même émancipatrice. Un certain nombre de revendications modernes, et surtout contemporaines, attestent combien l’intimité d’un rapport vécu avec ses proches pouvait être aliénante. Lorsque les historiens évoquent la naissance du sentiment d’intimité au dix-huitième, et surtout dix-neuvième siècle où il s’est approfondi, c’est d’abord pour en souligner le caractère très ambigu. Le sentiment d’identité individuelle s’est certes accentué : « …Un peu partout, à des degrés divers selon les milieux et les lieux, s’opère, dans les idées et les mœurs, une forte poussée de l’individu. Le droit retarde sur les faits. Dans les pratiques, de plus en plus de gens s’insurgent contre les disciplines collectives et les servitudes familiales, et disent leur besoin d’un temps et d’un espace à soi[14]. » Et les individus, les femmes en particulier, ont gagné en intimité : l’historien André Corbin montre comment, au moins dans la haute et moyenne bourgeoisie, la chambre individuelle était devenue à cette époque « le temple de la vie privée », les individus s’appropriant les objets et les meubles qui composent le décor de cet espace devenu dès lors un lieu strictement personnel, avec ses secrets propres[15]. L’apparition du cabinet de toilette et de la salle de bains atteste bien de la naissance d’un rapport à son propre corps vécu dans l’intimité, qu’on doit par souci de pudeur, garder caché, à l’abri du regard, et qui dessine ainsi une zone de secret, vis-à-vis de laquelle la politesse exige de ne pas témoigner d’intérêt manifeste[16]. D’ailleurs, si comme le rappelle Alain Corbin, la chemise de nuit est de moins en moins tolérée hors de la chambre, c’est que celle-ci est désormais perçue comme un espace strictement privé, et qu’il convient de garder secret en le cachant hors des regards, puisque intrinsèquement intime, par là même intrinsèquement érotique[17].
Mais si le corps cesse ainsi d’être refoulé, pour se voir accorder un statut positif, la conquête de l’intimité à cette époque se fait en même temps dans un cadre familial extrêmement normatif qui laisse finalement peu de place pour l’expression de la personnalité et des désirs individuels les plus singuliers, particulièrement en ce qui concerne les femmes. Ceux-ci doivent rester secrets, non pas au sens où l’individu n’a pas à se justifier de ce qu’il peut ressentir mais au sens négatif où les désirs les plus intimes restent encore honteux, surtout quand ils vont à l’encontre des mœurs ambiantes et doivent emprunter la voie de la clandestinité pour se réaliser. Comme le montre à ce sujet Anne Martin-Fugier, la recherche d’un cœur amoureux s’opère pour une jeune fille dans le cadre de rituels de socialisation fort conventionnels et peu propices à l’expression de son individualité : celle-ci doit se marier dans le courant de l’année où elle commence à entretenir des relations avec ses prétendants. Au bout de trois ans, si la jeune fille n’a toujours pas trouvé son futur conjoint, elle est vite soupçonnée d’être en réalité une femme de peu de vertu[18]. D’ailleurs, si les relations entre les futurs époux peuvent inclure de véritables sentiments, le mariage en lui-même reste fondé sur la convenance morale et sociale. Tout se passe comme si la fiancée devait rester désincarnée : celle-ci doit se montrer très réservée vis-à-vis de son fiancé et faire preuve de la plus grande pudeur dans l’expression de ses sentiments. Son intimité est dès lors surveillée de près, puisqu’il faut qu’elle passe par sa mère pour avoir l’autorisation d’envoyer une lettre à son fiancé[19]. Intimité quadrillée qui interdit tout droit explicite au secret, au sens où les parents et les proches feraient preuve d’une indifférence bienveillante à cet égard.
On peut dire plus généralement qu’il manque à la personnalité, notamment féminine, une véritable reconnaissance symbolique. Malgré le droit au secret de la correspondance, le mari garde la possibilité de surveiller et ainsi suivre le courrier de son épouse[20]. D’où la forte revendication d’un espace à soi contre la tyrannie de l’intimité familiale, cet espace à soi pouvant prendre aussi bien la forme du « dedans » que la forme du « dehors » : d’un côté, un espace physique qui soit préservé du regard et du jugement parental dans le cadre du foyer domestique, en ce sens on peut parler ici d’un espace du « dedans » : il s’agit de cette chambre à soi dont parle Virginia Woolf. De l’autre côté, un espace qui soit préservé du regard et du jugement social dans le cadre de la grande ville, l’anonymat des centres urbains facilitant l’émancipation des individus hors du carcan familial – il s’agit ici de ce que l’on pourrait appeler l’espace du « dehors »[21].
Ainsi, lorsque les femmes ont revendiqué au cours du vingtième siècle le droit à une sexualité indépendante des impératifs de reproduction, à l’expression libre de leurs désirs et de leurs projets, il s’agissait pour elles de conquérir une intimité personnelle, avec sa part de secret, contre l’intimité du foyer familial où elles étaient traditionnellement assignées à résidence, confinées à une place qu’elles devaient occuper pour être fidèles au statut qui leur était imposé, où au fond leurs obligations en termes de réserve et de discrétion leur interdisaient tout droit véritable au secret. Le fait pour une femme de se voir protégée dans intimité du foyer familial, en bénéficiant du soutien protecteur de son mari, a longtemps été de pair avec le déni de son intimité, soumise à l’impératif de transparence[22]. Mais il ne faut toutefois pas commettre de contresens, en comprenant la demande féminine de secret sur l’unique plan de son désir physique : cette exigence déborde ce strict cadre et doit se lire également, et sans doute plus fondamentalement, à un triple niveau – physique, psychologique et intellectuel.

Jane Austen, dessinée par sa sœur Cassandra, version colorisée
Un espace à soi : un espace pour créer
C’est en tout cas en ce sens qu’il faut appréhender l’idée d’un droit à un espace réservé défendue par Virginia Woolf[23]. L’écrivaine anglaise montre que si les femmes ont été pendant des siècles réduites au silence, et incapables de créer des œuvres d’art, c’est qu’elles étaient sous la triple dépendance psychique, intellectuelle et financière des hommes. Indépendamment de la question même de savoir s’il existe ou non une nature féminine, ou une écriture romanesque spécifiquement féminine, qui restent au fond des questions secondaires au regard du problème des conditions matérielles de l’écriture[24], Virginia Woolf soutient l’idée qu’il y a un préalable absolument nécessaire pour une femme désirant écrire une œuvre de fiction : être indépendante financièrement et disposer d’une chambre individuelle[25]. On devrait d’ailleurs ajouter qu’en disposant d’un lieu à soi on dispose également d’un temps pour soi – ces deux conditions n’en font qu’une car le fait d’avoir un espace réservé suppose qu’on dispose aussi d’un moment pour soi, que l’on peut justement occuper à l’activité d’écriture dans sa chambre, que l’on fermera à clef si besoin est, pour se trouver dès lors préservée des intrusions extérieures. Sans d’ailleurs prendre en compte le désir d’un espace intime séparé du reste de la maisonnée, le manque de temps en lui-même tient aux contraintes découlant du mariage, notamment la charge des enfants et des tâches ménagères, qui ne laissent plus aucun temps aux femmes pour se consacrer à l’écriture[26]. Et à ce manque de temps il faut donc ajouter un défaut d’espace, pas seulement le manque d’une pièce à soi, mais plus largement les difficultés rencontrées par les femmes pour voyager et se promener seules, pour pouvoir s’ouvrir l’esprit, laisser leur imagination vagabonder, sans parler même d’un accès libre aux bibliothèques des universités anglaises[27], tout cela par manque de temps là aussi, et en raison également du statut assigné aux femmes, rendues suspectes dès qu’elle marquent leur indépendance. Les conditions n’étaient tout simplement pas remplies pour qu’à la fin du dix-neuvième siècle les femmes puissent s’adonner dans un cadre approprié à un travail de création littéraire, comme le montre l’exemple de la romancière anglaise Jane Austen : « Si quelque chose de sa condition fit souffrir Jane Austen, ce fut l’étroitesse de la vie qui lui fut imposée. Il était alors impossible pour une femme de circuler seule. Elle ne voyagea jamais, elle ne traversa jamais Londres dans un omnibus, ne déjeuna jamais seule dans un restaurant[28]. »
Cette revendication spécifique d’une chambre à soi ne doit pas seulement s’entendre au sens d’un espace psychique mais aussi et surtout au sens d’un espace physique : il est en effet nécessaire que ce processus de réflexivité, par où une femme noue un rapport absolument personnel avec ce qu’elle vit, puisse se matérialiser sous une forme bien concrète. Les modalités de cet espace (psychique et physique à la fois, intérieur aussi bien qu’extérieur) vont ensemble : ce n’est que si une femme dispose d’un espace à elle, dans la maison commune, comportant une table où elle peut écrire et un lit ou un canapé où elle peut s’allonger et s’adonner à ses rêveries les plus secrètes sans être dérangée par l’intrusion d’un élément extérieur – une tâche domestique à accomplir notamment – qu’elle pourra pleinement jouir de cet espace intérieur où elle est libre de penser, de rêver et d’extérioriser ses secrets sous la forme de mots. Il ne faut surtout pas prendre l’exigence d’une chambre à soi à la manière où les femmes chercheraient un refuge leur permettant de s’abriter ponctuellement de la dureté de la vie, car c’est justement ce que l’intimité de la famille est censée leur procurer, et c’est précisément pour échapper au piège du foyer protecteur qui les maintient en réalité sous la dépendance masculine que les femmes doivent, à suivre Virginia Woolf, disposer d’une chambre à elles[29].
Cette conquête du secret, qui n’est enfermement qu’en apparence, constitue un élément central du processus d’émancipation des femmes, en tant qu’elle conditionne leur accès à la reconnaissance publique en tant qu’écrivaine. Virginia Woolf rappelle que pendant des siècles les femmes ont surtout servi aux hommes de miroirs, leur fournissant une surface réfléchissante où ils pouvaient contempler un reflet d’eux-mêmes deux fois plus grand que nature. De là s’explique l’infériorité dans laquelle ont été traditionnellement maintenues les femmes : réduites à un rôle de miroir grossissant, elles renvoyaient aux hommes une image élogieuse d’eux-mêmes, certes illusoire, mais à laquelle ils ont longtemps cru, s’assurant ainsi d’un statut et d’une situations qu’ils estimaient supérieurs[30]. Le propre du miroir réside dans sa transparence et dans son absence de profondeur : le miroir offre un pur effet de surface en-deçà de laquelle il n’y a rien, hormis un vide abyssal. En lui-même il ne propose aucun contenu, il ne constitue qu’un support réfléchissant, privé d’identité propre, et voué à emprunter aux êtres qui défilent devant lui la forme qu’il se borne à leur renvoyer[31]. On retrouve ici la conception stéréotypée de la femme comme un être participant au seul jeu des apparences, prisonnière des futilités de la vie et condamnée à se mouvoir dans la superficialité. Or que se passe t-il si une femme se met à proférer une vérité, une parole propre, autrement dit si le miroir se met à vivre d’une vie qui lui est propre ? La forme qui s’y reflète, celle d’un homme, se désagrège et finit par disparaître. Le miroir devient opaque, il ne reflète ni ne montre plus rien, celui qui se aimait contempler son image dans le miroir des femmes n’a alors plus aucun retour, comme si son identité se mettait à vaciller pour se défaire peu à peu : « …Cela explique […] pourquoi la critique féminine inquiète tant les hommes, pourquoi il est impossible aux femmes de dire aux hommes que tel livre est mauvais, que tel tableau est faible ou quoi que ce soit du même ordre, sans faire souffrir davantage et éveiller plus de colère que ne le ferait un homme dans le même cas. Si une femme, en effet, se met à dire la vérité, la forme dans le miroir se rétrécit, son aptitude à la vie s’en trouve diminuée[32]. »

Portrait de George Sand (XIXème siècle)
C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre le désir d’une chambre à soi, au sens où à travers ce mouvement de mise en retrait dans l’écriture, les femmes cherchent à sortir des rôles habituels que le jeu social les force à endosser et parviennent à faire ressortir leurs secrets propres au moyen des mots. Ce moment de retour à soi, qui est avant tout création de soi, emprunte la forme d’un repli sur soi, qu’il ne faut évidemment pas prendre à la manière d’une réclusion ou d’un enfermement. « A Room of One’s Own, contrairement à ce que pourrait laisser imaginer le titre, ne prône ni l’enfermement passif, ni la réclusion volontaire. Woolf ne définit pas non plus une intériorité, un « espace intérieur », qui serait l’apanage d’une nature ou d’une essence féminine[33]. » De ce point de vue, l’exemple de la poétesse américaine Emily Dickinson, qui a vécu toute sa vie chez ses parents recluse dans sa chambre, et n’a obtenu de reconnaissance véritable que posthume, est très ambigu : il pourrait laisser croire que la vie secrète de l’écrivaine doit être une vie cachée, au sens péjoratif du terme, une vie clandestine, où l’opacité nécessaire à la préservation d’un espace de souveraineté créatrice devrait être conçue à la manière d’une muraille infranchissable où rien ne peut entrer, mais où rien, non plus, finalement ne peut sortir, ou alors par hasard, ou même par effraction[34].
D’ailleurs, ainsi que le rappelle Virginia Woolf, le choix fait respectivement par Mary Ann Evans, Aurore Dupin et Charlotte Brontë de publier leurs livres sous des noms d’emprunt – George Eliot, George Sand et Currer Bell – pour être prises au sérieux comme écrivains et ne pas être confondues avec des femmes vouées à écrire des romans sentimentaux, témoigne des lourds obstacles auxquels se sont heurtées les femmes écrivaines, puisqu’elles ont dû emprunter la voie de la clandestinité, tenir secrète leur véritable identité, afin de pouvoir accéder à la reconnaissance par le milieu de l’édition, par la critique et par le public : « Currer Bell, George Eliot, George Sand, toutes, victimes du conflit intérieur comme en témoignent leurs écrits, cherchèrent en vain à se voiler en se servant d’un nom d’homme. Elles rendaient ainsi hommage à cette convention qui, si elle n’a pas été créée par l’autre sexe, a du moins été fortement encouragée par lui (la plus grande gloire pour une femme est qu’on ne parle pas d’elle, disait Périclès qui était, lui, un des hommes dont on parla le plus), que toute publicité les concernant est détestable. L’anonymat court dans leurs veines. Le désir d’être voilées les concerne encore[35]. » Virginia Woolf pointe ici une situation d’aliénation qui pousse les femmes à gommer leur être propre et à garder secrète leur identité, les condamnant à vivre leur existence d’écrivaines dans la clandestinité, cette mauvaise part du secret. L’exemple précisément de George Eliot, écrivaine clandestine et en couple avec un homme marié, contrainte de vivre à l’écart de la vie sociale, témoigne de l’extrême difficulté pour une femme à l’époque d’assumer ouvertement son indépendance, libre de fréquenter qui elle veut, et son statut d’écrivaine, reconnue par le public pour son nom propre et non cachée sous un nom d’emprunt[36]. Il fallait être alors un homme pour vivre au contact du grand monde sa passion et son métier d’écrivain en toute liberté[37]. Car si la dimension d’opacité est nécessaire à la création littéraire, elle n’est pas une finalité en soi, mais constitue un moment seulement du processus créatif, qu’il faut revivre quotidiennement afin de parvenir à métamorphoser par l’écriture ce qui est ressenti intérieurement en une œuvre publique ouverte à une postérité possible. Ce que vise donc Virginia Woolf, c’est une existence articulée autour de la création artistique, en l’occurrence littéraire, qui implique une dimension irréductible de secret, mais l’assume ouvertement, se refusant aux complaisances d’une existence secrète au sens de la clandestinité honteuse.
L’Ange du logis : un ami à bannir du foyer
C’est pourquoi cette revendication de secret ne doit se comprendre que dans ce qu’il conditionne, à savoir l’accès au monde public et à la reconnaissance de ce monde. Ce n’est en effet que dans la mesure où les femmes ont la possibilité de prendre leurs distances vis-à-vis du monde social et de ses normes sans avoir de compte à rendre à ce sujet, ce qui passe donc par la disposition d’un temps et d’un espace qui leur soit propre, où elles peuvent garder secret ce qu’elles y font, qu’elles sont alors en mesure de créer des œuvres littéraires digne d’apparaître dans l’espace public et d’être reconnues comme une contribution essentielle à la culture humaine. D’après Virginia Woolf, il aura justement manqué à la plupart des romancières anglaises du dix-neuvième siècle un espace à soi séparé de la pièce de séjour commune, où l’écrivaine peut s’adonner en toute quiétude à la création littéraire, sans être dérangé, et surtout sans dépendre uniquement de ce qu’elle perçoit de cette vie domestique dont elle ne parvient que difficilement à s’abstraire, avec comme conséquences une possible limitation de la faculté d’imagination : « …La seule formation littéraire que pût avoir une femme au début du XIXe siècle, était celle de l’observation des caractères, de l’analyse des émotions. La sensibilité féminine avait été, depuis des siècles, affinée par l’expérience du salon commun. Les sentiments des autres êtres marquaient les femmes ; le jeu des relations personnelles se déroulait sans cesse devant elles ; c’est pourquoi, quand la femme de la bourgeoisie se mit à écrire, elle écrivit des romans, bien que de toute évidence deux des femmes célèbres citées ici ne fussent pas, de nature, des romancières. Emily Brontë aurait du écrire des pièces de théâtre poétiques : la surabondance du vaste esprit de George Eliot aurait du se répandre, une fois l’inspiration créatrice épuisée, sur l’histoire et la biographie[38]. »

Photographie de Virginia Woolf (Mondadori Portfolio)
L’exigence de retrait lié au besoin de protéger son espace de création ne doit donc pas être perçue unilatéralement comme une menace pour l’intégrité du monde public, susceptible de se fragmenter en autant de mondes secrets qu’il existe d’individus doués d’une singularité propre. Il faut au contraire se représenter cette exigence comme la condition même de l’instauration d’un espace public qui soit riche en créations et en actions originales : ce n’est que dans la mesure où une femme dispose d’un espace à elle, séparé du monde extérieur, un univers secret où elle existe souverainement et qui ne concerne qu’elle, qu’elle est en mesure de créer quelque chose de suffisamment intéressant, susceptible à ce titre de contribuer à tisser une humanité commune[39].
Il faudra pour cela que les femmes parviennent à surmonter les nombreux obstacles qui se dressent devant elles, à commencer par ceux contenus dans la maison familiale elle-même : le principal est celui représenté par l’héroïne du poème de Coventry Patmore « l’Ange du foyer », qui symbolise la femme anglaise à l’époque victorienne, censée se montrer obéissante à son mari et pleine de dévouement envers ses enfants[40]. L’Ange du foyer excelle dans trois rôles : l’épouse parfaite, la mère parfaite et la maîtresse de maison parfaite. C’est cette figure de la femme vertueuse, symbolisant le statut passif de l’épouse docile vouée à la gestion du foyer domestique, que Woolf entend critiquer[41]. Les premiers pas d’une femme qui s’adonne à l’écriture sont en effet perturbés par la présence de cet ange tutélaire, certes pétri des meilleurs intentions du monde[42], mais dont les conseils adressés à celle dont il assure la protection, afin de lui permettre de concilier son élan créatif et ses obligations de maîtresse de maison, auront pour conséquences de briser ses velléités d’indépendance et d’accomplissement de soi par l’écriture : « A cette époque – la fin du règne de la reine Victoria – chaque foyer avait son Ange. Et quand je me mis à écrire, elle fut là dès les premiers mots qui me vinrent. L’ombre de ses ailes plana sur ma page ; j’entendis le bruissement de sa robe. Bref, dès que je pris mon crayon pour écrire la recension du roman de cet homme célèbre, elle se glissa derrière moi et chuchota : « Mon enfant, vous êtes une toute jeune femme. Vous écrivez sur un livre écrit par un homme. Montrez-vous indulgente ; soyez douce ; soyez flatteuse ; dissimulez ; usez de toutes les ruses et de tous les stratagèmes de notre sexe. Ne laissez jamais deviner que vous êtes dotée d’un esprit qui vous est propre. Et surtout, soyez pure ». Et elle prétendit guider ma plume[43]. » Toute femme désireuse de s’accomplir dans l’écriture doit donc commencer par éliminer l’ange du foyer[44], ce faux-frère lui rappelant qu’elle ne doit avoir aucune pensée ou aucun désir propres, qu’elle doit d’abord partager les pensées et les désirs des autres avant de penser aux siens, et qu’elle ne doit donc pas ni secret, ni domaine réservé[45].
En tout cas, même si le chemin à parcourir sera nécessairement long pour que la profession d’écrivain soit reconnue par la société comme un type d’activité qui ne soit pas genrée, d’autant que les femmes mettront du temps pour apprendre à ne plus se soucier des reproches proférés par l’Ange du foyer[46], une brèche a cependant été ouverte qu’il sera difficile de refermer : « Les femmes ont désormais des pièces à elles, dans cette demeure qui était jusqu’alors la propriété exclusive des hommes. Vous les avez conquises. Vous êtes en mesure, au prix d’un travail acharné, d’acquitter le loyer. Vous gagnez vos cinq cent livres par an. Mais cette liberté n’est qu’un début ; la pièce est à vous, mais elle est encore nue. Elle doit être meublée ; elle doit être décorée ; elle doit être partagée avec d’autres. Comment allez-vous la meubler, comment allez-vous la décorer ? Avec qui allez-vous la partager, et à quelles conditions ? Ce sont là, me semble-t-il, des questions extraordinairement importantes et captivantes. Pour la première fois de l’histoire, vous êtes en mesure de les poser ; pour la première fois vous êtes en mesure de décider par vous-même des réponses[47]. »
© Nicolas Poirier
Notes :
[1] Virginia Woolf, Une chambre à soi, trad. C. Malraux, Denoël, Paris, 1977, rééd. « Bibliothèques10/18 », 2012.
[2] Voir Michelle Perrot, Histoire de chambres, Paris, Seuil, « La librairie du XXIe siècle », 2009, p. 8.
[3] Voir Michel Foucault, Dits et écrits, T. 3, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des sciences humaines », 1994, p. 192 : « Il y aurait à écrire toute une histoire des espaces – qui serait en même temps une histoire des pouvoirs depuis les grandes stratégies de la géopolitique jusqu’aux petites tactiques de l’habitat, de l’architecture institutionnelle, de la salle de classe ou de l’organisation hospitalière, en passant par les implantations économico-politiques. Il est surprenant de voir combien le problème des espaces a mis longtemps à apparaître comme un problème historico-politique ». L’époque contemporaine doit d’ailleurs être pensée d’après Foucault d’après les catégories de l’espace et de la spatialisation. Voir sur ce point …. « L’époque actuelle serait peut-être plutôt l’époque de l’espace. Nous sommes à l’époque du simultané, nous sommes à l’époque de la juxtaposition, à l’époque du proche et du lointain, du côte à côte, du dispersé. Nous sommes à un moment où le monde s’éprouve, je crois, moins comme une grande vie qui se développerait à travers le temps que comme un réseau qui relie des points et qui entrecroise son écheveau. »
[4] Voir Michelle Perrot, Histoire de chambres, op. cit., p. 9.
[5] Voir Michel Foucault, « Des espaces autres », Dits et écrits, T. 4, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des sciences humaines », date et page
[6] Voir ibid., p.
[7] Voir Michelle Perrot, Histoire de la vie privée (dir. P. Ariès et G. Duby), 4. De la révolution à la grande guerre (dir. M. Perrot), « Introduction », Paris, Seuil, 1987, rééd. « Points/Histoire », 1999, p. 7.
[8] Voir ibid., p. 7.
[9] Voir ibid., p. 7 et 8.
[10] Voir ibid., p. 8.
[11] Voir Michael Foessel, La privation de l’intime, Paris, Seuil, date, p.
[12] Voir ibid., p.
[13] Les femmes ont toujours eu à se justifier davantage de leur désir d’écrire et de chercher, plus généralement, l’accomplissement de soi dans une activité artistique. Voir sur ce point Virginia Woolf, Une chambre à soi, op. cit., p. 79 : « L’indifférence du monde que Keats et Flaubert et d’autres hommes de génie ont trouvé dure à supporter était, lorsqu’il s’agissait de femmes, non pas de l’indifférence mais de l’hostilité. Le monde ne leur disait pas ce qu’il disait aux hommes : écrivez si vous voulez, je m’en moque… Le monde leur disait dans un éclat de rire : Écrire ? Pourquoi écrivez-vous ? »
[14] Voir Alain Corbin, « Le secret de l’individu », dans Histoire de la vie privée. 4. De la révolution à la grande guerre, op. cit., p. 389. Voir également Michelle Perrot, « Coulisses », dans Histoire de la vie privée. 4. De la révolution à la grande guerre, op. cit., p. 386 : « C’est qu’un peu partout, à des degrés divers selon les milieux et les lieux, s’opère, dans les idées et les mœurs, une forte poussée de l’individu. Le droit retarde sur les faits. Dans les pratiques, de plus en plus de gens s’insurgent contre les disciplines des collectivités et les servitudes familiales, et disent leur besoin d’un temps et d’un espace à soi. Dormir seul, lire tranquillement son livre ou son journal, s’habiller comme on l’entend, aller et venir à sa guise, consommer à son gré, fréquenter et aimer qui l’on veut… expriment les aspirations d’un droit au bonheur qui supposent le choix de son destin. »
[15] Voir Alain Corbin, op. cit., p. 407-408.
[16] Voir ibid., p. 410-411.
[17] Voir ibid., p. 411-413.
[18] Voir Anne Martin-Fugier, « Les rites de la vie privée bourgeoise », dans Histoire de la vie privée. 4. De la révolution à la grande guerre, op. cit., p. 215.
[19] Voir ibid., p. 217.
[20] Voir Michelle Perrot, « Coulisses », op. cit., p. 385.
[21] Voir ibid., p. 386 : « La ville, nouvelle frontière, desserre les contraintes familiales ou locales, stimule les ambitions, atténue les convictions. Créatrice de liberté, dispensatrice de nouveaux plaisirs, la ville, si souvent marâtre cruelle, fascine, en dépit des diatribes des moralistes. Paradoxale, elle engendre à la fois les foules et les individus solitaires. Elle est génératrice de rupture et d’événement. »
[22] La protection dont devait bénéficier les femmes de la part de leur mari marche aussi avec leur infériorisation et leur soumission, comme le stipule l’article 213 du Code civil (« Le mari doit protection à sa femme et la femme obéissance à son mari »). Voir sur ce point Michelle Perrot, « Figures et rôles », dans Histoire de la vie privée. 4. De la révolution à la grande guerre, op. cit., p. 110.
[23] L’essai intitulé Une chambre à soi se compose de trois conférences prononcées par Virginia Woolf en 1928 à Newnham College et Girton College, deux universités pour femmes de Cambridge.
[24] Voir Virginia Woolf, Une chambre à soi, op. cit., p. 7-8. Voir sur ce point Frédéric Regard, L’écriture féminine en Angleterre, Paris, PUF, « Perspectives anglo-saxonnes », 2002, p. 90-91.
[25] Voir Virginia Woolf, Une chambre à soi, op. cit., p. 8.
[26] A propos du dix-neuvième siècle anglais, Virginia Woolf affirme (ibid., p. 99) : « Si une femme écrivait, elle devait le faire dans le salon commun. Et sans cesse on interrompait son travail – chose dont miss Nightingale devait se plaindre avec tant de véhémence : « les femmes n’ont jamais eu une demi-heure dont elles puissent dire qu’elles leur appartiennent » […] Jane Austen écrivit dans ces conditions jusqu’à la fin de ses jours : « Qu’elle ait été capable d’accomplir tout cela (écrit son neveu dans ses souvenirs) reste surprenant, car elle n’avait pas de bureau personnel où se retirer et la plus grande partie de son travail dût être faite dans le salon commun, où elle était exposée à toutes sortes d’interruptions. Elle prenait grand soin que les domestiques, les visiteurs, ou qui que ce fût hors de sa propre famille ne pût soupçonner son travail. » Jane Austen cachait ses manuscrits ou les recouvrait d’une feuille de papier buvard. »
[27] Virginia Woolf jugeait nécessaire qu’on modifie la législation en vigueur pour permettre aux jeunes femmes d’intégrer les universités.Voir sur ce point Virginia Woolf, Trois guinées, trad. V. Forrester, dans le recueil Romans, essais, éd. F. Cibiel, Paris, Gallimard, « Quarto », 2014, p. 1199-1239.
[28] Voir Virginia Woolf, Une chambre à soi, op. cit., p. 102.
[29] Voir ibid., p. 61 : « Enlevez toute protection aux femmes, exposez-les aux mêmes efforts, aux mêmes activités que les hommes, faites-en des soldats, des marins et des mécaniciennes et des docteurs […] Tout pourra arriver quand être une femme ne voudra plus dire : exercer une fonction protégée… »
[30] Voir ibid., p. 54.
[31] Voir ibid., p. 55 : « Comment l’homme continuerait-il de dicter des sentences, de civiliser des indigènes, de faire des lois, d’écrire des livres, de se parer, de pérorer dans les banquets, s’il ne pouvait se voir pendant ses deux repas principaux d’une taille pour le moins double de ce qu’elle est en vérité. »
[32] Voir ibid., p. 54-55.
[33] Frédéric Regard, op. cit., p. 90.
[34]Ref ?
[35] Virginia Woolf, Une chambre à soi, op. cit.,, p. 75-76.
[36] Voir ibid., p. 105.
[37] Voir ibid., p. 105-106 : « Au même moment, de l’autre côté de l’Europe, il y avait un jeune homme qui vivait librement avec telle grande dame, allait à la guerre, ramassant sans qu’intervienne ni obstacle ni censure toute cette riche expérience de la vie humaine qui plus tard lui rendra de si magnifiques services quand il écrira ses livres. S’il avait mené au prieuré une vie retirée avec une femme mariée « à l’écart de ce qui s’appelle le monde », quelque édifiant qu’eût pu être ce spectacle, Tolstoï n’eut certainement pas écrit Guerre et Paix. »
[38] Voir ibid., p. 100. Voir également p. 105 : « …Nous devons accepter le fait que Villette, Emma, Les Hauts de Hurlevent, Middlemarch, ces bons romans, furent écrits par des femmes qui n’avaient de la vie que l’expérience qui pouvait entrer dans la maison d’un respectable pasteur ; mieux encore, écrits dans le salon commun de cette maison respectable et par des femmes si pauvres qu’elles ne purent se permettre d’acheter plus de quelques rames de papier à la fois pour écrire Les Hauts de Hurlevent ou Jane Eyre. »
[39] Voir Michèle Rivoire, « Virginia Woolf : une « chambre à soi », une chambre d’échos », Sens-Dessous, n°13, 2014 : « Ainsi, pour fixer son expérience dans des formes fictionnelles novatrices, la romancière a besoin de forger une langue propre, une langue qui noue sa langue privée à la langue commune et participe ainsi à l’enrichissement linguistique apporté par chaque œuvre littéraire à la langue anglaise. Il s’agit pour Woolf de créer une langue propre pour élever son expérience privée à la dignité de la langue anglaise. »
[40] Voir Swati Dasgupta, « L’ange du foyer. Regards féminins sur les Indiennes au XIXe siècle », Antipodes. Études littéraires, n°1, 2018, p. 2-4.
[41] Virginia Woolf, « Des professions pour les femmes », Essais choisis, éd. et trad. C. Bernard, Paris, Gallimard, « Folio/Classique », 2015, p. 393-395. Il s’agit d’une conférence donnée par Virginia Woolf en janvier 1931 à la London and National Society for Women’s service, une organisait qui militait pour le droit des femmes dans le monde du travail, notamment la possibilité d’accéder à des professions traditionnellement réservées aux hommes.
[42] Voir ibid., p. 393 : « Elle était pleine d’une intense compassion. Elle était extrêmement charmante. Elle était dénuée de tout égoïsme. Elle excellait dans tous les arts domestiques. Sa vie était faite de sacrifices quotidiens. »
[43] Ibid., p. 394.
[44] Voir ibid., p. 395 : « Quoique finalement j’eus la satisfaction de la tuer, le combat fut rude ; il prit un temps qui aurait été mieux utilisé à apprendre le grec ; ou à parcourir le monde en quête d’aventures […] ce fut une expérience à laquelle ne pouvaient échapper les femmes écrivaines d’alors. Tuer l’Ange du foyer faisait, pour les femmes, partie du métier d’Écrivain ».
[45] Voir ibid., p. 393.
[46] Voir ibid., p. 395.
[47] Ibid., p. 399-400.