PETIT DÉJEUNER AVEC GILLES COHEN-TANNOUDJI
La notion de référentiel et d’horizon de la recherche scientifique
Par Gilles Cohen-Tannoudji
Laboratoire de recherche sur les sciences de la matière
(CEA Université de Paris-Saclay)
 Gilbert Deleuil, Président de Galilée.sp a présenté l’invité du petit déjeuner du 12 septembre, Monsieur Gilles Cohen-Tannoudji, ancien élève de l’Ecole Polytechnique, docteur d’état en physique, à la retraite depuis 1998, mais toujours actif en tant que conseiller scientifique auprès du Directeur de la recherche fondamentale au CEA (Commissariat à l’Energie Atomique), chercheur émérite au Laboratoire de recherche sur les sciences de la matière (LARSIM, CEA, Université Paris-Saclay).
Gilbert Deleuil, Président de Galilée.sp a présenté l’invité du petit déjeuner du 12 septembre, Monsieur Gilles Cohen-Tannoudji, ancien élève de l’Ecole Polytechnique, docteur d’état en physique, à la retraite depuis 1998, mais toujours actif en tant que conseiller scientifique auprès du Directeur de la recherche fondamentale au CEA (Commissariat à l’Energie Atomique), chercheur émérite au Laboratoire de recherche sur les sciences de la matière (LARSIM, CEA, Université Paris-Saclay).
Et “last but not least”, Gilles Cohen-Tannoudji se trouve être le père d’Evelyne Cohen- Lemoine, coach, membre de Galilée.sp et Présidente de l’UPR (Unité de Partenariat et de Recherche) “Sciences et conscience”.
Sur la base d’une conférence donnée le 1er septembre 2018 à Lausanne dont le thème était “le référentiel selon Ferdinand Gonseth”, Gilles Cohen-Tannoudji a présenté les évolutions de la recherche scientifique et les enjeux “croisés” de la physique et de la philosophie et ses conséquences sur l’homme – ce “miracle sans intérêt” – selon la formule-choc de Jean Rostand.
À propos de Ferdinand Gonseth
 Quelques notes de présentation de Ferdinand Gonseth, (1890-1975), mathématicien, physicien et philosophe suisse, fondateur avec Gaston Bachelard et Paul Bernays de larevue “Dialectica” (1947), une revue “essentiellement consacrée à la diffusion de travaux en philosophie des sciences et en logique”.
Quelques notes de présentation de Ferdinand Gonseth, (1890-1975), mathématicien, physicien et philosophe suisse, fondateur avec Gaston Bachelard et Paul Bernays de larevue “Dialectica” (1947), une revue “essentiellement consacrée à la diffusion de travaux en philosophie des sciences et en logique”.
Voici comment l’association Ferdinand Gonseth présente le mathématicien-philosophe sur son site : “[Ferdinand Gonseth] a ainsi constitué une pensée originale, appellée idonéisme ou aussi méthodologie ouverte, pensée qui refuse de se laisser enfermer dans des a priori dogmatiques et exige une totale  ouverture à l’expérience. (…) À la fin de sa vie, Gonseth s’est tourné vers les sciences humaines; il a tenté d’appliquer à un domaine plus vaste, en particulier en linguistique et en morale, une méthodologie rigoureuse qui a fait ses preuves dans le domaine des sciences dites exactes. Ferdinand Gonseth n’a pas seulement marqué son époque par ses écrits; il a eu un grand nombre d’élèves, d’assistants, de disciples avec lesquels il a toujours aimé dialoguer et sur lesquels il a exercé une durable influence”.
ouverture à l’expérience. (…) À la fin de sa vie, Gonseth s’est tourné vers les sciences humaines; il a tenté d’appliquer à un domaine plus vaste, en particulier en linguistique et en morale, une méthodologie rigoureuse qui a fait ses preuves dans le domaine des sciences dites exactes. Ferdinand Gonseth n’a pas seulement marqué son époque par ses écrits; il a eu un grand nombre d’élèves, d’assistants, de disciples avec lesquels il a toujours aimé dialoguer et sur lesquels il a exercé une durable influence”.
A propos de Ferdinand Gonseth, Gilles Cohen-Tannoudji note que celui-ci a suivi un “itinéraire philosophique allant de la philosophie des mathématiques à la philosophie des sciences, puis à la philosophie en général”.
Gilles Cohen-Tannoudji a fait parvenir à Galilée.sp le texte de son intervention à la conférence de Lausanne qui est reproduit ici, avec quelques titres de paragraphes ajoutés pour en faciliter la lecture.
Einstein et la philosophie
Je voudrais, pour introduire mon propos, citer un texte, extrêmement célèbre d’Einstein qui est en quelque sorte son manifeste à propos de ses rapports à la philosophie : « Le rapport réciproque de l’épistémologie et de la science est d’une nature assez remarquable. Elles dépendent l’une de l’autre. L’épistémologie en l’absence de contact avec la science devient un schème vide. La science sans épistémologie – et pour autant qu’elle soit alors seulement pensable – est primitive et embrouillée. Cependant à peine l’épistémologue qui recherche un système clair s’est-il frayé un chemin vers un tel système, qu’il est tenté d’interpréter le contenu de la pensée de la science dans le sens de son système et de rejeter tout ce qui n’y entre pas, le scientifique quant à lui ne peut pas se permettre de pousser aussi loin son effort en direction d’une systématique épistémologique. Il accepte avec reconnaissance l’analyse conceptuelle de l’épistémologie ; mais les conditions externes qui interviennent pour lui au travers des faits d’expérience ne lui permettent pas de se laisser trop restreindre dans la construction de son monde conceptuel par l’adhésion à un système épistémologique quel qu’il soit. Il doit donc apparaître à l’épistémologue systématique comme une espèce d’opportuniste sans scrupules : il apparaît comme un réaliste dans la mesure où il cherche à décrire un monde indépendant des actes de la perception, comme un idéaliste dès lors qu’il considère les concepts comme des libres inventions de l’esprit humain (elles ne peuvent être déduites logiquement du donné empirique), comme un positiviste s’il considère que ses concepts et ses théories ne sont justifiés que dans la mesure où ils fournissent une représentation logique des relations entre les expériences des sens. Il peut même apparaître comme un platonicien ou un pythagoricien s’il considère que le point de vue de la simplicité logique est un outil indispensable et effectif de sa recherche ».
On voit dans ce texte qu’il reconnaît le rôle irremplaçable d’une relation étroite entre la science et la philosophie de la connaissance, mais qu’il revendique de façon très claire le droit pour le scientifique, confronté aux « conditions externes qui interviennent au travers des faits d’expérience » de refuser de se soumettre à quelque philosophie que ce soit qui lui serait extérieure ou antérieure.
Le concept d’idonéité
C’est ce droit du scientifique à la recherche de la meilleure idonéité que Ferdinand Gonseth (1890-1975) reconnaît à Einstein de manière très explicite dans son introduction au colloque de l’UNESCO qui lui a rendu hommage dix ans après sa mort en 1965 : « Ce qu’il importe de voir se préciser c’est l’aspect méthodologique de l’entreprise Einsteinienne. Avec une simplicité et un naturel insurpassables, Einstein a assumé ce qui de plus en plus nous paraît être essentiel dans la situation du chercheur. Le chercheur doit être conscient à la fois de sa liberté et de sa responsabilité.  Il doit revendiquer sa plus entière liberté d’examen, et savoir aussi que cette liberté a son écueil, l’affirmation arbitraire. Il doit en même temps s’ouvrir aux témoignages des faits, tout en sachant que cette ouverture a également son écueil, l’asservissement aux apparences. Cette liberté et cette obéissance ne sont-elles pas contradictoires ? Elles ne sont pas accordées d’avance. Le chercheur en reste l’arbitre, le principe de son arbitrage demeurant la recherche de la meilleure idonéité, dont personne mieux que lui ne peut être le juge ».
Il doit revendiquer sa plus entière liberté d’examen, et savoir aussi que cette liberté a son écueil, l’affirmation arbitraire. Il doit en même temps s’ouvrir aux témoignages des faits, tout en sachant que cette ouverture a également son écueil, l’asservissement aux apparences. Cette liberté et cette obéissance ne sont-elles pas contradictoires ? Elles ne sont pas accordées d’avance. Le chercheur en reste l’arbitre, le principe de son arbitrage demeurant la recherche de la meilleure idonéité, dont personne mieux que lui ne peut être le juge ».
Dans cette citation on voit apparaître le terme d’idonéité qui définit le rôle que joue la recherche scientifique au fondement de la philosophie de ce mathématicien-philosophe : « Une recherche qui opte à la fois pour la liberté d’examen et pour l’ouverture à l’expérience et prend à charge de les accorder en vue de l’idonéité la meilleure, a par la même, acquis son autonomie méthodologique et philosophique. Elle est en état de refuser toute philosophie qui ne procéderait pas d’elle, toute philosophie qui lui serait par principe antérieure ou extérieure. Disons mieux en n’hésitant pas à aller jusqu’au bout de l’affirmation : la recherche qui fait sienne cette méthode reprend à son compte l’intention philosophique centrale, celle de connaître dans toute la mesure du possible. Consciemment ou non la recherche scientifique s’en inspire. Or, pour ce qui concerne la connaissance de la nature, aucune philosophie n’a poussé aussi loin qu’elle. Il se révèle que lorsqu’elle ne s’attarde pas dans le particulier, elle est la réalisatrice la plus fidèle de l’intention philosophique. (…) Tout compte fait je crois pouvoir me résumer en quelques mots : chez Albert Einstein, le savant incarne le philosophe de la nature. Philosophe il l’était profondément et j’ajouterai même, naïvement, s’il n’avait été aussi lucide. Je pourrais dire aussi qu’en lui, le savant n’est que la forme de réalisation du philosophe libéré par la sincérité et l’authenticité de sa recherche ».
Le projet philosophique de Ferdinand Gonseth
C’est dans un ouvrage posthume, intitulé « Mon itinéraire philosophique », présenté en 1994 par François Bonsack que Ferdinand Gonseth présente, comme s’il parlait d’une autre personne, son projet philosophique : « L’œuvre philosophique de Ferdinand Gonseth est tout entière dominée par la triple intention que voici :
- Fonder une philosophie qui soit et qui puisse rester au niveau de la connaissance scientifique ;
- Dégager cette philosophie non pas de principes posés a priori comme nécessaires, mais de la pratique et du progrès même de la recherche ;
- L’engager à titre à titre d’épreuve dans toutes les perspectives déjà ouvertes. (…)
Puisque, dans sa teneur même ce projet s’interdisait d’avoir recours à des principes posés a priori comme nécessaires, il n’y avait qu’une preuve à donner de l’existence d’une telle philosophie : lui conférer l’existence en la faisant de toutes pièces ».
Quant à la raison de ce souci de se hisser et se maintenir au niveau de la connaissance scientifique, on la trouve explicitée dans cet autre texte dans lequel, face à « la science qui deviendra, plus essentiellement qu’elle ne l’est déjà aujourd’hui, à la fois facteur de puissance et ferment d’évolution, » il s’interroge sur le rôle dans lequel « la philosophie pourra se maintenir » : « Je ne veux pas voir ici dans la philosophie le jeu intellectuel plus ou moins désuet dont elle donne parfois l’impression, je veux l’apercevoir au contraire dans sa fonction inaliénable qui est de promouvoir les plus hautes valeurs qu’une société donne, qu’une civilisation puisse incarner. Il y a dans l’action de promouvoir celle de dégager, d’exprimer, de fonder, de faire valoir, de développer et de défendre. Dans cette fonction, une philosophie n’est pas véritablement née tant qu’elle n’a pas trouvé d’écho, et elle meurt si cet écho disparaît. Elle n’est vivante que portée par des hommes vivants. Elle peut être atteinte, et avec elle la forme de civilisation qu’elle exprime et défend, dans les corps de ceux qui la cultivent ou qui s’en inspirent. (…) Mais quel pourrait être le rôle d’une philosophie qui accepterait pleinement sa fonction au sein même de l’éternel changement, celle de mettre et de remettre constamment à découvert les valeurs à promouvoir ? Je ne lui vois pas d’autre destin que de se lier à la science, non pour en être la servante, mais pour lui rester toujours égale. Non pour la suivre en tout, mais pour l’accompagner partout, pour se mesurer partout avec elle et ne jamais lui céder le terrain en toute propriété. Nul ne peut prévoir les péripéties de ce dialogue, où chacun lutterait pour les autres en luttant pour soi-même.
On peut cependant espérer que la philosophie y trouverait quelque force et la science quelque sagesse ».
Le concept de référentiel
Le texte qui précède montre que le projet philosophique de Gonseth ne pouvait se limiter à élaborer une méthodologie scientifique ou une épistémologie voire une gnoséologie, mais que pour aboutir à une authentique philosophie,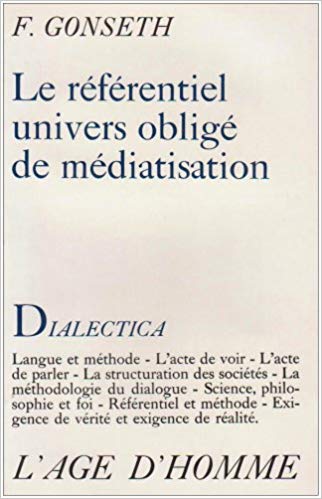 capable de remplir le rôle dans lequel elle est irremplaçable, celui de promouvoir les valeurs sur lesquelles se fonde une société, il fallait au scientifique qu’il était, s’aventurer hors de son domaine naturel de compétence, la philosophie des mathématiques ou des sciences de la nature, et aborder celui de la philosophie générale par l’intermédiaire de la philosophie des sciences humaines et sociales. C’est ce que Gonseth a fait, à la fin de sa vie avec beaucoup de prudence et de modestie, à l’aide du concept de référentiel, objet de son dernier livre.
capable de remplir le rôle dans lequel elle est irremplaçable, celui de promouvoir les valeurs sur lesquelles se fonde une société, il fallait au scientifique qu’il était, s’aventurer hors de son domaine naturel de compétence, la philosophie des mathématiques ou des sciences de la nature, et aborder celui de la philosophie générale par l’intermédiaire de la philosophie des sciences humaines et sociales. C’est ce que Gonseth a fait, à la fin de sa vie avec beaucoup de prudence et de modestie, à l’aide du concept de référentiel, objet de son dernier livre.
« Subjectif ou objectif, selon la façon dont on le regarde, le référentiel apparaît lui-même comme un horizon de nature intermédiaire. Les ‘réalités’ de cet horizon sont à la fois formes pour le sujet de ce qui a pour lui valeur de significations extérieures, et actualisations extérieures de ce qui, venant de lui, s’impose comme conditions obligées de son appartenance au monde.
Cette double nature du référentiel en fait un passage obligé. Que le sujet laisse le monde venir à lui par le truchement de certains flux informationnels, ou qu’il se porte vers le monde pour s’y insérer et pour y faire valoir son projet d’exister, c’est toujours sur un référentiel que se fait la rencontre de ce qu’il est, de ce qui lui est propre, avec ce qu’il n’est pas, avec ce qui lui est étranger ».
Bien évidemment, pour que ce concept soit au centre de la philosophie dans son rôle de promoteur des valeurs, il est nécessaire que le référentiel ne soit pas qu’individuel mais qu’il ait une portée collective, voire anthropologique. De manière générale, il semble bien que ce soit la collectivité des chercheurs qui a servi à Gonseth de paradigme pour étudier comment se constitue un référentiel collectif à partir de l’intégration de référentiels individuels. C’est ce qui apparaît dans cette citation : « Pour retrouver tous les attributs du référentiel individuel que nous avons engagé dans une triple genèse, il nous faudrait pouvoir encore parler avec quelque chance d’authenticité des exigences collectives de vérité et de réalité ainsi que de leur mise collective en situation. Encore une fois, n’est-ce pas vouloir aller trop loin ? Il suffit pour dissiper toutes les hésitations de faire appel à l’exemple privilégié que la constitution d’une méthode de la recherche met en place. C’est l’exemple de la collectivité des chercheurs. Son existence de fait ne saurait être mise en doute. Mais comment expliciter ses modalités d’existence et comment faire apparaître son projet d’exister ? Il ne faut pas chercher à le réduire à plus simple que lui. Dans sa concrétude, il est paradigmatique. Son projet d’exister, c’est d’exister pour la recherche. Elle s’actualise en conséquence. Et pour la question que nous venons de poser, elle fournit une réponse modèle, elle aussi paradigmatique. Elle illustre l’exigence de vérité et l’exigence de réalité par l’actualisation la plus aiguë que la recherche scientifique sait en faire. Et la méthodologie ouverte prétend fournir le paradigme de leur mise en situation, en les accordant selon les règles de la constitution et de la mise à l’épreuve des référentiels ». (Le référentiel, p. 195).
Savoir si le premier objectif de Gonseth, celui de fonder une philosophie qui soit à la hauteur du mouvement de la connaissance scientifique a bien été atteint n’est pas l’objet de mon propos aujourd’hui. Cela a été l’objet du colloque qui s’est tenu à Lausanne le 1er septembre 2018 sur la notion de référentiel selon Gonseth sous le parrainage des sociétés française et suisse de physique. Il nous y est apparu que la méthodologie développée par Gonseth correspond exactement avec celle qui est pratiquée par les physiciens au sein des grandes collaborations internationales et qui ont obtenu des succès spectaculaires dans les domaines de la physique de l’infiniment petit et de l’infiniment grand. Aujourd’hui, il me semble que ce que vous attendez de moi est plutôt que je me concentre sur le second versant de son objectif, celui de « se mesurer partout avec la science et ne jamais lui céder le terrain en toute propriété ».
Pour illustrer mon propos je partirais de son dernier ouvrage, Le référentiel, paru l’année de sa mort, 1975. A l’aide d’une série d’articles précédemment parus, il montre comment ce concept de référentiel lui permet d’une part d’étendre la méthodologie qu’il a développée en philosophie des mathématiques et des sciences de la nature à la philosophie des sciences humaines voire à la philosophie en général, tel est l’objet du chapitre référentiel et méthode, et d’autre part, en particulier dans le chapitre science, philosophie et foi¸ il engage un débat sans concession avec le grand scientifique qu’était Jacques Monod, sur la question de la légitimité de la foi.
« L’homme est un miracle sans intérêt » (Jean Rostand)
 Au début de ce chapitre, il évoque les propos désabusés qu’il a entendus sur une station de radio alors que deux des astronautes d’Apollo 15 venaient de se poser sur la lune : « Ces propos n’étaient pas ceux que j’attendais, mais il me semblait y reconnaître l’écho d’autres propos, de propos auxquels tous les moyens d’information avaient fait une rapide célébrité. La chose ne faisait aucun doute : la philosophie qui projetait son ombre sur ces commentaires désabusés, c’était celle du dernier ouvrage de Jacques Monod, Le Hasard et la Nécessité. Le fait m’avait longtemps laissé songeur ».
Au début de ce chapitre, il évoque les propos désabusés qu’il a entendus sur une station de radio alors que deux des astronautes d’Apollo 15 venaient de se poser sur la lune : « Ces propos n’étaient pas ceux que j’attendais, mais il me semblait y reconnaître l’écho d’autres propos, de propos auxquels tous les moyens d’information avaient fait une rapide célébrité. La chose ne faisait aucun doute : la philosophie qui projetait son ombre sur ces commentaires désabusés, c’était celle du dernier ouvrage de Jacques Monod, Le Hasard et la Nécessité. Le fait m’avait longtemps laissé songeur ».
Des propos qu’il rapproche de l’aphorisme du biologiste Jean Rostand, « L’homme est un miracle sans intérêt » et il va consacrer tout ce chapitre à argumenter contre la philosophie que suggèrent ces deux scientifiques. Il le fait à propos de la question qu’il appelle la question F, La foi est-elle encore légitime ? Et d’une autre question, qui n’est pas sans analogie avec elle, la question qu’il appelle la question F1, Toute morale n’est-elle pas arbitraire ? Toute l’argumentation de Gonseth repose sur le fait qu’aussi bien pour la philosophie, que pour la science ou que pour la théologie, les réponses que l’on peut apporter à ces questions dépendent de l’articulation du référentiel individuel de la personne qui répond à la question au référentiel collectif de sa discipline. Dans le cas de la science, il analyse et compare les positions de Jacques Monod et de ses deux co-lauréats du prix Nobel, André Wolf et François Jacob : « Ne pourrait-on supposer que les trois savants couronnés en commun pour une œuvre commune puissent former un forum restreint d’authenticité, un forum petit par le nombre, mais grand par la valeur ? Voici tout d’abord les titres des trois ouvrages qu’ils ont publiés récemment
André Wolf, L’Ordre biologique, juillet 1969.
François Jacob, La Logique du vivant, début 1970.
Jacques Monod, Le Hasard et la Nécessité, fin 1970.
Voici ce qu’écrit André Wolf sur les origines de la vie (p. 171) :
On ne sait rien de positif quant à l’origine de la vie. Et notre situation est, par conséquent, d’une certaine manière privilégiée.
Voici maintenant l’opinion de François Jacob (p. 345) :
Dans le monde inanimé, en effet, le hasard des événements peut être statistiquement prédit avec précision. Chez les êtres vivants, au contraire, indissolublement liés à une histoire qu’on ne peut connaître dans le détail, les déviations introduites par la sélection naturelle interdisent toute prédiction.
Et voici enfin la thèse de Jacques Monod (p. 194) :
L’ancienne alliance est rompue. L’homme sait enfin qu’il est seul dans l’immensité indifférente de l’univers d’où il a émergé par hasard. Non plus que son destin, son devoir n’est écrit nulle part. A lui de choisir entre le royaume et les ténèbres.
Si brèves soient-elles, ces trois citations constituent un dialogue d’une rare intensité. Une position d’ensemble s’en dégage-t-elle avec autorité ? Ce qui en ressort clairement, c’est, au contraire, une pluralité frappante de jugements irréductiblement différents. Que faut-il en conclure ? La diversité des opinions sur la plupart des sujets n’est-elle pas un phénomène courant ? La valeur des esprits en présence interdit, dans ce cas, une interprétation aussi banale. Ce qui en résulte, c’est que toute affirmation précise sur les origines de la vie ne peut être qu’une hypothèse, – une hypothèse dont la plausibilité n’est pas garantie par les faits dont on dispose par ailleurs. En d’autres termes, il existe entre les faits assurés et l’hypothèse une distance que l’esprit du chercheur doit franchir. Ce n’est pas là une démarche que la méthode scientifique interdit : dans la procédure en quatre phases de la méthodologie ouverte, la production  d’une hypothèse marque, tout au contraire, la deuxième phase de la procédure normale. Mais quels sont ceux auxquels revient de mesurer cette distance, d’apprécier avec quelque certitude le degré de plausibilité que les faits assurent à l’hypothèse ? Un certain nombre de spécialistes, dira-t-on peut-être. Mais comment interpréter leurs témoignages, s’ils ne s’entendent pas ? L’esprit qui franchit la distance le fait à ses risques et périls. Il peut arriver qu’il le fasse avec une géniale clairvoyance et que l’avenir lui donne raison. Mais il n’est pas exclu qu’il cède à des motivations subjectives plus ou moins obscures. »
d’une hypothèse marque, tout au contraire, la deuxième phase de la procédure normale. Mais quels sont ceux auxquels revient de mesurer cette distance, d’apprécier avec quelque certitude le degré de plausibilité que les faits assurent à l’hypothèse ? Un certain nombre de spécialistes, dira-t-on peut-être. Mais comment interpréter leurs témoignages, s’ils ne s’entendent pas ? L’esprit qui franchit la distance le fait à ses risques et périls. Il peut arriver qu’il le fasse avec une géniale clairvoyance et que l’avenir lui donne raison. Mais il n’est pas exclu qu’il cède à des motivations subjectives plus ou moins obscures. »
Morale(s) et société
Se refusant à nier la pluralité de fait des morales, Gonseth « voit se préciser et se nuancer la réponse à donner à la question F 1 : la pluralité des morales n’entraîne pas que toute morale soit arbitraire. Ce qui est arbitraire, c’est de poser que tout être humain normalement évolué puisse être dénué de tout sens moral, – et c’est aussi de prétendre qu’une société puisse s’ordonner sans le respect d’un certain ensemble de valeurs morales. » Ce qui lui permet de répondre à l’affirmation de Jacques Monod, disant de tout homme non plus que son destin, son devoir n’est écrit nulle part
« Il y a un ‘quelque part’ où la contrainte de l’obligation morale est inscrite en nous, avec une certaine liberté de l’enfreindre. C’est le domaine où se complètent l’un par l’autre les univers conjoints de la subjectivité et de la socialité. »
Quant à la question F, il l’aborde en conclusion du chapitre : « Dans le cas de la morale, la pluralité des morales qui couvrent le monde fait positivement la preuve de l’exigence de moralité. On peut en dire autant de la nécessité existentielle d’une foi si imprécise soit-elle. Cette nécessité s’exprime à la fois subjectivement et collectivement, par les mysticismes et par les fanatismes, par les rites, les cultes et les institutions, etc. Comment en faire le tour ? C’est l’humanité tout entière dans son immense et chaotique diversité qui devrait être appelée à témoigner.
« Credo quia absurdum »
C’est en face de cette diversité qu’il faut se placer pour comprendre à quelle condition il est possible de donner, pour tous à la fois, une réponse valable (et positive) à la question F. Cette condition n’est pas de promouvoir telle ou telle spécification de la foi au-dessus et au-delà de toutes les autres. C’est bien plutôt de renoncer à engager l’affirmation dans les précisions qui ne peuvent qu’en affaiblir le sens. Ce qu’il importe de savoir, c’est qu’il n’existe rien au monde qui puisse compenser, pour la créature et pour l’ensemble des créatures, l’annulation progressive de toute foi.
J’ai souvent répété – paraphrasant peut-être le Credo quia absurdum – que la foi, c’est ce qui doit s’ajouter à tout pour que tout ne soit pas absurde.
tout pour que tout ne soit pas absurde.
C’est là, je le crois, l’essentiel de la réponse qu’il importe de faire à la question F.
Partant de l’aphorisme de Monod selon lequel le sujet est un objet porteur d’un projet d’exister, Gonseth attribue au référentiel la fonction d’organe du sujet lui permettant de mettre en œuvre son projet d’exister, ce qui l’amène à conclure son ouvrage sur une idée-clef qu’il expose dans son incomplétude radicale : « La fonction du référentiel est implacablement double. Il met d’une part, le projet d’exister en situation, donnant forme  aux conditions du pouvoir-être et à l’obligation du devoir-être. D’autre part, le projet qu’il conditionne ainsi n’est pas un projet quelconque, c’est un projet d’exister. C’est pourquoi à travers le projet, par-delà le projet, c’est l’existence même de celui par qui le projet s’effectue qu’il conditionne. C’est là le fait essentiel dont je ne crois pas avoir encore épuisé la leçon ».
aux conditions du pouvoir-être et à l’obligation du devoir-être. D’autre part, le projet qu’il conditionne ainsi n’est pas un projet quelconque, c’est un projet d’exister. C’est pourquoi à travers le projet, par-delà le projet, c’est l’existence même de celui par qui le projet s’effectue qu’il conditionne. C’est là le fait essentiel dont je ne crois pas avoir encore épuisé la leçon ».
Admirable conclusion à laquelle, comme un écho, répond ce non moins admirable exposé synthétique de la pensée de Teilhard de Chardin fait par Madeleine Barthélémy-Madaule dans Science et Synthèse : « Tandis que les savants objectivaient l’homme sous sa forme physique (car après tout nous sommes des corps physiques, nous pouvons tomber dans le vide), et biologique (car nous sommes biologie), anthropologique même (car nous sommes encore objectivés au niveau anthropologique), tandis que les savants ‘émiettaient’ le phénomène humain, les philosophes plaçaient l’homme dans une espèce de transcendance royale. C’était le sujet qui ne s’objective jamais, qui transcende le monde sous les espèces d’une philosophie de l’éternité !
Quel est le sens, quelle est la valeur de la condition humaine ?
Eh bien, tout cela, c’était partiel, c’était erroné. Le Père Teilhard a invité le sujet humain à se regarder comme objet, à regarder, à interroger l’homme-objet ; et l’étincelle oscillante de sa dialectique synthétique est allée du sujet qu’il était à l’homme-objet ; puis est revenu, avec tout ce que l’homme-objet lui avait livré, à travers les sciences humaines et les sciences de la nature, sur le sujet, pour s’interroger à nouveau.  Le sujet se dit à lui-même : Puisque c’est cela, les hommes, puisque c’est cela que nous sommes, qu’allons-nous faire dans l’avenir ?’ Nous voyons jouer cette dialectique où l’homme, tour à tour, s’extériorise par rapport à lui-même, se regarde au miroir de l’objectivité, et tout d’un coup se retourne vers soi, se recueille et s’interroge anxieusement. ‘Quel est mon sens ? Qu’est-ce que c’est la condition humaine ? Où est-ce que je vais ?’
Le sujet se dit à lui-même : Puisque c’est cela, les hommes, puisque c’est cela que nous sommes, qu’allons-nous faire dans l’avenir ?’ Nous voyons jouer cette dialectique où l’homme, tour à tour, s’extériorise par rapport à lui-même, se regarde au miroir de l’objectivité, et tout d’un coup se retourne vers soi, se recueille et s’interroge anxieusement. ‘Quel est mon sens ? Qu’est-ce que c’est la condition humaine ? Où est-ce que je vais ?’
Cette dialectique peut paraître naïve à certains, il n’en est pas moins vrai qu’elle est essentielle aux hommes, que les hommes ne peuvent pas vivre sans se poser ces questions : ‘Où vais-je, d’où est-ce que je viens ? Quel est le sens, quelle est la valeur de la condition humaine ?’ Mais maintenant, les hommes sont obligés de se poser cette question à travers le miroir des sciences anthropologiques et des sciences de la nature ; et c’est pourquoi la synthèse teilhardienne, loin d’être périmée, indique l’avenir et lui trace tout un programme de travaux, tout un programme de mise à l’épreuve ».
De nombreuses réflexions et questions des participants à ce petit déjeuner sont venues nourrir l’échange qui a suivi l’intervention de Gilles Cohen-Tannoudji.
 Entrée Ferdinand Gonseth Dictionnaire des philosophes, p. 1164-1167 (PUF 1993) (document au format PDF)
Entrée Ferdinand Gonseth Dictionnaire des philosophes, p. 1164-1167 (PUF 1993) (document au format PDF)


