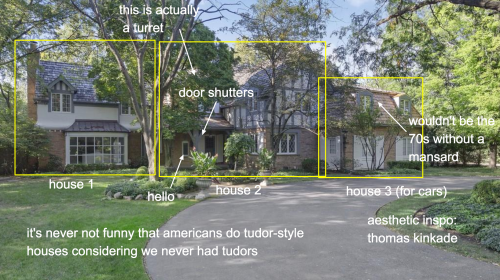LES OBJETS DE LUDWIG WITTGENSTEIN
Olivier Berggruen
« Les questions scientifiques peuvent m’intéresser, elles ne peuvent jamais me captiver réellement. Seules le peuvent les questions conceptuelles et esthétiques. La solution des problèmes scientifiques m’est au fond indifférente ; mais il n’en va pas de même pour les deux autres sortes de questions. » [RM, 1949, p.153]
« Je voudrais dire : il y des aspects qui sont principalement déterminées par pensées et associations, et d’autres qui sont « purement optiques ». » [RPPI, 970]
L’éducation esthétique de Wittgenstein
Gustav Klimt, Portrait de Margaret « Gretl » Stonborough-Wittgenstein, 1905, huile sur toile, 180 × 90 cm, Munich, Neue Pinakothek
Wittgenstein est né à Vienne dans un milieu hautement artistique, à l’époque où l’empire austro-hongrois était à son apogée. Son père, Karl Wittgenstein, était un grand industriel vivant quelque peu en retrait de la société viennoise, peut-être à cause des lointaines origines juives de la famille. Plus tard dans sa vie, Wittgenstein n’a pas souvent évoqué l’environnement privilégié et isolé dans lequel il a grandi.
La maison sur la Alleegasse était grandiose, les intérieurs étaient décorés par de lourdes tapisseries, avec des portraits du peintre à la mode Philip de Laszlo, ainsi que des œuvres de Segantini, Rudolf von Alt, des sculptures de Rodin, et le buste de Beethoven par Max Klinger. Ce lieu, surnommé avec une pointe d’ironie le Palais Wittgenstein, a été le siège de nombreux concerts privés, en présence de grands musiciens tels que Johannes Brahms et le violoniste Joseph Joachim. Il y avait au moins sept pianos à queue dans le Palais Wittgenstein, et la famille aimait à se retrouver dans l’imposant salon de musique. Quant à la sœur de Ludwig, Gretl, elle avait été peinte avant la grande guerre par Gustav Klimt.
On ne peut suffisamment insister sur l’atmosphère de dévotion artistique qui caractérise les Wittgenstein. Ce sont eux qui réunirent les fonds nécessaires à la construction de la Wiener Secession, le chef-d’œuvre de Josef Maria Olbrich. Mais très vite, Ludwig Wittgenstein s’est tourné vers la philosophie. Après avoir demandé conseil à Gottlob Frege, le grand logicien et mathématicien allemand, il s’est installé en Angleterre pour étudier la philosophie avec Bertrand Russell, dont le travail sur la logique l’avait impressionné. Cependant, son intérêt pour l’esthétique ne s’est jamais estompé.
Le salon de musique du Palais Wittgenstein au 16 de l’actuelle Argentinierstraße à Vienne en 1910
La Grande Guerre a été catastrophique pour la famille. Trois des frères de Ludwig sont morts, et lui a survécu dans des circonstances précaires dans un camp de prisonniers en Italie. Après sa libération, il s’est rebellé contre son milieu, a voulu se débarrasser de sa fortune, pour devenir un ascète à la manière du comte Tolstoï, dont l’adaptation des Évangiles l’avait profondément marqué pendant la guerre. À cette époque (1918), il cesse de pratiquer la philosophie et se tourne vers d’autres activités, devenant instituteur dans plusieurs villages de Basse-Autriche au début des années vingt, et travaillant également comme jardinier.
Tout cela, après la publication du Tractatus, qu’il avait commencé à rédiger dans les tranchées, et avec lequel il pensait avoir résolu la plupart des problèmes philosophiques.
La maison de Wittgenstein
« Souviens-toi de l’impression que t’a faite une bonne architecture, à savoir l’impression d’exprimer une pensée. Elle aussi, on aimerait la suivre du geste. » [RM, circa 1932-1934, p. 79]
Maison Wittgenstein par Paul Engelmann et Ludwig Wittgenstein, 1927-1928, Vienne, Kundmanngasse
En examinant la vie de Wittgenstein, il apparaît évident qu’il mène ses activités d’ingénieur, de jardinier, d’ambulancier (pendant la seconde guerre mondiale) ou de philosophe avec obstination et dévouement. Son travail d’architecte reflète la même éthique ; bien qu’il n’ait eu aucune formation véritable, lorsque sa sœur Margarethe (Gretl) lui demande de travailler à la construction de sa maison, il envisage cette tâche de la manière la plus exigeante, sans dévier du très haut niveau qu’il se fixe.
La genèse de la maison est connue : après des années d’exil imposé dans des villages reculés de Basse-Autriche, Wittgenstein commence à travailler à la maison de la Kundmanngasse en 1926. En fait, Gretl avait accordé la commande à Paul Engelmann, un étudiant d’Adolf Loos ami de Wittgenstein depuis leur parcours commun dans l’armée austro-hongroise. Tous deux vénèrent le modernisme classique et rigoureux de Loos.
Détails des fenêtres de la maison Wittgenstein par Paul Engelmann et Ludwig Wittgenstein, 1927-1928, Vienne, Kundmanngasse
Wittgenstein a gardé des plans de son ami les volumes et l’armature générale, tout en changeant et en affinant la conception architecturale, les proportions des pièces, la plupart des détails architecturaux, tels que les fenêtres, portes, poignées, radiateurs, une multitude de détails qui lui semblaient indispensables à la réussite de l’architecture de la maison. Dans l’ensemble, sa contribution fut beaucoup plus grande que ce qui est généralement reconnu. Wittgenstein a également contribué à des solutions techniques coûteuses mais originales et efficaces, telles que le système invisible de poulies pour les stores. Les murs étaient en stuc, parce que Wittgenstein voulait maintenir un aspect plus ou moins égal entre le plancher et les autres surfaces telles que les murs. Les doubles fenêtres étaient verrouillées de l’intérieur par des espagnolettes.
Ces modifications reflètent l’esthétique dépourvue d’ornementation qu’Adolf Loos avait inaugurée. Il existe un certain nombre d’anecdotes sur les excentricités de Wittgenstein pendant la construction de la maison : prenant plus d’un an pour concevoir les poignées de portes et les radiateurs, la réalisation d’un rideau de métal pesant cent cinquante kilos servant à être abaissé à l’étage inférieur, son insistance au tout dernier moment pour élever le plafond du salon de trente millimètres, de sorte que les proportions de la maison puissent être exactement ce qui avait initialement envisagé. D’après certains témoignages, la maison, une fois achevée, était imposante par son classicisme sévère, ce qui n’en faisait pas un lieu particulièrement accueillant. Il semble quelque peu incongru mais compréhensible que Gretl ait meublé la maison avec des chaises confortables et démodées de style Biedermeier. Pour sa part, Wittgenstein avait conçu ses appartements à l’université de Cambridge en toute simplicité, néanmoins, avec un coûteux mobilier fait sur mesure suivant ses indications.
Intérieur de la maison Wittgenstein par Paul Engelmann et Ludwig Wittgenstein, 1927-1928, Vienne, Kundmanngasse
Le travail de Wittgenstein en tant qu’architecte définit ses perspectives dans d’autres domaines artistiques qui lui étaient chers. Dans l’esprit de Loos, il affirme son dégoût pour l’ornementation. Au lieu de cela, il préconise des formes dépouillées et discrètes qui sont en accord avec ses idées philosophiques. Si nous lisons les écrits de Loos, Ornement et Crime, en particulier, l’ornementation est considérée comme superflue et en proie aux mouvements de mode indésirables, avec quelque chose de quasi-maladif en ce qui concerne le style gonflé et le déclin de l’architecture fin-de-siècle à Vienne. Loos n’a jamais complètement abandonné l’ornementation, mais pensait qu’elle devait être adaptée au contexte des surfaces et des matériaux architecturaux.
Si la beauté austère de la maison est en accord avec la « poésie logique » du Tractatus, pouvons-nous établir un parallèle entre son architecture et ses activités philosophiques ? Dans quelle mesure la construction de la maison reflète-t-elle l’approche philosophique de Ludwig Wittgenstein, son désir de clarifier des pensées parfois confuses ? À cet égard, nous savons que dans ses conférences, il était souvent angoissé par son incapacité à exprimer, à communiquer ses idées.
Michael Drobil, Büste von Ludwig Wittgenstein (Buste de Ludwig Wittgenstein), vers 1926-1928, marbre blanc, h. : 44 cm, coll. part.
Dans son austère conception, cette maison contient un paradoxe. La vie de Wittgenstein était remplie de tels paradoxes – au cœur même du Tractatus. Malgré sa sévérité solennelle, la maison ne semble pas menaçante ; elle est le contraire de l’agressivité qui caractérise une certaine architecture moderniste. Elle dégage un sentiment d’harmonie et de paix même, choses que Wittgenstein avait sans doute les plus grandes difficultés à vivre.
D’autre part, son architecture témoigne de l’importance de la notion de style dans son travail ; le style comme l’incarnation d’une certaine attitude éthique ; de l’affinement des formes et du désir d’améliorer les travaux qui précèdent. À cette époque (1926-1928), Wittgenstein visite l’atelier du sculpteur Michael Drobil. Celui-ci exécute son portrait en buste et à son tour Wittgenstein crée un plâtre d’une jeune femme inspiré par l’œuvre de son maître.
Ludwig Wittgenstein, Mädchenkopf (Tête de jeune fille), 1927, terre cuite, h. : 39,5 cm, coll. part.
Accentuant l’aspect géométrique des formes, le buste peut être considéré comme la tentative de correction d’une sculpture précédente de Drobil. Les traits du visage sont empreints de cette beauté austère et sereine en accord avec la tradition grecque que Wittgenstein admirait tellement. Ici nous avons le sentiment que la pratique artistique de Wittgenstein était liée à son œuvre de philosophe, tant cette optique est thérapeutique, tout comme en philosophie, elle devient le moyen de se libérer des pièges du langage et des confusions philosophiques, de nos inclinations métaphysiques. En fin de compte, cette esthétique épurée reflète chez Wittgenstein ce désir de guérison et de purification.
Esthétique
L’attention esthétique est dirigée vers une variété d’objets – une chaise, un tissu funéraire, un diadème, une œuvre d’art, la neige qui tombe. Le domaine esthétique est traditionnellement défini comme appartenant au domaine purement sensoriel. Dans quelle mesure la sensation est-elle susceptible d’être étudiée de façon indépendante ? Voilà une question philosophique (remontant à Kant qui définit l’esthétique en tant que plaisir désintéressé et fait place à l’aspect sensuel des choses), que Wittgenstein traite d’une façon ambiguë.
Pour Wittgenstein, l’esthétique est formée par les coutumes, les traditions, les formes de discours. Elle se définit par une communauté d’individus dont l’existence est inscrite dans un espace social et géographique. Dans la Conférence sur l’esthétique, Wittgenstein remarque que l’appréciation esthétique est relative. Il prend pour exemple un masque nègre et l’habit cérémoniel du roi Edouard VII d’Angleterre. Pour voir le masque comme le fait un Africain, il faut le voir dans l’espace et dans le temps, dans un cadre social et historique : « Vous appréciez [chaque œuvre] d’une manière entièrement différente. Votre attitude a quelque chose de complètement différent de ce qu’un homme en faisait alors. » [LC, English version, p. 8-9].
Les règles sont internes à nos pratiques culturelles ; une certaine familiarité avec ces règles peut nous donner une idée plus précise de ce qu’est l’appréciation esthétique. Par exemple, pour un collectionneur d’art qui a appris à dessiner ou un amateur d’opéra qui joue du piano – cela peut également porter sur des connaissances techniques dans un autre domaine. Dans cette perspective, le plaisir esthétique est lié à la prise de conscience des règles – il constitue un ensemble de connaissances plus ou moins raffinées. [Cf RM, 28-29, 84; Z, 164]
« […] Si je n’avais pas appris les règles, je ne serais pas en mesure de porter un jugement esthétique. En apprenant les règles, vous arrivez à un jugement plus affiné. Apprendre les règles change effectivement votre jugement. (Bien que, si vous n’avez pas appris l’harmonie et si votre oreille n’est pas bonne, vous pouvez cependant détecter une dissonance dans une séquence d’accords.) » [LC, I, § 15, p. 23]
Cette manière de voir les choses a des ramifications ici, en France, en particulier à travers la figure de Pierre Bourdieu. Comme nous le savons, Bourdieu a abondamment lu Wittgenstein pour arriver à la conclusion que les jugements de goût sont toujours intéressés. Pour le sociologue français, notre appréciation artistique ne peut pas être dissociée de l’arrière-plan culturel qui en est le fond, ce fond qui détermine nos attentes. La compréhension est donc dépendante de paradigmes culturels, et que nous le sachions ou non, nous suivons les règles déposées dans nos jeux de langage et dans nos pratiques culturelles. En fin de compte, la « socialisation de l’esthétique » à laquelle se livre Bourdieu conduit à la non-existence du domaine esthétique. À ce sujet, Wittgenstein est ambigu et nous donne des positions contradictoires. Il dit par exemple que la compréhension n’est pas nécessairement liée à celle des règles, bien que la connaissance de règles explicites puisse favoriser notre jugement esthétique. [Cf Z, 164]
Ici, nous courons le risque de confusion entre l’existence de sensations purement esthétiques – ou de la possibilité de telles sensations –, et ce à quoi la sensation esthétique est appliquée, c’est-à-dire l’objet intentionnel que nous évaluons, qui est susceptible de changer au fil du temps et des cultures. Mais ces changements, tout comme notre évaluation de l’art de Guido Reni ou de Rosa Bonheur, ne signifient pas que la chose (la sensation esthétique) n’existe pas.
Le contextualisme de Wittgenstein doit pourtant être nuancé à la lumière de certains passages de la Conférence sur l’éthique et des Remarques mêlées. Voir quelque chose d’un point de vue esthétique consiste à voir dans l’absolu, « en dehors » de l’espace et du temps. C’est ce que nous appelons la vue sub specie aeternitatis. De ce point de vue, l’expérience esthétique implique le domaine du sensible, et l’œuvre d’art est vue avec le monde entier comme toile de fond (et non pas seulement la sphère culturelle et sociale). [Cf C, 7/10/1916]
Une distinction vaut sans doute la peine d’être faite entre un point de vue qui prend les jugements esthétiques au sérieux mais considère que leur validité est liée à des faits locaux, contre une vue plus cynique au sujet de l’existence même des jugements et des expériences esthétiques : considérant l’ensemble de nos activités d’évaluation comme un jeu cynique de pouvoir hiérarchique, d’exclusion et d’inclusion – je dois cette réflexion à Paul Boghossian.
De plus, il est possible de défendre une certaine forme d’objectivité esthétique au-delà du temps et des cultures. Ce qui s’offre au regard (l’œuvre d’art) n’est pas forcément culturellement indexé, à savoir que l’appréciation esthétique dépasse le cadre d’un contexte social et historique. Par exemple, il peut y avoir des traces initiales de goût, d’une conscience esthétique, chez de très jeunes enfants, un goût sans doute élémentaire, mais qui trahit une maîtrise des catégories esthétiques – chez les enfants, nous constatons la présence de réponses émotives à la perception de formes simples, couleurs, sons, textures, et de telles réponses engendrent les émotions correspondantes. La connexion stimuli – réponse émotive semble obéir à des règles, et c’est ici que l’esthétique trouve sa place.
Certains commentateurs affirment qu’au fil des années, les positions de Wittgenstein se rapprochent du relativisme. C’est peut-être vrai. Cependant, si nous lisons attentivement les Leçons de 1938, par exemple, le fait que nous voyons des objets artistiques sous une perspective anthropologique ou historique ne nous empêche pas de les voir esthétiquement, en dehors de l’espace et du temps. Il y a là un changement de perspective. Une réponse relativement facile consiste à affirmer que si la justesse d’un jugement de goût est liée aux pratiques locales, dans la mesure où celles-ci sont partagées par d’autres cultures, un jugement esthétique peut traverser les frontières entre ces cultures (la même chose vaut pour un point de vue relativiste en éthique).
Ce dernier point nous amène à autre notion importante chez Wittgenstein, le changement d’aspect (Aspekt-Wechsel). Il s’agit d’assimiler la compréhension à une saisie ou à une configuration globale. Un morceau de musique s’entend d’une certaine manière, comme une valse ou comme un menuet, et une toile se voit comme une peinture de genre ou un paysage romantique. Wittgenstein utilise parfois la notion d’Aufleuchten, pour désigner la façon dont nous reconnaissons une configuration qui nous est familière dans un tableau. L’approche en termes de voir comme illustre la façon dont nous regardons une œuvre d’art, la façon d’écouter un morceau de musique.
Saisir les différents aspects d’une même œuvre d’art nous conduit à renoncer à la notion d’une signification fixée d’avance au profit d’une analyse attentive de la compréhension. Ce qui émerge est une notion de l’esthétique non seulement comme discours sur l’art, mais en termes plus généraux, comme relation entre le spectateur et l’œuvre d’art. « Cela signifie que l’impression principale est l’impression visuelle. Oui, c’est l’image (le tableau) qui semble importer le plus. Les associations peuvent varier, les attitudes peuvent varier, mais modifiez l’image très légèrement, et vous ne voudrez plus la regarder du tout. » [LC, IV, § 12, p. 78] Différentes pensées et émotions sont associées à différentes peintures. Nous pourrions avoir toutes ces pensées par le truchement d’un autre tableau, mais nous voudrions toujours voir le tableau d’origine.
La compréhension
« Afin d’y voir clair en ce qui concerne les expressions esthétiques, vous devez décrire des façons de vivre. Nous pensons que nous avons à parler de jugements esthétiques tels que « ceci est beau », mais nous constatons que si nous avons à parler de jugements esthétiques, nous ne trouvons pas du tout ces mots-là, mais un mot qui est employé à peu près comme un geste, accompagnant une activité compliquée ». [LC I, § 35, p. 33]
Les Conférences sur l’esthétique (1938) nous donnent une idée précise de la méthode philosophique de Wittgenstein. En se livrant à l’analyse conceptuelle du langage et de la signification, il nous invite à comprendre la forme des mots. En même temps, il nous met en garde contre diverses formes de discours métaphysiques. Les propos de Wittgenstein affichent un rejet des théories et de l’esthétique en tant que discipline. Il ne souhaite pas répondre aux questions traditionnelles telles que la définition de l’œuvre d’art, ce qui constitue, le beau, comment l’œuvre d’art exprime les sentiments de l’auteur, etc. Quand il parle d’appréciation esthétique, Wittgenstein souligne la variété des formes qu’elle prend. La compréhension est non seulement transmise par les mots, mais aussi par les actions, les gestes, etc.
Les signes, gestes et impressions physiques ne sont pas la compréhension même, mais ils l’incarnent. Tout ce que nous pouvons décrire, selon Wittgenstein, ce sont les signes de cette compréhension. Bien entendu, la compréhension ne doit pas être assimilée aux gestes, mots et mouvements, mais constitue son expression extérieure. [Voir PI, § 332.]
« Supposons que quelqu’un que vous rencontrez dans la rue vous dise qu’il a perdu son plus grand ami, d’une voix très expressive de son émotion. Vous pourriez dire : « C’était extraordinairement beau, sa façon de s’exprimer. » Supposons que vous demandiez alors : « Quelle similitude y a-t-il entre mon admiration pour cette personne et le fait que j’aime la glace à la vanille? » La comparaison semble presque dégoûtante. (Mais vous pouvez relier les deux cas à l’aide de cas intermédiaires). » [LC, II, § 4, p. 34]
L’utilisation de cas intermédiaires pour comprendre nos réactions esthétiques est liée à la notion de ressemblances familiales, qu’il développe dans les Investigations philosophiques. Il s’agit d’une méthode comparative, plutôt que de la recherche d’une essence. Ce qui importe est la vue synoptique. [Cf Investigations philosophiques, § 92]
Une telle approche peut être qualifiée de morphologique, dans l’esprit des travaux sur l’histoire naturelle de Goethe, puisque la morphologie est orientée vers une vue d’ensemble de l’utilisation des expressions particulières. Il s’agit de privilégier la description par rapport à l’explication, l’aperçu synoptique (Übersichtliche Darstellung) plutôt que la formulation d’hypothèses. L’esthétique devrait insister sur « certaines comparaisons, le regroupement de certains cas ». [LC, p. 29 ; PI, 24, 291]
Vers et serpents
J’aimerais conclure par un aphorisme énigmatique de 1931 :
« Un beau vêtement qui se métamorphose (pour ainsi dire se coagule) en un enchevêtrement de vers et de serpents lorsque celui qui le porte se regarde avec suffisance dans le miroir… » [RM, 1931, p. 78]
Ludwig Wittgenstein (26 Avril 1889-29 Avril 1951)
Pour Wittgenstein, mis à part l’importance fondamentale de l’art dans sa vie – ce que nous pourrions appeler la grande tradition de l’art occidental – qui est à la source de nombreuses remarques restées privées et des conférences de 1938, il y a néanmoins autre chose. Pour lui, l’affinement des sens était essentiel, et lié à la question du style. Et une absence de style est atteinte une fois que le vêtement a été transformé en vers et en serpents. Le sentiment des règles est très important ainsi que la conviction qu’au-delà de leur apprentissage nous pouvons les surpasser. Une telle affirmation s’inscrit dans la lignée du romantisme, et nous la trouvons déjà chez Philipp-Otto Runge, qui déclare que pour réussir en tant qu’artiste, il faut redevenir enfant et désapprendre les règles qui nous ont été inculquées. Chez Wittgenstein, nous avons la conviction que l’art, tout comme l’écriture, doit être simplifiée. Les excès de l’art baroque et Rococo lui déplaisaient, lui qui aimait le classicisme de la statuaire grecque, l’architecture de Loos, la musique de Mozart et de Brahms (par opposition à Wagner et Mahler). C’est peut-être l’occasion d’établir un parallèle entre Wittgenstein et les discours de Joshua Reynolds – d’après mes connaissances, Wittgenstein ne l’a jamais lu. Dans son troisième Discours du 14 décembre 1770, il compare l’apprentissage de l’art (la peinture) à celui d’une langue.
« Je ne peux pas m’empêcher de soupçonner que les Anciens avaient une tâche plus facile que les Modernes. Ils avaient probablement peu ou rien à désapprendre, puisque leurs coutumes s’approchaient presque de cette simplicité désirée; alors que l’artiste moderne, avant d’entrevoir la vérité des choses, est obligé de retirer un voile, que la mode de l’époque souhaite recouvrir. »
Dans ses Discours, Reynolds s’est inspiré de Hogarth, qui avait publié son Analyse de la beauté (Analysis of Beauty) en 1753. Hogarth conçoit une morphologie de la perception du monde naturel, des objets quotidiens et des œuvres d’art ; à la base, les formes obéissent à la ligne de beauté serpentine, et l’on comprend que le langage de l’art soit inspiré par la nature. The « Analysis of Beauty » rend le monde plus lisible et lui donne une dimension esthétique. Tout comme une lettre de l’alphabet annonce le mot, le gribouillis d’un enfant anticipe la beauté avant même qu’elle soit structurée par la connaissance des règles. Une telle vision est hiérarchique, avec l’art antique au sommet, car c’est bien la langue originelle des Anciens qui doit servir de guide. Comme le montrent les écrits de Michael Baxandall sur la Renaissance italienne, harmonie et clarté du dessin et de la conception étaient jugées essentielles à l’époque, et cette injonction de développer un style décanté est importante dans la mesure où ce travail de purification stylistique a une vertu thérapeutique. La fixation sur la manière de construire les choses, d’en découvrir l’armature ou la structure, le sens des proportions, l’équilibre, l’harmonie des ordres architecturaux grecs, tous ces concepts que l’on trouve chez l’historien d’art Heinrich Wölfflin, sont de la plus grande importance pour Wittgenstein. Les principes de l’art et de l’architecture antiques sont fondateurs.
« On peut restituer en quelque sorte un style ancien dans une nouvelle langue ; on peut, pour ainsi dire le jouer dans un tempo qui soit à la mesure de notre époque. […] Mon idée n’est pas de traduire un ancien style dans un nouveau langage. Il ne s’agit pas de prendre d’anciennes formes et de les ordonner selon les exigences du goût nouveau. Ce dont il s’agit en réalité, c’est de parler, peut-être inconsciemment, la langue ancienne, mais de la parler de manière à ce qu’elle appartienne au monde moderne, sans pour autant appartenir nécessairement au goût de celui-ci. » [RM, p. 127-128. Traduction légèrement modifiée]
L’analogie est ici frappante avec la notion de style, mais aussi dans l’articulation entre langage et style ; goût et mode sont impermanents, alors que le langage et le style perdurent. Ces derniers sont comme un fil conducteur entre présent et passé ; ils s’incarnent moins dans le fonctionnalisme du Bauhaus, que dans le classicisme de la Maison Wittgenstein. Cela nous montre que l’attitude du philosophe face à son environnement est fondée sur deux notions communes : l’idée que l’architecture et l’espace conçus dans la civilisation antique, avec ses ordres, ses idéaux de symétrie, ces principes sont basés sur des relations spatiales en accord avec nos sensations corporelles ainsi que mathématiques, et le fait que ces notions reposent sur des principes esthétiques qui traversent le temps et les cultures. Dans cette perspective, il va sans dire que les objets ne sont pas des présences mortes, tant qu’ils ne répètent pas les formes du passé, mais appliquent ces principes fondateurs à nos besoins et à nos capacités.
Abréviations
RM : Remarques mêlées (1978), édité par Georg Henrik von Wright et Heikki Nyman, présentation par Jean-Pierre Cometti, traduit par Gérard Granel, Paris, Flammarion, 2002.
RPPI : Remarques sur la philosophie de la psychologie (1980), tome I, édité par Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe et G. H. von Wright, traduit par Gérard Granel, Mauvezin, Trans-Europ-Repress, 1998.
LC : Leçons et conversations sur l’esthétique, la psychologie et la croyance religieuse (édition originale établie par Cyril Barrett, Oxford, Basil Blackwell, 1966), Paris, Gallimard, 1971.
C : Carnets, 1914-1916 (1961), trad. Gilles-Gaston Granger, Paris, Gallimard, 1997.
Z : Zettel (1967), édité par G. E. M. Anscombe et G. H. von Wright, traduit par G. E. M. Anscombe, Oxford, Basil Blackwell, 1981 (2e éd.).
Bibliographie
Pierre BOURDIEU, La Distinction, Critique sociale du jugement, Paris, Minuit, 1979.
Malcolm BUDD, Aesthetic Essays, Oxford, Oxford University Press, 2008.
Bernhard LEITNER, The Wittgenstein House, New York, Princeton Architectural Press, 2000.
Adolf LOOS, Ornement et Crime (1908), traduit par Sabine Cornille et Philippe Ivernel, Paris, Payot & Rivages, 2003.
Joshua REYNOLDS, Discourses on Art, édition établie par Robert R. Wark, Londres, Paul Mellon Centre for Studies in British Art, 1975.
Paul WIJDEVELD, Ludwig Wittgenstein Architect, Amsterdam, The Pepin Press, 1993.
Ludwig WITTGENSTEIN, Tractatus Logico-Philosophicus (1921), traduit par G. G. Granger, Paris, Gallimard, 2001.
_____, Recherches philosophiques (1953), traduit par Françoise Dastur, Maurice Élie, Jean-Luc Gautero, Dominique Janicaud, Élisabeth Rigal, Paris, Gallimard, 2005.
Je tiens à remercier Antonio Damasio et en particulier Paul Boghossian pour leurs commentaires au sujet d’une version antérieure de ce texte. Que soit également remerciée Anunciata von Liechtenstein pour son rôle dans la préparation de cette présentation .
Olivier Berggruen, né en Suisse en 1963, a fait ses études à Paris, puis en histoire de l’art à Brown University, Providence, Rhode Island, puis au Courtauld Institute of Art à Londres. De 2001 à 2007, il a été conservateur associé à la Schirn Kunsthalle de Francfort. Auteur de The Writing of Art (Pushkin Press, 2011), il prépare actuellement une rétrospective sur Picasso et les Ballets Russes aux Scuderie del Quirinale à Rome en 2017.
Olivier Berggruen s’intéresse au statut des objets chez Ludwig Wittgenstein dont il suit à la fois la pensée et les conditions d’existence. Il montre pourquoi il ne faut pas oublier qu’il ne fut pas seulement philosophe mais jardinier, ambulancier et ingénieur, auteur en partie d’une maison pour sa sœur dans la Kundmanngasse, à partir de 1926. Le traitement des choses et du moindre détail dans son architecture a non seulement son importance mais il éclaire d’un jour nouveau ses perspectives dans les domaines artistiques et philosophiques. Son goût du dépouillement ne veut pas dire qu’il ne prête pas attention à une variété d’objets, bien au contraire.
Laurence Bertrand Dorléac