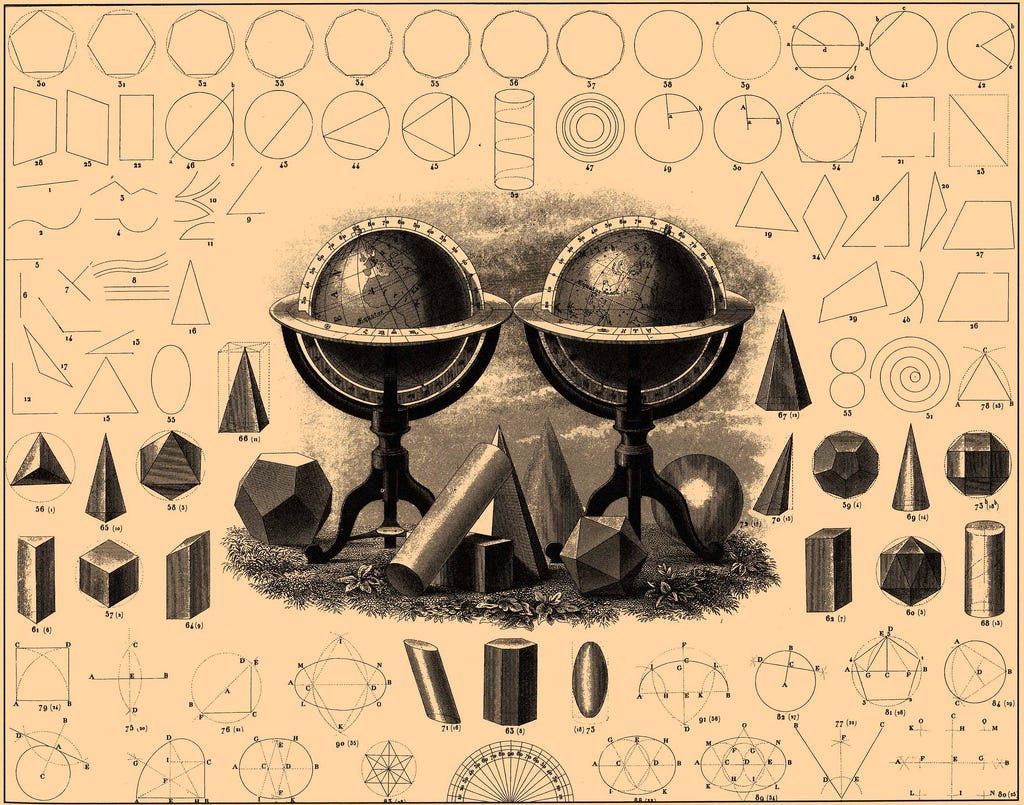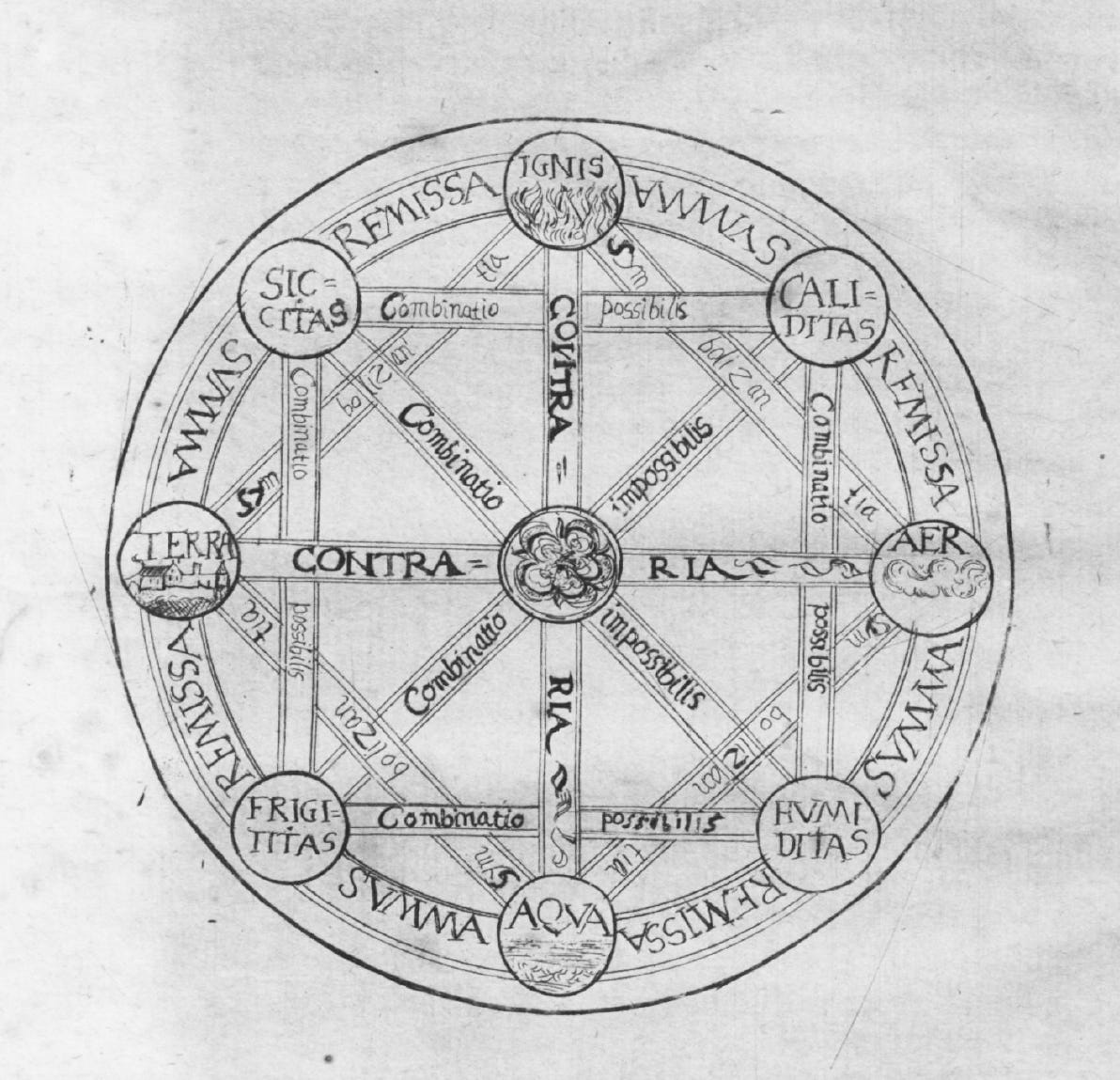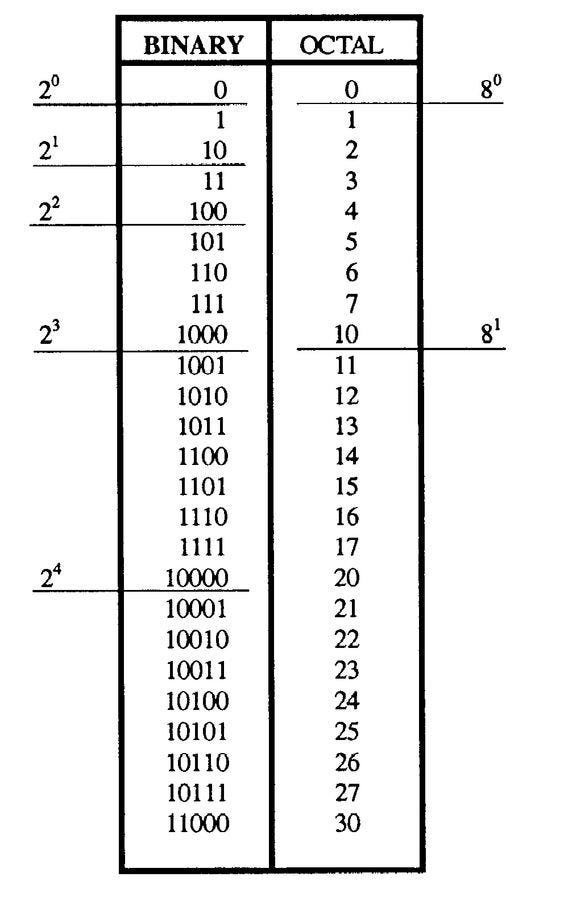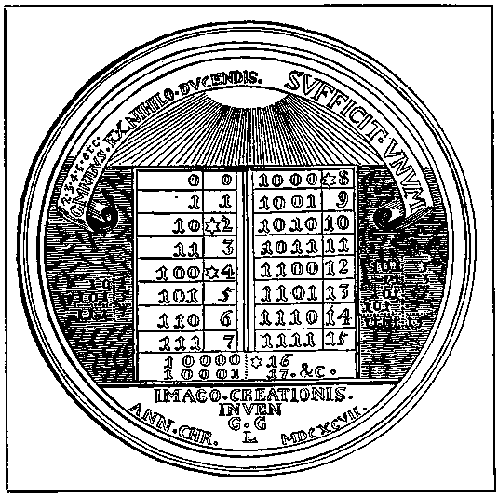L’anthropologue
de la santé Jean-Dominique Michel fait partie de ces rares
intellectuels qui, non seulement ne partagent pas les peurs et les
opinions imposées par la communication gouvernementale et les médias
dominants, mais de surcroît ont le courage de l’exprimer publiquement.
Son propos est celui d’un chercheur en sciences sociales spécialiste des
questions de santé, à cheval sur la France et la Suisse, doté d’une
longue expérience. Il est très argumenté et s’appuie en notes de bas de
page sur une importante bibliographie médicale internationale, inconnue
de la plupart des commentateurs français. Nonobstant les quelques
imperfections de forme (coquilles, références parfois données uniquement
sous forme de liens hypertextes) liées à un excès de rapidité dans le
processus de publication, et malgré la personnification du propos et les
nombreuses digressions inutiles qui en découlent (commentaires des
commentaires reçus sur
son blog, évocations de souvenirs personnels, récit anecdotique de sa propre maladie, etc.),
son livre
(paru mi-juin) se lit facilement et s’avère d’utilité publique tant
sont nombreuses et cruciales les questions de fond discutées. Citons
notamment la connaissance statistique de l’épidémie et de la mortalité
en général, la critique de la stratégie politico-sanitaire du
confinement, l’état actuel de la recherche médicale, la corruption par
l’industrie pharmaceutique, la question du traitement du Covid, les
questions de santé publique en général. On s’efforce ici d’en « extraire
la substantifique moelle » selon l’expression populaire, mais on
recommande à tou(te)s sa lecture.
Exagérations permanentes, panique et mauvaises décisions
Dans une partie des pays, et tout particulièrement en France, la
communication gouvernementale est axée sur l’exagération permanente du
danger. A plusieurs moments, c’est aussi la stratégie qu’a adopté l’OMS,
avançant des taux de létalité du Coronavirus quinze fois supérieurs à
la réalité (p. 9). En fait, 98% des personnes infectées guérissent
spontanément, leur système immunitaire étant suffisamment robuste. Comme
l’ont montré des recherches internationales, le taux de létalité de
cette maladie se situe probablement autour de 0,2%, ce qui est
comparable à une grippe forte (p. 10). Les principales spécificités du
Coronavirus sont apparemment la force de sa contagiosité et la rapidité
avec laquelle il génère des complications respiratoires potentiellement
mortelles chez les personnes les plus fragiles : les personnes âgées,
les personnes obèses et les personnes déjà atteintes par d’autres
maladies ayant sérieusement entamé leurs défenses (maladies
auto-immunes, maladies respiratoires, maladies cardio-vasculaires,
cancers, diabètes de type 2, etc.). Ceci est connu depuis la mi-mars. Et
cela ne justifiait pas l’espèce de « psychose » qui s’est emparée de
beaucoup de pays.
Pourtant, à ce moment-là, plutôt que d’écouter les épidémiologistes,
les infectiologues et les virologues les plus reconnus, les
gouvernements comme celui de la France ont préféré imiter la Chine et
prendre au sérieux des « modélisateurs fous » (p. 17) comme
l’épidémiologiste anglais Neil Ferguson (qui
n’a cessé de faire des prédictions totalement erronées dans sa carrière et qui, à propos du Coronavirus, a été
désavoué rapidement par beaucoup d’autres chercheurs),
ce qui les a conduits à « aggraver un problème sanitaire d’ampleur
parfaitement maitrisable » (p. 11). Ils ont en effet décidé de confiner
l’ensemble de la population, ce qui n’a jamais fait partie des
recommandations de l’OMS. D’autres gouvernements européens, comme ceux
de l’Allemagne, de la Suède, des Pays-Bas ou encore du Danemark, ont
entendu de véritables experts (comme le virologue allemand
Christian Drosten ou le danois
Peter Gotzsche) et ont fait du coup des choix bien plus pondérés et judicieux. D’autres pays asiatiques également.
La raison aurait voulu que la stratégie consiste bien plutôt à 1)
renforcer chez chacun le système immunitaire (vitamines, zinc,
magnésium, etc.), 2) produire massivement des tests de dépistage pour
repérer et isoler les personnes infectées, 3) réduire la charge virale
et la contagiosité des personnes « à risque » infectées (ou soupçonnées
de l’être) par les médicaments disponibles (parmi lesquels
l’azithromycine et l’hydroxychloroquine), 4) donner tous les outils de
protection nécessaires aux personnels soignants (masques, gants, etc.)
afin qu’ils ne soient pas infectés et ne propagent pas le virus aux
autres, 5) respecter des règles de protection (comme le lavage de mains
systématique et la distanciation sociale) pendant le temps du pic
épidémique, 6) développer la capacité hospitalière en soins intensifs,
7) mettre en place des comités d’experts vraiment compétents et dénues
de conflits d’intérêt avec les industries pharmaceutiques, 8) adopter un
mode de communication d’Etat honnête et transparent (p. 12-16). Si ces
principes raisonnables, fruits de l’expérience accumulée lors des
précédentes épidémies, avaient été appliqués, l’épidémie de Coronavirus
n’aurait pas fait davantage de victimes que les grippes hivernales qui
reviennent chaque année (p. 43). Or, « rien de tout cela n’a été mis en
place par nos dirigeants. Ceux-là mêmes qui essaient encore de nous
faire croire qu’ils ont agi avec justesse et affirment que s’ils avaient
pris d’autres décision, les choses auraient été bien pires » (p. 17).
Toute la stratégie du gouvernement français est bien là, en effet.
La remise en cause scientifique du confinement
Jean-Dominique Michel a été l’un des tout premiers chercheurs
francophones à contester la nécessité du confinement général pour
souligner en retour les mécanismes d’acquisition d’une immunité de
groupe, rappeler le mécanisme classique d’atténuation de la virulence
des virus de ce type lorsqu’ils envahissent une nouvelle espèce,
indiquer aussi que, sauf exception pathologique, les enfants sont
épargnés par le virus. Rappeler aussi que
le confinement général n’a jamais été une recommandation de l’OMS aux États. Il s’inspire de grands épidémiologistes comme le Suédois
Johan Giesecke ou les Américains
John Ioannidis et
Knut Wittkomwski (ou encore le prix Nobel de biochimie
Michael Lewitt)
qui, dès le milieu du mois de mars « mettaient en garde contre le
risque de prolonger l’épidémie par le confinement, alors que,
disent-ils, elle aurait vocation à passer rapidement si on se focalisait
plutôt sur la mise en quarantaine des malades et la protection des
personnes à risque, qui permettrait la diffusion du virus chez les moins
de 60 ans, sans facteur de risque, pour qui la maladie est bénigne,
favorisant ainsi l’émergence de la fameuse immunité de groupe » (p. 57).
Il fait également partie des experts qui ont compris très vite « la
fameuse courbe en cloche avec une redescente rapide, [qui] est
exactement la même entre les pays, indépendamment des mesures prises ou
non – la seule différence résidant dans le nombre de victimes, corrélé
de manière presque trop visible avec la sévérité du confinement » (p.
58). Encore plus politiquement incorrect, J.-D. Michel mentionne
également
cette étude des universités de Zurich et de Bâle
sur l’efficience des mesures sanitaires face au Covid, montrant que le
confinement total est la moins efficace de toutes (voir aussi
ce pre-print d’une équipe d’Oxford,
mis en ligne fin juillet). Et si l’on prend en compte les conséquences
humaines et sociales prévisibles du confinement général, la conclusion
arrive fatalement : « ce confinement vendu comme un pis-aller en
l’absence de ce qui était nécessaire (tests de dépistage, suivi des
chaînes de contamination, masques) aura, si l’on en croit ces premières
études, été lui aussi toxique » (p. 59).
Hélas, ces premières études avaient vu juste. Le travail mené par
Denis Rancourt (Université d’Ottawa) – sur lequel nous reviendrons sans
doute dans un prochain épisode – montre que le pic de mortalité
naturelle de l’épidémie (le haut de la courbe en cloche) a, dans
certains pays (et, aux États-Unis, dans certains États), été suivi d’un
pic encore plus bref et intense qui, lui, n’est pas lié à l’histoire
naturelle de la maladie de Covid mais à la décision de confinement
général ayant de fait sacrifié les personnes les plus fragiles (voir
l’étude initiale
ici, et sa traduction française
là).
Sur le rejet de la proposition thérapeutique de Didier Raoult
Si les services d’urgence des hôpitaux ont été
saturés et même submergés dans certaines régions
(en France, le Grand Est et la région parisienne en particulier), ce
n’est pas seulement en raison des réformes successives de l’hôpital
public qui, en France comme dans de nombreux autres pays occidentaux,
ont conduit à une réduction continue du nombre de lits. J.-D. Michel
rappelle bien cette raison-là (p. 64-66). Mais il en rappelle aussi une
autre : le rejet de la proposition thérapeutique de l’équipe du
professeur Didier Raoult de l’Institut Hospitalo-Universitaire de
Marseille. En associant un antiviral (l’hydroxychloroquine) et un
antibiotique (l’azithromycine), ils parviennent pourtant à faire baisser
fortement la charge virale dans les premiers jours suivant l’infection,
et ainsi réduire la durée moyenne de la contamination potentielle par
le malade, réduisant donc à la fois le risque que la maladie dégénère
chez le malade et le risque qu’il contamine d’autres personnes (voir
leur étude finale sur 3 737 malades soignés à l’IHU). Et ceci est d’autant plus important qu’
une étude chinoise a indiqué mi-mars dans le
Lancet que la durée du portage viral était en moyenne de 20 jours dans le cas du Covid.
A nouveau, J.-D. Michel rappelle tranquillement des faits bien
établis : D. Raoult est un spécialiste reconnu du sujet, son équipe
utilise couramment ces médicaments et les connaît donc parfaitement, la
chloroquine est d’usage ancien et banal, elle a déjà montré
in vitro une efficacité contre des coronavirus plus anciens,
y compris le SRAS.
L’incompréhension devant la réaction des autorités politico-sanitaires
françaises est donc forte : « sa déclaration publique est accueillie
avec scepticisme et même hostilité par la communauté scientifique. Les
journalistes du
Monde qualifient sa communication de
fake news,
accusation reprise sur le site du ministère de la Santé pendant
quelques heures avant d’être retirée » (p. 72). « Au lieu de
l’accueillir avec joie, les autorités et les scientifiques rivalisent de
critiques. Ils concentrent leurs critiques sur le fait qu’on ne peut
pas tirer de conclusions définitives sur la base d’essais cliniques »
(p. 75). Pour J.-D. Michel (qui sous-estime selon nous la dimension
politique de l'anti-raoultisme), il s’agit là d’un « intégrisme
procédural » qui « éthiquement indéfendable dès lors que l’on a affaire à
l’un des médicaments les mieux connus et les mieux maitrisés (…) et
alors que des vies sont en jeu » (p. 75). Cet intégrisme ne surprend
toutefois pas vraiment dès lors que l’on mesure la place qu’ont réussi à
prendre les méthodologistes dans le monde de la recherche médicale, et
derrière eux la place qu’ont réussi à prendre les industriels du
médicament.
Pourquoi la médecine ne sera jamais une science exacte
L’
evidence based medicine (EBM) « est devenue l’idéologie
dominante en matière de recherche médicale » mais « elle souffre d’un
certain nombre de limites » (p. 89). Développées au départ pour des
maladies chroniques et complexes où les statistiques étaient une aide
précieuse, elle est mal adaptée aux maladies infectieuses où le problème
posé est « beaucoup plus simple » et « empirique » : « soit un remède
est efficace, soit il ne l’est pas. S’il l’est ne serait-ce que sur
trois puis trente premiers malades, alors il le sera (avec sans doute
quelques exceptions statistiquement infimes) sur les trois mille
suivants » (p. 90). Jean-Dominique Michel rappelle ici l’expérience du
sida : ce n’est pas l’EBM qui a permis de découvrir le traitement (les
trithérapies) en 1996, c’est la médecine empirique. Il faut donc
remettre l’EBM à sa place : elle « peut venir en soutien et assurément
apporter des informations pertinentes, mais non se substituer à la
clinique » (p. 93).
Le rêve de transformer la médecine en une science exacte est un
infantilisme, l’expression « certitude scientifique » est un oxymore, la
conception de la randomisation comme preuve ultime est une croyance
dogmatique. J.-D. Michel a des mots très durs mais très justes contre
« les intégristes » de l’EBM (p. 100). L’EBM n’a pas fondamentalement
permis d’améliorer la qualité des soins médicaux et elle « participe
involontairement à sa déshumanisation de la pratique médicale » (p.
103). «
Trop de médecine, trop peu de soins »,
disait il y a quelques années le professeur Claude Béraud (Université
de Bordeaux). L’expérience du traitement des cancers des enfants a
également conduit le
docteur Nicole Delepine
à dénoncer des protocoles dits scientifiques qui conduisent à
uniformiser les traitements et à ouvrir la voie aux industries
pharmaceutiques. Dans un livre paru au début de cette année 2020 (
La France, malade du médicament),
le professeur de pharmacologie Bernard Bégaud (Université de Bordeaux)
estime que « la moitié des centaines de milliers d’effets indésirables
survenant en France, certains de gravité extrême, sont induits par
des médicaments dont la prise ne se justifiait pas ou plus ». De manière
générale, comme J.-D. Michel le rappellera plus loin, « la mauvaise
médecine est devenue, aux États-Unis,
la troisième cause de mortalité juste après les maladies cardiovasculaires et les cancers » (p. 129).
Rien ne remplace l’expérience empirique du soin des malades, raison
pour laquelle il est consternant que le gouvernement français ait écarté
la proposition thérapeutique de l’IHU de Marseille et qu’il ait mis à
l’écart les médecins de ville dans la lutte contre l’épidémie (p.
94-95). Au final, la responsabilité morale de tous ces adorateurs de
l’EBM est engagée : « la posture des responsables politiques français et
des gardiens du temple "scientifique" a été de risquer de laisser
mourir des malades pour ne pas prescrire une substance parce qu’on
n’était pas "absolument certains" de son efficacité. Ce qui pose bien un
problème éthique » (p. 99).
De la corruption dans la recherche médicale
Le dernier problème posé par l’EBM est celui qu’a révélé
l’affaire du Lancet.
Jean-Dominique Michel avait déjà terminé son livre lorsque cette
affaire a eu lieu, mais elle ne fait que confirmer de façon
spectaculaire ce qu’il explique très bien : « l’EBM a d’autres utilités
que celle pour laquelle elle a été mise en place et massivement adoptée
par le monde de la recherche médicale : elle fournit des possibilités
inépuisables
de manipulation et de fraude. Les compagnies
pharmaceutiques en particulier en font grand usage pour faciliter
différentes opérations lucratives en dépit de l’absence de données
réelles probantes. Avec les maladies chroniques, l’industrie
pharmaceutique a fourni par supertankers de faux résultats permettant de
mettre sur le marché des produits coûteux, inutiles et souvent
dangereux. Le tout enrobé d’un vernis de respectabilité scientifique qui
fait encore hélas illusion » (p. 105).
La terrible naïveté des « méthodologistes » consiste à confondre la
fin et le moyen. La statistique n’est qu’un moyen, qui peut être mis au
service de n’importe quelle fin. L’EBM est ainsi régulièrement utilisée
par les industriels pour « prouver » l’absence de lien entre un problème
de santé et un produit : « c’est évidemment l’industrie du tabac qui a
ouvert le bal, suivie par d’autres comme l’agroalimentaire, l’industrie
pétrolière et la pétrochimie (en particulier son secteur pesticides).
Les fameux "Monsanto Papers", grâce auxquels la multinationale
contestait de manière fallacieuse l’évidente toxicité de ses produits
par des documents pseudoscientifiques en est un exemple récent » (p.
106).
Et la même chose fonctionne avec le Covid : « on a ainsi pu observer
que les plus virulents opposants au protocole de Marseille étaient
bénéficiaires des largesses de Gilead, une société espérant mettre sur
le marché son antiviral Remdesivir au prix de 900 à 1 000 dollars par
patient. Ces mêmes experts touchent également des enveloppes des autres
grands groupes comme Merck, Sharp & Dohme, Roche, Boehringer,
Johnson & Johnson, Sanofi, GSK, Abbvie, Pfizer, Novartis ou encore
Astrazeneca » (p. 107). Au passage, J.-D. Michel rappelle aussi que ceci
concerne la plupart des médecins faisant partie du « Conseil
scientifique » et du « Comité analyse et expertise (Care) » mis en place
par le président de la République en France (p. 108).
Le problème est général et J.-D. Michel le pose dans toute sa
crudité : « la recherche médicale est en crise depuis au moins quinze
ans. Une crise systémique. Sapée par une corruption généralisée qui
s’appuie sur un petit nombre de personnes corrompues et une majorité
d’acteurs qui sont partie prenante en toute ignorance de cause » (p.
109). Une « corruption systémique » gangrène donc la recherche médicale
contemporaine : « le système est pourri dans son ensemble, d’une manière
qui contraint chaque acteur à s’y résoudre, mais sans avoir à y
participer activement » (p. 111). La chose a déjà été dénoncée à maintes
reprises par les rédacteurs en chef des plus grandes revues médicales
comme le
New England Journal of Medicine, le
British Journal of Medicine et le
Lancet (
on l’a également souligné ici).
J.-D. Michel rappelle aussi que tout ceci est connu de tous depuis le
célèbre article du professeur John Ionnadis (Université de Stanford),
publié en 2005, intitulé «
Pourquoi la plupart des résultats de recherche scientifique publiés sont faux »
(p. 112). En effet, l’industrie pharmaceutique a non seulement imposé
une méthode (l’EBM), des sujets et des hypothèses, mais elle contrôle de
surcroît en partie la formation, la recherche, l’édition et les médias
(p. 115-118).
On ne peut reprendre ici tous les arguments et toute la bibliographie
que donne J.-D. Michel, mais tout ceci est fondamental. On insistera
toutefois, pour terminer sur ce point, sur les pages consacrées par
l’auteur à la crise du virus H1N1 (« grippe A ») de 2009, tant la
comparaison avec la crise actuelle est fascinante (on rappellera à ce
propos l’excellent documentaire de ARTE que chacun peut
revoir sur Internet).
Il y a 11 ans, l’industrie pharmaceutique avait déjà réussi un énorme
« coup » en créant une panique autour d’un virus présenté comme un
danger pour l’humanité toute entière lors même qu’au final il ne tua pas
plus que les grippes saisonnières. Mais grâce à cette panique,
l’industrie (notamment le laboratoire suisse Roche) parvint à faire
acheter par les Etats des centaines de millions de boites d’un antiviral
– le Tamiflu – qui s’avéra par la suite inefficace (p. 128-129). Et
après le médicament vint bien entendu le vaccin, acheté là aussi par
centaines de millions. La France, on s’en souvient, battra des records
avec l’achat de 95 millions de doses par le ministère de la Santé dirigé
alors par une certaine Roselyne Bachelot. On relira à cette occasion le
rapport de la Commission d’enquête du Sénat de l’époque, consacrée au
«
rôle des firmes pharmaceutiques dans la gestion par le Gouvernement de la grippe A (H1N1) ».
La véritable santé publique est ailleurs
Le onzième et avant-dernier chapitre du livre de J.-D. Michel
pourrait au premier abord paraître hors sujet, d’autant que certains
passages du livre le sont quelque peu. Mais il n’en est rien. Le
Coronavirus n’est dangereux que pour les personnes les plus affaiblies
par l’âge (
93% des personnes décédées avaient plus de 65 ans)
et les maladies chroniques (hypertension, diabète, troubles
cardiovasculaires, cancer, etc.). D’où la proposition tirée : « il faut
oser le dire, ce n’est pas le virus qui tue, ce sont les maladies
chroniques qui rendent une infection au Sars-CoV-2 potentiellement
fatale à certains patients déjà lourdement touchés par les maux de la
société » (p. 187). Outre le vieillissement naturel, ce sont bien des
facteurs socio-économiques qui facilitent le développement des maladies
chroniques qui elles-mêmes fragilisent les défenses immunitaires face
aux virus. Et J.-D. Michel rappelle opportunément les sept grands
facteurs que sont : 1) « la malbouffe » (« trop salé, trop gras, trop
sucré ») conduisant à l’obésité, 2) la pollution atmosphérique, 3) les
substances chimiques présentes dans les habitations et dans
l’environnement, 4) les médicaments inutiles ou mal prescrits, 5) les
pesticides, 6) le stress au travail, 7) la sédentarité (p. 188-190). Il
en oublie cependant trois autres : le tabagisme, l’alcoolisme et surtout
les élevages intensifs d’animaux qui sont une source majeure de toutes
ces zoonoses (maladies transmises à l’homme par les animaux) dont le
Coronavirus n’est sans doute que le énième épisode.
Le propos de J.-D. Michel est cinglant : « la vérité est qu’à peu
près rien n’a été réellement fait au cours des décennies écoulées pour
protéger la population contre ces facteurs de risque, malgré des dégâts
sanitaires monstrueux. Et c’est cette population déjà atteinte dans sa
santé qui a été le plus frappée par la pandémie de Covid-19. Le vrai
problème, c’est que nous avons donné licence aux grands complexes
industriels (agroalimentaire, pétrochimie, transports, pharmas) de
prospérer en inondant le marché de produits qui, pour beaucoup d’entre
eux, endommagent ou détruisent la santé des gens. Au détriment donc du
bien commun et de la santé de la population. (…) les consortiums qui
contrôlent aujourd’hui la production agricole, l’alimentation, la
chimie, l’énergie, les transports, les médias, la publicité et les
médicaments font le lit de nos cancers, nos infarctus, nos AVC, nos
diabètes, nos Alzheimer, Parkinson, dépressions et autres scléroses en
plaques. (…) En fait, nous n’avons pas de système de santé, mais
une industrie de la maladie » (p. 191-192).
Même s’il tend ici à euphémiser les phénomènes proprement naturels
(le vieillissement, les facteurs génétiques), ce raisonnement
sociologique qui caractérise globalement le propos de Jean-Dominique
Michel fait tout l’intérêt de son livre.
Référence :
Jean-Dominique Michel,
Covid : anatomie d'une crise sanitaire, Paris, HumenSciences, 2020, 224 pages, 17 euros.
Le Club est l'espace de libre expression des abonnés de Mediapart. Ses contenus n'engagent pas la rédaction.