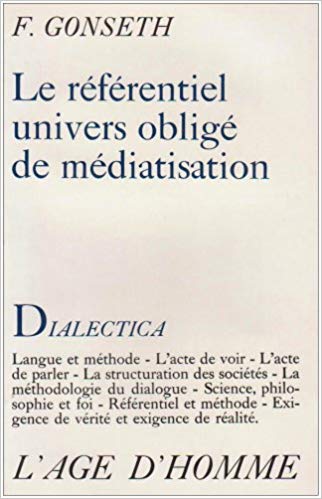En 1842, tandis que le réseau ferroviaire français commençait à déployer lentement ses ramifications tentaculaires, l'écrivain Paul de Kock proposait une curieuse métaphore : " Voyager en chemin de fer ne fatigue pas ; c'est un plaisir, un agrément... on se sent rouler avec une douceur inconcevable, ou plutôt on ne se sent pas rouler. On voit fuir devant soi les arbres, les maisons, les villages... tout cela passe ! passe... bien plus vite que dans une lanterne magique... et tout cela est véritable, vous n'êtes point le jouet de l'optique !... Le chemin de fer est la véritable lanterne magique de la nature1. "
2Préférer cette métaphore à celle du "Pégase moderne" qu'employèrent nombre de ses contemporains, c'était faire du train un instrument de vision plutôt que de locomotion, l'inscrire dans la dynamique des dispositifs optiques. À l'exemple de Paul de Kock, c'est donc comme machine à voir et non comme machine à se mouvoir que le chemin de fer sera abordé ici2. Plutôt que d'un regard sur le train, il sera donc d'abord question d'un regard depuis le train3. Pour analyser et comprendre ce que l'on voit d'un train lancé à pleine allure, une simple étude physiologique basée sur les commentaires écrits et les observations des voyageurs ne peut suffire. Il importe de comparer la machine de vision ferroviaire à d'autres dispositifs optiques qui, depuis la lanterne magique, ont croisé l'histoire des chemins de fer : la photographie, le panorama ou le cinématographe. Parce que leur travail de représentation implique un travail de compréhension préalable, ils constituent le lieu privilégié d'une analyse des mécanismes de la vision ferroviaire. [p. 73]
Vitesse du train, vitesse du regard
3Parmi les caractéristiques essentielles de la vision nouvelle imposée par le train, il en est une immédiatement remarquée par les premiers commentateurs : la vitesse. Quatre fois supérieure à celle des attelages les plus rapides, la vitesse des premiers trains entraîne une troublante surabondance des impressions visuelles. Précipité dans le champ du regard, le paysage ne s'est pas encore offert qu'il s'est déjà éclipsé, comme le remarque Louis Napoléon Bonaparte lors d'un voyage en Angleterre en 1833 : " Tous les objets passent devant vos yeux avec une rapidité inouïe, maisons, arbres, barrières, tout disparaît avant qu'on ait pu les fixer4. " La vue à travers la fenêtre du train à pleine allure est alors souvent comparée à celle que l'on peut avoir dans l'oeilleton d'un kaléidoscope5 : les structures volent en éclats, les objets se télescopent, les formes se fragmentent, se combinent selon mille manières, puis se décomposent jusqu'à la dissolution complète dans l'abstraction. En train tout va trop vite, tout passe, " tout devient raie6 ", écrit magnifiquement Victor Hugo. Le paysage qui défile, lorsqu'il ne disparaît pas dans les tunnels ou les tranchées, se résume alors souvent à deux larges bandes colorées azur et brune : le ciel et la terre. Un commentateur ingénu affirmera même qu'à augmenter encore la vitesse du train, les couleurs du paysage risquent bien, selon une application particulière du disque de Newton, de se confondre en une large plage d'un blanc spectral7.
4Face à la célérité du train, les commentaires des premières décennies s'accordent majoritairement pour noter une déficience du regard. Avec la seconde génération d'usagers celle qui apparaît après les années 1860, le regard semble s'accoutumer, ou s'éduquer. La vitesse n'est plus une entrave mais une curiosité, le paysage n'est plus dédaigné mais regardé avec attention. Les peintres, notamment, montrent alors un large intérêt pour cette mobilité et ses effets sur le paysage. Dans son [p. 74] ouvrage sur les chemins de fer, Henri Vincenot remarque l'importance du chemin de fer dans l'oeuvre de Camille Corot : " C'est au moment où ce grand marcheur abandonne la diligence pour prendre le chemin de fer que sa peinture se modifie et que son paysage s'émancipe8. " Ce ne seront plus désormais des points de vue pittoresques offerts au voyageur arrêté mais " des portions de campagne saisies par un promeneur qui avance9 ".
5Une génération plus tard, dans la lignée de Corot, dont il fut l'ami, le peintre Johan Barthold Jongkind évoque pareillement l'influence décisive du chemin de fer sur son style pictural : " Dans le cadre de la fenêtre du wagon j'ai vu passer, à la vitesse d'un éclair, plus de mille tableaux successifs, mais je ne les ai qu'entrevus, très vite effacés par le suivant et, au retour, je les ai revus mais avec une lumière différente et ils étaient autres. Et j'ai compris que c'était comme ça qu'il fallait peindre : ne retenir que l'essentiel de la lumière surprise en une seconde à des moments différents. L'impression fugitive sur la rétine suffit. Tout le reste est inutile10. " Le protocole est clair et la phrase explicite ; il y a là en germe le programme d'un regard qui s'appellera bientôt impressionnisme. Sans aller jusqu'à penser, avec Henri Vincenot, que " c'est de la portière d'un train, lancé à cinquante ou quatre-vingts kilomètres à l'heure, qu'est né l'impressionnisme11 ", on pourra considérer que le chemin de fer a joué un rôle non négligeable dans l'émergence d'une vision impressionniste, subreptice et fugace.
6Si Edgar Degas accompagna le groupe impressionniste à ses débuts, ce chantre de la vie moderne ne partageait pas leur goût pour la nature ou le plein air. Aussi ne lui connaît-on que très peu de paysages, et doit-on s'étonner, de la part de celui que l'on a dénommé le " peintre de l'instantané12 ", qu'une bonne partie d'entre eux aient été conçus dans une voiture de chemin de fer, comme le précise Degas dans une conversation avec son ami Ludovic Halévy ? C'est " le fruit de mes voyages de cet été. Je me tenais à la portière des wagons, et je regardais vaguement. Ça m'a donné l'idée de faire des paysages13 ". À l'interrogation d'Halévy qui tente de comprendre le soudain intérêt du peintre pour le paysage et lui demande s'il s'agit " d'états d'âme ", Degas répond, en réfutant un langage aussi sentencieux, qu'il s'agit " simplement d'états d'yeux14 ".
7Très proche des " impressions fugitives " de Jongkind, mais davantage poétiques, les " états d'yeux " de Degas décrivent avec justesse le [p. 75] mécanisme d'une vision fonctionnant sur le registre du coup d'oeil. Les usagers de la seconde génération avaient en somme remédié à la célérité du train par la rapidité de leur regard.
Vision ferroviaire et captation photographique
8De cette vision ferroviaire, l'écrivain suédois August Strindberg donnera en 1886 une définition plus précise encore : " Le plus beau pays d'Europe, où l'on trouve tous les climats, toutes les sortes de nature [...] est enfermé dans le magasin de mon oeil reposé, telle une série de Momentaufnahme ; maintenant je vais chercher à tirer ces images avec tous les moyens dont je dispose, après avoir retouché les négatifs à l'aide d'annotations faites durant ce voyage15. " Momentaufnahme : le terme est allemand et désigne l'instantané photographique. Strindberg l'utilise à diverses reprises dans sa correspondance pour décrire les flashes parcellaires, les impressions visuelles momentanées qui viennent s'inscrire sur sa rétine comme la lumière sur la plaque photographique.
9Mais là où il y avait chez Jongkind et Degas un vague nonchaloir du regard qui ne fixait rien de très distinct et favorisait l'impressionnisme, il y a chez Strindberg une véritable technique du coup d'oeil, un enregistrement de la scène qui s'apparente pleinement au vocabulaire photographique qu'il emploie et déploie : magasin, instantané, tirage et retouche des négatifs. À travers cette métaphore photographique, Strindberg ouvre une brèche vers la compréhension de la vision ferroviaire. Pour percevoir correctement les paysages qui défilent à vive allure, pour en capter les éléments fugitifs, il faut en somme disposer d'une acuité quasi photographique une perception instantanée.
10Entre le chemin de fer et la photographie, ce n'est là qu'une première analogie, car la vision ferroviaire, à l'instar de la captation photographique, n'est pas seulement instantanée, elle est aussi fragmentée et focalisée. " Le paysage dans le cadre des portières court furieusement16 ", écrit Paul Verlaine en 1870. Depuis l'intérieur du wagon, c'est donc une vision encadrée, délimitée et fragmentaire qui s'offre à l'oeil du voyageur.
11De surcroît, la marche rapide du train entraîne une nouvelle appréhension de la profondeur du champ visuel. Un étagement hiérarchisé des plans s'instaure en fonction de la vitesse du défilement. À 80 km/h, soit l'allure moyenne d'un train à la fin du XIXe siècle, le premier plan est flou, le second plan demande un sensible effort d'accommodation, le plan moyen constitue l'essentiel du champ du regard, et l'arrière-plan [p. 76] se meut lentement, voire imperceptiblement à l'infini. Obligé de travailler latéralement dans une sorte de va-et-vient parallèle au sens de la marche, l'oeil voit sa capacité d'accommodation en profondeur diminuée d'autant. Avec une nette tendance à rester sur un plan fixe, parallèle au rail, le regard sera donc beaucoup plus focalisé, comme mis au point.
12À ce florilège d'analogies, il faudrait ajouter celle de la chambre noire : " À peine étions nous installés dans la chambre noire non, je me trompe dans le compartiment du wagon17 ", écrit un amateur photographe dans le compte rendu d'une excursion de 1900. Avec le paysage qui vient se projeter sur la vitre, la voiture de chemin de fer (" cette boîte obscure où j'ai dû me cloîtrer18 ", ainsi que la décrit Eugène Manuel) est semblable à ces immenses camera obscura à l'intérieur desquelles l'observateur se tient tout entier pour voir le spectacle de la nature se dessiner sur la paroi. La chambre et la voiture ont toutes deux la même capacité à isoler l'observateur dans un espace de vision cloisonné où seule la vue est sollicitée. Ainsi installé dans sa machine à voir, le voyageur semble donc devoir agir comme le photographe : le regard vif et cadré, il décompose le réel en plans successifs et semble attendre, comme l'écrit en 1861 Benjamin Gastineau, que les plus riches scènes du paysage viennent " se photographier sur la vitre du wagon19 ". [p. 77]
Le défi de la photographie ferroviaire
13Dans ce contexte, il pouvait sembler légitime de faire appel au médium photographique. Il existe pourtant un important décalage chronologique entre l'apparition des premiers trains de voyageurs, entre 1830 et 1840, et la possibilité de réaliser des prises de vue suffisamment rapides pour fixer le défilement du paysage. Il faudra attendre les années 1880, les débuts du gélatino-bromure d'argent et l'avènement de l'instantané pour voir apparaître les premières photographies réalisées depuis un train en marche. Le photographe belge Ernest Candèze semble être l'un des premiers à s'y adonner. Il écrit en 1882 : " S'il est possible de fixer sur une substance impressionnable l'image d'objets animés d'un mouvement rapide, l'inverse doit être également vrai, c'est-à-dire que l'opérateur peut lui-même se mouvoir, et cependant obtenir, sur la glace qu'il tient en main, l'image nette des paysages immobiles. [...] Partant de cette idée, je fis quelques essais. Emportant mon appareil en voyage, j'en braquais l'objectif par la portière d'une voiture de train en pleine course, et je pris la vue des paysages qui s'offraient en passant20. " Candèze sera bientôt suivi par Paul Nadar en 1884 (fig. 3 et 4. Paul Nadar, "Épreuves instantanées obtenues pendant la marche rapide du train", 1884), August Strindberg en 188621, puis par une kyrielle d'amateurs.
14Pour bon nombre de ces amateurs, réunis en sociétés ou en clubs, l'activité principale est l'excursion photographique. Bardés d'appareils et de trépieds, ils se retrouvent ainsi au petit matin sur le quai d'une gare pour conduire dans la bonne humeur une véritable chasse à l'image (fig. 2. Henri Bellieni, "Excursion du Congrès de photographie à Liverdun, 28 mai 1898" [figurent notamment sur ces images : n° 1 et 4, J. Janssen, n° 3 à g., A. Davanne et S. Pector]). Dans la majorité des cas, le moyen de locomotion employé reste le chemin de fer ce qui laisse le temps d'apprécier le paysage défilant par la fenêtre du wagon, et parfois même de le photographier. Bien sûr, pour ces photographes amateurs, il s'agit moins souvent de souligner l'hypothétique similitude entre la photographie et la vision ferroviaire que de relever le défi technique de l'instantané à grande vitesse. Car au même titre que les photographies de chevaux au galop, de vagues déferlantes ou de voltigeurs acrobatiques, ce sujet devient rapidement l'une des images emblématiques de l'instantanéité, témoignage de la rapidité des procédés et gage de l'habileté des opérateurs. Ainsi, en 1894, la Société caennaise de photographie affiche-t-elle au programme de son concours annuel le sujet suivant : " Instantané pris pendant la marche du train au cours des excursions des 13 et 15 mai22. " Dans le contexte des deux dernières décennies du XIXe siècle qui marque le début de l'amateurisme photographique, l'excursion en question fait partie des diverses [p. 78] manifestations qui permettent aux amateurs de se retrouver pour échanger leurs recettes, mais aussi pour mesurer leurs talents.
15Comme au sein de toute activité collective, la compétition prend parfois le pas sur l'émulation, poussant alors les participants jusqu'aux limites de leur pratique. Ainsi s'adonne-t-on à la photographie dans des conditions a priori peu propices : la nuit, par temps de neige ou de brouillard. Comme l'exprime parfaitement une publicité de 1893 pour les appareils Kodak, le défi inconsciemment imposé par la surenchère collective se résume bien souvent à faire des photographies " partout et quand même " : en ballon, bateau, bicyclette et, bien sûr, en train. Pour les amateurs, la photographie ferroviaire se range parmi ces objets de défi, de performance et d'exploit.
16Pourtant, si la publicité, les manuels, les articles et les photographes eux-mêmes semblent encourager une telle pratique, les images prises du train demeurent rares23. Le décalage entre la théorie et la pratique révèle l'intéressant paradoxe d'une image fantasmée mais non réalisée. Pourquoi ces épreuves censées représenter le mouvement du train par le défilement des paysages ne sont-elles que rarement parvenues jusqu'à nous ? N'étaient-elles pas suffisamment réussies ? Et dans ce cas, pourquoi n'ont-elles pas été conservées comme autant de curiosités, comme certaines courses ou sauts de chevaux ?
17Si ces images ont disparu, ce n'est probablement pas parce qu'elles étaient techniquement "ratées", mais plutôt parce qu'elles décevaient une attente et une croyance, parce qu'elles ne correspondaient pas à l'idée que l'on se faisait d'un paysage défilant dans le cadre d'une portière. Le paradoxe illustré ici par la photographie n'est autre que celui de Zénon d'Élée : en décomposant la trajectoire d'une flèche en instants infinitésimaux, le philosophe grec affirmait son immobilité dans l'espace, exactement comme l'amateur pratiquant l'instantané annihile le mouvement en donnant une image identique à celle qu'il aurait prise en restant immobile au bord de la voie. Le photographe obtient certes des coupes [p. 80] immobiles, mais non des images du mouvement24. Comparée à l'image surprenante d'un animal en suspension au-dessus d'un obstacle ou à la chute d'une goutte d'eau, la photographie prise du train à pleine allure ne représente rien d'extraordinaire rien de plus qu'un simple paysage. C'est pourquoi, annoncée comme image paradigmatique de l'instantanéité, celle-ci ne se réalise pas comme telle, désappointe et disparaît25.
Hypothèse du flou
18Face à cet échec de la photographie ferroviaire, divers recours pouvaient être envisagés. Les impressionnistes, par exemple, semblent avoir répondu à l'immobilité de l'image fixe par le flou de leur peinture. Les paysages ferroviaires peints par Degas entre 1890 et 1894 nous montrent ainsi des motifs dont les détails disparaissent sous les coups du pinceau et dont les formes se diluent dans la couleur.
19En photographie, il existe deux sortes de flou, l'un spatial : le flou de mise au point, l'autre temporel : le flou de bougé. Il ne sera ici question que du second. Ce flou temporel, qui s'est déjà imposé comme un code iconique de la mobilité, semble également susceptible d'apporter à l'image photographique le surcroît de dynamisme que l'instantané lui avait ôté. En 1892, lors d'une séance du Camera Club de Londres, Alfred Maskell attire l'attention de ses collègues sur ce problème. Il préconise de revenir à des obturateurs moins rapides " pour laisser voir un léger flou dans certaines parties de l'image [car] dans la photographie d'une locomotive lancée à pleine vapeur, si les rayons des roues paraissent absolument nets sur l'image, cette locomotive paraîtra arrêtée et ne donnera pas l'impression du mouvement26 ". Paradoxalement, en plein essor de l'instantané, le flou que les photographes s'étaient évertués à chasser de leurs images réapparaît comme l'unique manifestation visible du mouvement. Accepter de le réintroduire dans l'épreuve, c'était aussi renier les plus récents progrès de la technique, c'était manquer volontairement son image gageure que les photographes refuseront le plus souvent d'admettre jusque dans les années 1910-1920. En cette fin de XIXe siècle, l'image rêvée est une image "ratée".
20Ainsi, l'on comprend que si les photographies prises du train n'ont pas eu la postérité qui leur était promise, c'est bien parce qu'elles étaient "trop" réussies trop instantanées, pas assez floues. À preuve les différentes tentatives photographiques des futuristes qui, quelques années plus tard, totalement libérés des contraintes techniques, s'autorisèrent allègrement [p. 81] des temps de pose prolongés pour des points de vue éminemment mobiles : trains bien sûr, mais aussi voitures, bateaux et avions. Aujourd'hui encore, bon nombre de photographes, de Walker Evans à Bernard Plossu en passant par Istvan Feleki, recourent au flou ou aux accidents caractéristiques (reflets dans la vitre, interférences des poteaux, fils électriques, etc.) pour représenter le défilement du paysage. Cette liberté vis-à-vis de la technique, largement admise depuis les avant-gardes, a permis à cette pratique désormais très en vogue d'accéder au rang des poncifs de la photographie contemporaine. On ne dénombre plus les portfolios qui en contiennent quelques-unes ou les séries qui leur sont entièrement consacrées27. Non plus présentées comme les images emblématiques de l'instantanéité, mais bien comme celles de notre "nouveau rapport" au paysage, ces photographies prises du train semblent avoir enfin rencontré l'engouement que le XIXe siècle leur prédisait. Notons également que la mission photographique de la Datar, en affirmant que les vues du train participaient à la représentation de notre territoire, nous a récemment montré que ce type d'images était devenu une catégorie stylistique à part entière, au même titre qu'un portrait, une marine, ou une nature morte28.
Séquence, panorama, panoramique
21À côté du flou, il existe une autre possibilité de traduction d'un mouvement de translation : la séquence panoramique, c'est-à-dire la [p. 82] juxtaposition côte à côte d'images prises à des instants différents. Face à une image fixe et unique, plusieurs images ainsi disposées semblent en effet susceptibles d'exprimer plus adéquatement le mouvement. Ajoutons que le train, par la structure même du voyage qu'il effectue, incite à une telle représentation séquentielle.
22Que reste-t-il a posteriori d'un voyage en train ? Des bribes de paysage, des " impressions fugitives " (Jongkind), des " états d'yeux " (Degas), des " instantanés " (Strindberg). Lorsque le voyageur repense à son voyage, lorsqu'il se le représente, ces restes épars glanés ça et là viennent s'enfiler à la suite les uns des autres comme des perles sur un collier. L'image qu'il en conserve dans sa mémoire est une synthèse constituée par la combinaison de diverses autres images fragmentaires. C'est ce que Benjamin Gastineau intitule la " vision synthétique du coup d'oeil29 ", ce que Aldous Huxley appelle la " vision globale " : " Beaucoup de choses ont défilé devant mes yeux, mais je ne puis prétendre en avoir retenu beaucoup et quand je m'en souviens, ce ne sont pas tant des objets distincts qu'une vision globale. D'innombrables images séparées, saisies pendant des heures de contemplation, se sont fondues et rejointes dans mon esprit pour former, dans ma mémoire, comme une seule unité30. " La représentation emblématique et schématique du voyage en train ressemblerait en somme à ce curieux panorama qui orne la salle des fresques de la gare de Lyon. Sur une bande continue se trouvent juxtaposées les villes les plus significatives du parcours du Paris-Lyon-Marseille : une vue du Panthéon jouxte immédiatement le château de Fontainebleau, qui précède lui-même sans discontinuité la cathédrale d'Auxerre... et ainsi de suite jusqu'à Marseille. Ces vues qui, ordinairement, s'échelonnent dans l'espace et dans le temps sont ainsi simultanément réunies pour donner à celui qui s'embarque à bord du PLM une juste image de ce qu'il va voir, une synthèse de son voyage.
23Le chemin de fer agit sur le paysage à la manière de ces peintres de panoramas qui condensaient sur leur toile, à la plus grande satisfaction d'un public avide de voyages et de dépaysement, de véritables abrégés de l'univers : les plus beaux monuments d'Italie, toute la Grèce antique, les sept merveilles du monde, etc. Pareillement, le panoramiste et le train décomposent le paysage en fragments significatifs pour le recomposer ensuite en un ensemble cohérent31. Ainsi, devant le panorama, le spectateur est comme le voyageur devant le paysage. D'ailleurs, dès les débuts du chemin de fer, les Américains proposèrent des spectacles [p. 83] intitulés Moving panorama qui simulaient les voyages ferroviaires ou fluviaux au moyen d'une longue toile peinte se déroulant latéralement entre deux cylindres placés de chaque côté de la scène32. En 1834 était inauguré à Londres le Padorama qui proposait à des spectateurs répartis dans plusieurs wagons factices d'admirer sur une toile de plus de 900 m2 les paysages les plus intéressants de la liaison Liverpool-Manchester. La mode des panoramas mouvants perdurera jusqu'au début de notre siècle, le dernier des grands spectacles ferroviaires, le panorama Transsibérien ayant été installé à Paris durant l'Exposition universelle de 190033.
24Cédant à la concurrence du cinématographe et à la préférence du public pour celui-ci, les panoramas mouvants allaient disparaître avec le XIXe siècle. En 1904, l'Américain George C. Hale rachetait un ancien brevet qui s'apparentait au panorama et remplaçait le défilement latéral du décor par la projection d'un film. Ce Hale's Tour fit fureur à l'Exposition internationale de Saint-Louis en 1904 et sa renommée enterra définitivement les derniers panoramas ferroviaires qui subsistaient encore.
25Dès 1897, le catalogue des films Lumière comportait déjà ce qui fut évidemment appelé des Panoramas pris du train. Il semble que c'est à l'un de leurs opérateurs que revient la primeur de cette idée. Dans une correspondance adressée à ses employeurs, il entrevoit ainsi les ressources de son ingénieux procédé : "Nous pourrions fixer l'appareil d'un point [p. 84] de vue mobile : bateau ou train et ainsi les images seraient constamment renouvelées34. " L'idée séduisit les deux industriels et reçut probablement le plébiscite du public puisqu'un an plus tard, en 1898, le catalogue Lumière ne proposait pas moins d'une trentaine de films tournés de la sorte. Le panoramique ou travelling était né, remplaçant le panorama.
26On comprend ici que pour décrire cette nouvelle machine à voir qu'est le chemin de fer, le modèle de la chambre noire ne suffise plus. Car l'observatoire mobile dans lequel prend place le voyageur n'est pas une simple camera obscura, c'est une véritable camera obscura ambulante. Dans un livre récemment traduit en français et publié sous le titre : L'Art de l'observateur, Jonathan Crary analyse le changement de la perception visuelle au début du XIXe siècle. Selon lui : " Le tournant est pris entre 1810 et 1840 environ, lorsque la vision s'arrache à la stabilité et à la fixité des rapports incarnés par la chambre noire. [...] Tout se passe alors comme si on se mettait à évaluer l'expérience visuelle sous un jour nouveau, à lui conférer une mobilité et une capacité d'échange qu'elle n'a jamais eues35. " Le chemin de fer, qui apparaît à cette époque et auquel Crary ne fait pratiquement pas allusion, participe pleinement de l'évolution du regard qu'il décrit. Il n'est pas seulement le lieu où cette évolution se fait la plus visible, il en constitue sans doute l'une des causes principales.
27Une première version de cet article a été présentée le 5 mars 1996, dans le cadre du cycle de conférences "Questions de photographie" (Société française de photographie/Paris VIII). [p. 85]
NOTES
Pichois, Vitesse et vision du monde, Neuchâtel, La Baconnière, 1973; Wolfgang Schivelbusch, Histoire des voyages en train, (trad. de l'all. par J.-F. Boutout), Paris, Le Promeneur, 1990; René Thom, "Par les fenêtres du train : la notion de référentiel appliquée à l'art de voyager par le train" et François Béguin, "Paysages vus du train : littérature et géographie", Revue d'histoire des chemins de fer, n°10-11, printemps-automne 1994, p. 19-33 et p. 34-38. Il faut également citer les ouvrages de Paul Virilio et plus particulièrement La Machine de vision,
Paris, Galilée, 1988.
Famot, 1977, p. 43.
mémoire. T. III. Les France, vol. ii, Paris, Gallimard, 1986, p. 462.
Instantaneous Image", Art and Photography, Londres, Penguin Books, 1986, p. 181-210 (voir également Kirk Varnedoe, "The
Ideology of Time, Degas and photography", Art in America, été 1980, p. 96-110).
Le Train dans la littérature française, Paris, Éditions NM, 1964, p. 153).
Clément Chéroux, "Un voyage moderne", L'Expérience photographique d'August Strindberg, Arles, Actes Sud, 1994, p. 9-22.
p. 86-87, consacre un court chapitre à la "Photographie de trains en marche" et note : "Dans certains ouvrages, on soutient la possibilité de photographier, d'un train en marche, le paysage qui défile"; Appolo, "La prise des instantanés sur des objets eux-mêmes en mouvement (trains, bateaux, etc.)", L'Art photographique, janvier 1904, p.3-6; L. Rudaux, "La Photographie en chemin de fer", Ombres et lumière, octobre 1913, p. 2642-2643.
Journal de voyage [1926], Paris, Vernal-Ph.
Lebaud, 1988, p. 82. Strindberg emploie l'expression similaire d'"impression générale" : "D'abord le voyage devrait se faire aussi vite que possible pour que l'on ne perde pas l'impression générale en s'attardant sur les détails; pour cela on décida d'utiliser surtout le train qui permet d'avoir une vue d'ensemble puisque l'on peut traverser tout un département en quelques heures" (op. cit., p. 107).
Pékin. Il avait la particularité de présenter un décor à quatre vitesses défilant plus ou moins rapidement selon leur degré d'éloignement (cf. Georges Mareschal, "Les panoramas de l'exposition", La Nature, 1900, t. I, p. 399-403). C'est un tel panorama que le réalisateur Max Ophuls utilisera pour une scène du film Lettre d'une inconnue tourné en 1948. On peut apercevoir quelques images de cette scène dans le livre de Philippe Roger, Lettre d'une inconnue de Max Ophuls, Gusné, Éditions Yellow Now, 1989, p. 85-89.
Vision et modernité au XIXe siècle (trad. de l'anglais par Frédéric Maurin), Nîmes, Jacqueline Chambon, 1994, p. 37.
POUR CITER CET ARTICLE
Référence électronique
Clément Chéroux, « Vues du train », Études photographiques [En ligne], 1 | Novembre 1996, mis en ligne le 18 novembre 2002, consulté le 31 juillet 2021. URL : http://journals.openedition.org/etudesphotographiques/101