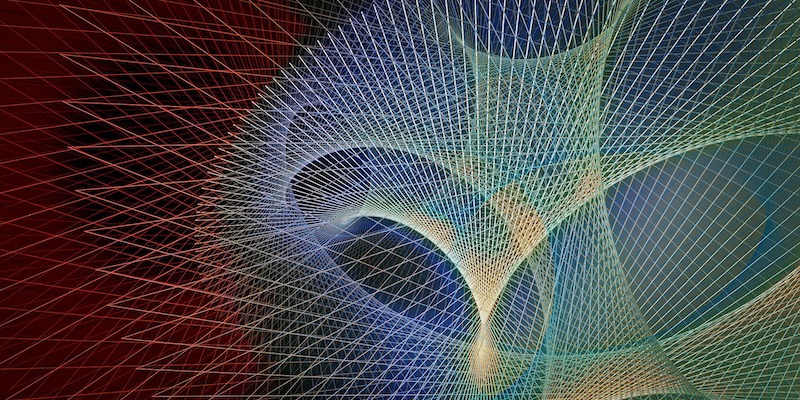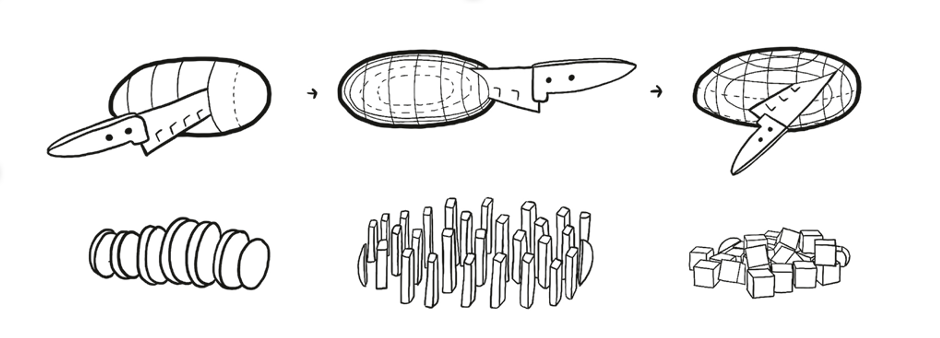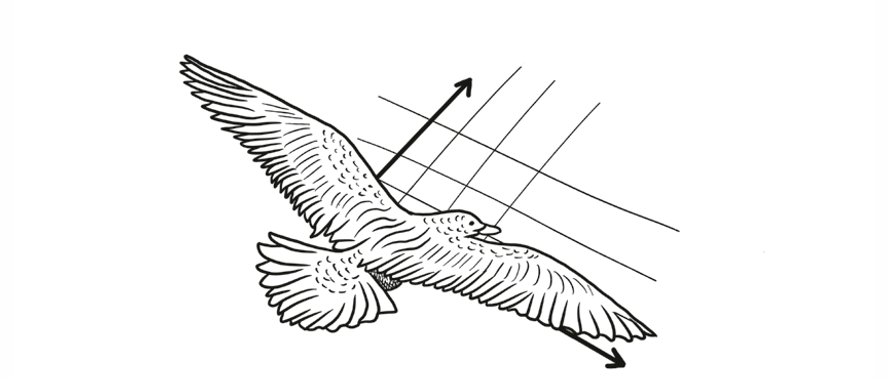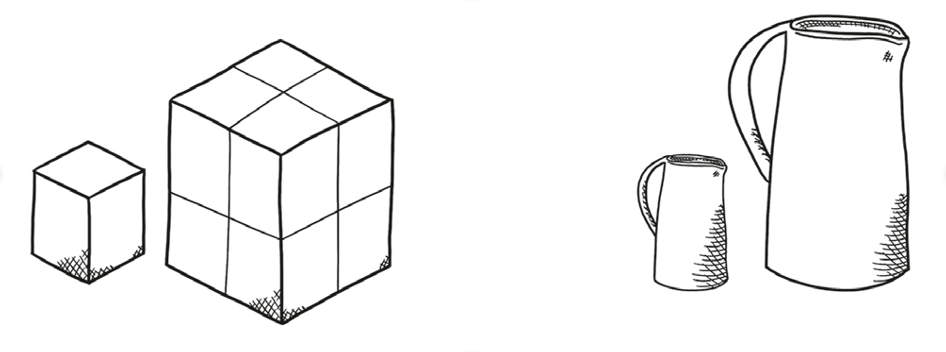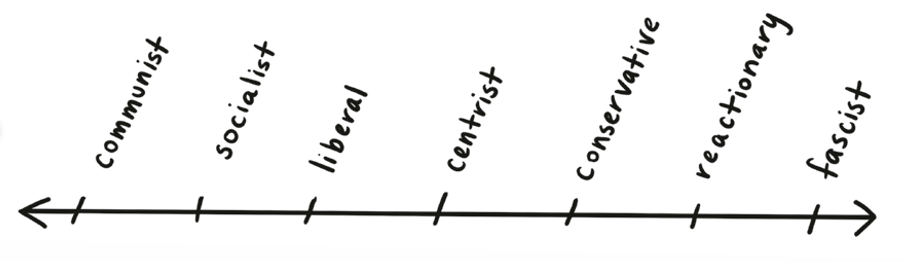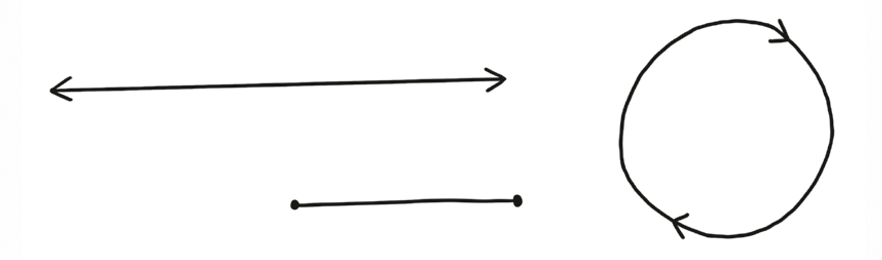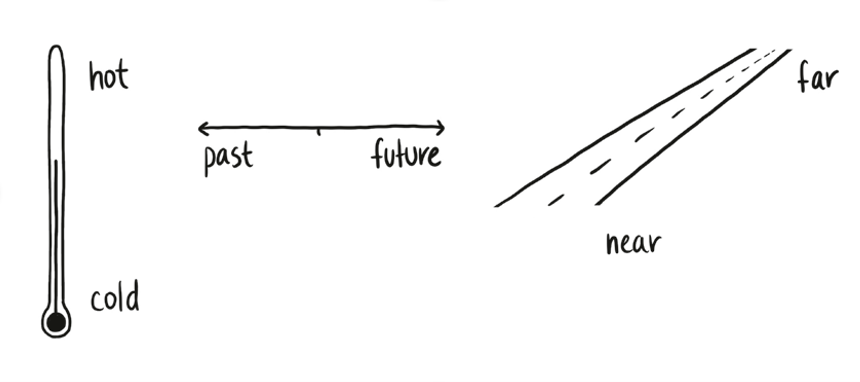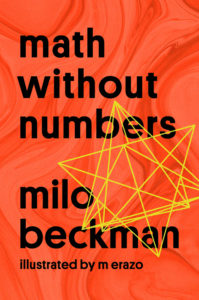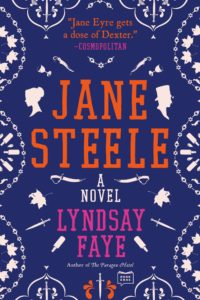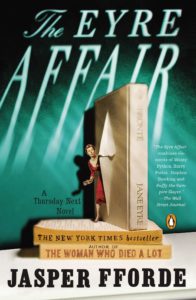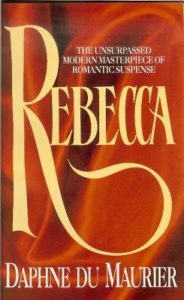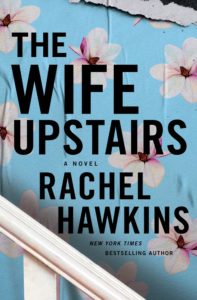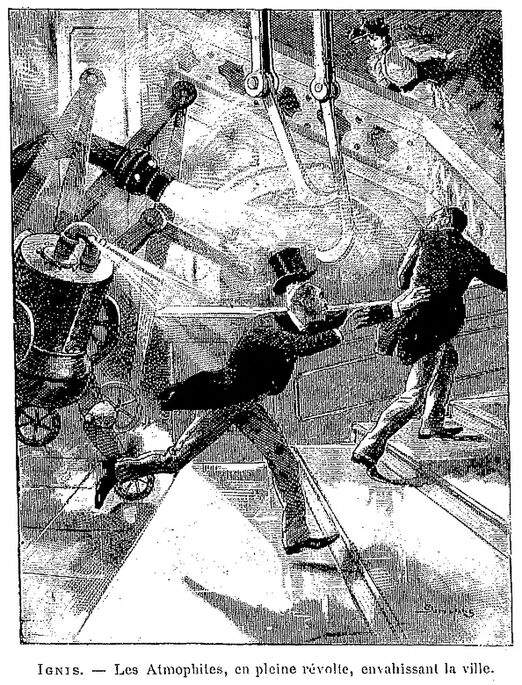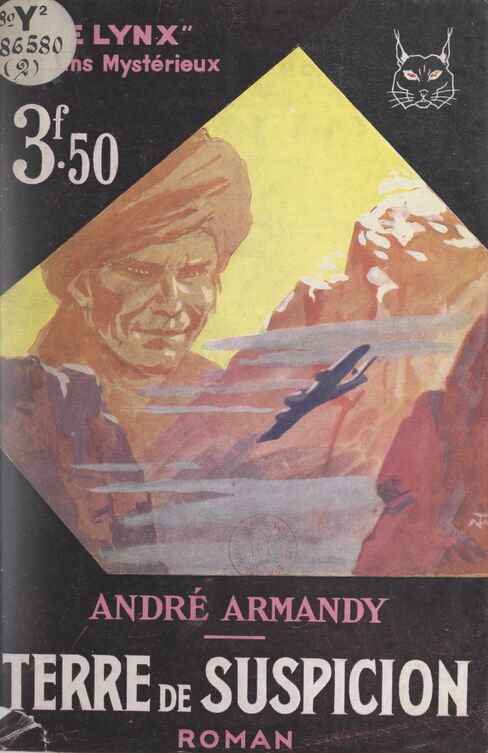Je n’ai pas pu réfréner ma déception lorsque j’ai découvert
l’alliance qu’avait nouée le philosophe Paul B. Preciado, qui ne cesse
d’affirmer la portée révolutionnaire des mouvements féministes, trans,
queer, anti-racistes et intersexuels, avec la grande marque de luxe
Gucci. En novembre 2020, le géant de l’industrie du luxe s’est
momentanément aventuré au-delà des critères normatifs qu’il célèbre et
façonne généralement, en dévoilant sa collection printemps-été 2021 à
travers une série de sept publicités qui soutiennent la visibilité de
corps non binaires et de sexualités dissidentes. C’est dans le premier
épisode de cette série publicitaire, co-réalisée par le cinéaste Gus Van
Sant et le directeur artistique de Gucci, Alessandro Michele, que
Preciado intervient pour annoncer l’avènement de la « révolution de
l’amour ».
Après que le collectif artistique Claire Fontaine ait pris la liberté
d’investir le défilé prêt-à-porter automne hiver 2020-2021 de Dior avec
des citations de Carla Lonzi – celle-là même qui, après avoir quitté sa
carrière de critique d’art pour se consacrer à la révolte féministe,
enjoignait toutes les femmes à déserter le monde de la culture – [1],
il n’y avait peut-être pas de quoi se laisser surprendre par la
participation de Preciado au « Gucci Fest ». Or si j’ai été déçue, c’est
que j’avais d’abord été enthousiaste, que j’avais cru que sa pensée
pouvait aider, voire devenir une puissante boîte à outils pour
développer collectivement de nouvelles relations au corps et à la
sexualité, adopter des positions non binaires, historiciser le paradigme
de la différence sexuelle en tant que rouage du régime
patriarco-colonial, et pour inscrire les mouvements féministes, trans,
queer, anti-racistes et intersexuels dans un horizon stratégique à la
fois joyeux et résolument anticapitaliste et décolonial.
S’efforçant de nommer l’émergence d’un nouveau paradigme de gouvernement dit « pharmacopornographique [2] »,
Preciado appelle pour en prendre acte à la formation d’une nouvelle
épistémologie munie d’un nouvel appareillage conceptuel (d’où son usage
quelque peu abusif, mais somme toute légitime de néologismes de plus de
20 caractères) et pour y répondre à la mutation des formes de luttes et
stratégies d’alliances. Il y a quelque chose de profondément réjouissant
dans son geste théorique qui, lorsqu’il s’attache à rendre lisibles les
les dispositifs de gestion des corps et les rapports de force
asymétriques qui déterminent la configuration politique contemporaine,
prend toujours soin de cultiver la puissance d’agir et d’affirmer les
potentiels révolutionnaires des luttes collectives, pratiques de
résistance et nouvelles formes de subjectivations politiques, qu’il juge
d’autant plus puissantes qu’elles produisent désormais un savoir sur
elles-mêmes.
Le paradigme contemporain de gouvernement serait
« pharmacopornographique » au sens où la régulation des corps et des
subjectivités sexuelles passerait moins par les institutions
disciplinaires (école, usine, hôpital..) que par un ensemble de
technologies biomoléculaires (panoplie de pilules et de traitements,
allant des antidépresseurs au viagra en passant par la pilule
contraceptive) et de technologies digitales (téléphones portables,
cartes de crédit, GPS et autres dispositifs de surveillance globale).
Ces technologies seraient « pornographiques » au sens où elles
fonctionneraient par l’incitation à la consommation et à la production
de plaisir, plutôt que par la répression. Selon Preciado, la gestion du
coronavirus aura été exemplaire de cette reconfiguration politique :
faisant explicitement de l’espace privé du foyer le nouveau centre de
production, de consommation et de contrôle politique, les technologies
de gouvernement cultiveraient un sentiment d’immunité qui nous
pousserait à nous laisser enfermer dans la « prison molle de nos
intérieurs ». Par ce concept d’« immunité », qu’il reprend au philosophe
Roberto Esposito [3],
Preciado arrime le régime pharmacopornographique au fantasme libéral
d’un corps protégé, indépendant et radicalement séparé, exonéré de toute
obligation envers la communauté. À cette vision du corps serait
corrélative une certaine conception de la communauté en tant que corps
collectif immunisé capable de se protéger des corps impurs ou étrangers.
À l’échelle de l’Europe, par exemple, une telle politique immunitaire
impliquerait la fermeture des frontières à l’Est et au Sud, ainsi que la
régulation des minorités racisées et des populations migrantes, jugées
dangereuses : « tout acte de protection comporte une définition
immunitaire de la communauté, qui implique de s’octroyer le pouvoir de
décider de sacrifier une partie de la communauté, au bénéfice d’une idée
de sa propre souveraineté [4] ».
Il pointe ainsi le grand paradoxe de la biopolitique qui, tant décriée
pendant le confinement en tant que pouvoir qui prend pour objet la « vie
même », aurait surtout pour corollaire ce qu’Achille Mbembe nomme la
« nécropolitique [5] » :
un vaste éventail de techniques d’exclusion, d’enfermement, d’abandon
et de mises à mort légitimées par l’évaluation souveraine de la valeur
de certaines vies au détriment d’autres vies – geste paradigmatique du
régime colonial selon Mbembe. Selon Preciado, la gestion du virus aurait
accéléré l’extension tendancielle des techniques nécropolitiques à la
planète entière, en enfermant certains dans « la prison molle de leur
intérieur » tout en en exposant d’autres à l’abandon et à la mort.
Dans ce type d’analyse, comme dans la plupart de ses textes récents,
Preciado s’efforce de retracer la cohérence interne par laquelle
s’articulent les politiques hétéropatriarcales, capitalistes, coloniales
et extractivistes. Ses analyses du paradigme de la différence sexuelle [6]
et des processus de subjectivation se fondent généralement sur une
compréhension matérialiste des processus d’appropriation et
d’accumulation capitalistes qui ont historiquement pour conditions de
possibilité la production de corps subalternes et racisés, la
naturalisation de la différence sexuelle et de l’hétérosexualité ainsi
que, entre autres constructions, l’invention du corps blanc normalisé,
l’exaltation de la virilité conquérante et le culte de l’universalité
prédatrice. Par ces liens qu’il établit, la pensée de Preciado dessine
de nouvelles perspectives de luttes et d’alliances que la gauche a la
fâcheuse habitude de juger parcellaires, limitées et trop fragmentaires
pour constituer de véritables menaces à l’ordre existant. Il n’est bien
entendu pas le premier à proposer de telles conceptions, et ne cache pas
ses dettes envers le grand nombre de chercheuses et de militantes
féministes d’horizons divers qui nourrissent son répertoire théorique.
L’un des thèmes importants de sa pensée est cette idée que la
mutation est aussi une occasion à saisir, hors de toute nostalgie pour
un passé fantasmé ou une pureté qui n’a jamais existé. La stratégie à
adopter serait donc de se réapproprier ces technologies de gouvernement
pour les détourner, les altérer au profit de l’invention de nouvelles
relations au corps, notamment libérées des codes normatifs du genre et
de la sexualité, et plus largement « de nouvelles stratégies
d’émancipation cognitive et de résistance », de la mise en marche de
« nouvelles formes d’antagonisme » et de « coopérations planétaires » [7].
Dans une même optique, ces réappropriations des technologies peuvent
favoriser la production et la diffusion, par les minorités et
subalternes d’un savoir sur eux-mêmes, tel que ce pu être le cas, entre
autres exemples, avec le mouvement #MeToo.
De là, on peut imaginer que c’est précisément ce genre de
réappropriation critique que Preciado cherchait à exemplifier en
devenant, au côté d’autres corps non binaires, le protagoniste d’une
publicité de Gucci prenant la forme d’un court-métrage de 18 minutes. Il
y apparaît à la télévision – on appréciera l’habile mise en abyme –
pour diffuser des éléments de la théorie queer en bruit de fond dans le
salon (le même salon qui, étant désormais le centre privilégié de
production des corps et des subjectivités, se révèle du même coup en
tant que terrain privilégié de la lutte).
Quoi que l’on puisse penser de l’alternative posée par Preciado, entre « soumission et mutation [8] »,
le refus de la pureté dont il se réclame me semble assez porteur pour
qu’il soit nécessaire de nous y arrêter. La pureté, d’un point de vue
politique, est un mot galvaudé qui peut vouloir dire beaucoup de choses.
Le terme peut par exemple être employé (négativement) pour désigner un
attachement au passé ou à la « nature », ou encore le refus de
l’hybridité, de l’altération et de toute forme de transformations
perçues systématiquement comme des pertes. La pureté est alors plus ou
moins synonyme de conservatisme. Le mot pureté sert aussi souvent à
mettre en distance une certaine forme de moralisation de la politique
qui, hors de toute considération tactique ou stratégique, est tout
entière orientée vers la mauvaise conscience, la culpabilité, la honte
ou l’obsession d’être irréprochable en toutes circonstances, en tant que
marqueurs individuels de conscientisation ou de cohérence. La pureté
est alors synonyme de moralisme.
Dans ce dernier cas de figure, le danger est d’utiliser le prétexte
du refus de la pureté pour balayer, en renvoyant de côté de la morale –
c’est-à-dire en recodant moralement – des enjeux résolument politiques,
qui relèvent en fait de la stratégie, de la tactique ou de l’évaluation
des forces en présence, comme celui de l’alliance, par exemple.
Apprendre à départager entre nouer de bons ou de mauvais rapports, de
manière à défendre certaines manières de vivre plutôt que d’autres, ne
relève pas de la morale, mais d’une disposition éthique indispensable à
qui souhaite combattre ce qui propage la dévastation, l’exclusion, la
précarité et la mort, et espérer construire un monde commun habitable.
Donna Haraway, souvent citée par Precidao, se méfie elle aussi de
l’idéal de pureté, mais elle ne le fait jamais sans affirmer les
exigences de « respons(h)abilité [9] »
et de non-innocence. Impliquant de ne jamais détourner le regard, ces
exigences doivent selon Haraway informer les pratiques et « symbioses
politiques » par lesquelles nous nous lions à certains mondes plutôt qu’à d’autres.
Et ce, que l’on adopte une conception belliqueuse de la politique
suivant un axe ami/ennemi, ou qu’on lui préfère des configurations plus
complexes rendant compte de la multiplicité des acteurs et des couches
d’histoires dans lesquels ils entrent en rapport.
Dans une analyse critique de la participation de Preciado à la publicité Gucci, traduit dans le 10e numéro de la revue Trou noir [10],
Miquel Martínez commence par quelques considérations, qu’il considère
élémentaires, concernant les processus de production délocalisée et les
relations d’asymétrie néocoloniales, les dégâts dévastateurs sur les
territoires et l’environnement, et l’exaltation du luxe mis en œuvre par
les géants commerciaux de la veine de Gucci. Sans nier la sincère
tentative de Preciado d’accroître la visibilité des corps trans et non
binaires, et des discours et pratiques subjectives dissidentes, on peut
douter avec lui de la portée qu’une telle intervention peut avoir alors
qu’elle s’enracine dans un « décor agencé pour la jouissance des
élites » qui a pour conditions matérielles l’appropriation,
l’exploitation et la destruction. Outre les ravages inhérents à son mode
de production, l’industrie du luxe est l’incarnation du culte de la
richesse et de la recherche débridée de distinction ; elle est vectrice
d’un cynisme satisfait et du désir de nager, au-dessus de la mêlée, dans
l’abondance et la magnificence privatisées : l’expression la plus
radicale de l’immunité politique des puissants. Dans un entretien qu’il
accorde aux Inrocks, Preciado affirme qu’il n’avait jamais eu
autant de liberté qu’en travaillant avec Gucci – alors qu’il a récemment
connu la censure au musée d’art contemporain de Barcelone –, qu’il ne
lui avait jamais été demandé de retoucher le texte qu’il avait proposé. [11]
Or que cette même industrie du luxe ait la capacité de s’entourer des
plus grands génies créateurs, qu’elle accorde à ses collaborateurs une
liberté créative sans limites est dans l’ordre des choses : c’est la
puissance qui lui est propre, le sens même de son activité. Au sein
d’une configuration politique marquée par le libéralisme, ce n’est que
lorsqu’ils craignent les représailles ou qu’ils sentent leur pouvoir
menacé que les médias et les institutions s’adonnent à la censure.
Il est entendu, tel que l’affirme Preciado, que les constructions
sociales et historiques de genre, de race et de sexualité, les pratiques
de filiation, les relations au corps et plus largement l’instauration
de hiérarchies entre les êtres opèrent et se reproduisent au moins en
partie via un ensemble de dispositifs de représentations, de discours et
de conventions parmi lesquels figurent la mode et les productions
culturelles, et que pour cette raison même le plan de la représentation
ne peut politiquement être déserté. Certes, « la production d’images est
un espace d’action politique [12] »,
de même que la production des mots et des discours. Or le poids, le
sens et la portée des mots et des images, de même que les affects dont
ils sont porteurs et leur puissance d’interpellation sont toujours liés à
leur contexte d’énonciation et de création, et non seulement à
l’ampleur de leur audience. Que les technologies de gouvernement et les
systèmes de représentation puissent être détournés ne saurait en aucun
cas signifier que, dans leur immatérialité apparente, ils existent dans
un univers séparé, que leur matérialité, leur histoire, les
infrastructures et les intérêts qui les soutiennent n’interfèrent pas
dans les processus de subjectivation qu’ils contribuent à mettre en
œuvre. Du reste, on ne s’empare pas de l’appareil publicitaire de Gucci
comme d’un réseau social qui, se disant démocratique, doit le rester au
moins assez pour éviter d’être remplacé par une application libre. Tous
les dispositifs ne sont pas équivalents, ils n’offrent pas tous les
mêmes marges de manœuvre, n’ont pas tous le même pouvoir de capture ni
le même impact sur l’équilibre des forces. Pour le dire autrement, ce
n’est pas parce que l’on intervient sur le plan de la représentation que
tous les antagonismes s’évanouissent par magie. Comme l’affirme Jason
Moore, les infrastructures du capital ne sont jamais neutres : elles
produisent sans cesse le monde propice à leur déploiement. Le
capitalisme n’est pas une idéologie, mais une écologie, une
« écologie-monde [13] »
qui a pour seul rempart à l’autodestruction un processus toujours plus
étendu et plus raffiné d’appropriation. C’est le sachant bien que
Preciado rappelait, dans un texte récent, que les technologies de
gouvernement ne sont jamais que des « dispositifs de communication », et
que, dans un élan de pureté radicale qu’il devait plus tard réprouver,
il nous enjoignait à nous désaliéner collectivement : « Éteignons nos
téléphones portables, déconnectons l’Internet. Faisons le grand
black-out face aux satellites qui nous observent et réfléchissons
ensemble à la révolution à venir. [14] »
Sans forcément aller jusqu’à de telles extrémités ni exiger de
nous-mêmes un tel degré de pureté, nous pourrions commencer plus
modestement par tenir quelque distance avec l’industrie du luxe qui,
dans l’écologie monde du capitalisme, n’a jamais eu d’autre mode
opératoire que l’arrogance des élites et, comme principale force
d’attraction, la production du désir d’être sujet, et non plus objet, de
cette arrogance. La féministe Maria Lugones, figure importante des
pensées décoloniales, définit la perception arrogante comme une
disposition qui permet de vampiriser l’autre sans s’identifier à lui, et
sans être affecté d’aucune manière par la relation asymétrique à
l’œuvre. Radicalement dépourvue d’amour, elle permet de ressortir intact
de l’abus de l’autre, « sans aucun sentiment de perte [15] ». Voilà
l’affect dont l’industrie du luxe est capable, voilà aussi pourquoi il
apparaît peu raisonnable de lui confier le devenir de la révolution de
l’amour, et de croire pouvoir surfer sur sa puissance pour contrer une
violence partriaco-coloniale qui est partie intégrante de son
métabolisme.
Que l’industrie du luxe suce les énergies minoritaires,
contre-culturelles et dissidentes pour nourrir son monde n’a
certainement rien de bien nouveau. Il reste toutefois plus surprenant de
voir des figures de penseurs révolutionnaires franchir le pas et, de
leur propre chef, décider de participer activement à l’opération de
capture. Comme l’affirme Donna Haraway, assumer de se lier à un monde
plutôt qu’à un autre ne suppose ni pureté, ni retrait hors du monde,
mais exige au contraire d’être animé par la conviction que les relations
comptent, que les alliances font la différence et prêtent à conséquence
lorsqu’il s’agit de cultiver – et de les défendre contre ce qui les
vampirise et les détruit –, les conditions de possibilité d’un monde
commun habitable, entre autre libéré des constructions de genre, de race
et de sexualité, où expérimenter de nouvelles relations au corps et
pratiques de filiation.
Élise
[1] Carla
Lonzi est une figure importante et radicale du féminisme italien des
années 1970. Elle est notamment l’une des fondatrices du collectif
Rivolta Femminile. Sur l’intervention de Claire Fontaine au défilé Dior,
voir la vidéo « Artist Claire Fontaine on the Dior Autumn-Winter
2020-2021 Set » disponible en ligne sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=B7JjJHUwqCE&feature=youtu.be
[3] Voir notamment : Roberto Esposito, Communauté, immunité, biopolitique. Repenser les termes de la politique, Traduit de l’italien par Bernard Chamayou. Amsterdam, coll. « Les Prairies ordinaires », 2010
[4] Paul B. Preciado, « Les leçons du virus », Op. Cit.
[6] Preciado
envisage le paradigme de la différence sexuelle non comme une simple
vision du monde mais comme une épistémologie politique historiquement
situable, qui produit le patriarcat hétéro-colonial en tant qu’ordre
politique. En parlant d’épistémologie, il se réfère à un « système
historique de représentations, à un ensemble de discours,
d’institutions, de conventions, de pratiques et d’accords culturels
(qu’il soient d’ordre symbolique, religieux, scientifiques, techniques,
commerciaux ou communicatifs) permettant à une société de décider ce qui
est vrai et de le distinguer de ce qui est faux. » (Paul B. Preciado, Je suis un monstre qui vous parle, Rapport pour une académie de psychanalystes, Paris, Grasset, 2020. p. 68).
[8] Paul B. Preciado, « Biosurveillance : sortir de la prison molle de nos intérieurs », Op. Cit.
[9] Donna Haraway, Op. Cit.
[11] Il
ajoute : « Quand j’ai été contacté par Gucci, en principe j’aurai dû
refuser, mais la question ne s’est pas posée comme ça. J’ai appris qu’il
s’agissait d’un film de Gus Van Sant, une référence incontournable du
“cinéma queer”, et que je n’aurais qu’à dire mon propre texte. Puis,
quand j’ai appris que la protagoniste allait être Silvia Calderoni, mes
questions se sont arrêtées là. C’est quelqu’un que j’adore, qui est une
artiste, une créatrice de théâtre, une actrice, metteuse en scène,
activiste, lesbienne très visible en Italie. » (Paul B. Preciado, « La
production d’images est un espace d’action politique », Les inrockuptibles, 7 décembre 2020, [en ligne]
https://www.lesinrocks.com/2020/12/07/style/style/paul-b-preciado-la-production-dimages-est-un-espace-daction-politique/)
[12] Paul B. Preciado, « La production d’images est un espace d’action politique », Op. Cit.
[13] Jason W. Moore, Le capitalisme dans la toile de la vie : écologie et accumulation du capital, traduit de l’anglais par Robert Ferro, Toulouse, Les éditions de l’Asymétrie, 2020.
[15] Maria
Lugones, « Attitude joueuse, voyage d’un « monde » à d’autres et
perception aimante », Les cahiers du CEDREF [En ligne], 18 | 2011, mis
en ligne le 01 janvier 2011, consulté le 24 octobre 2019. URL : http://journals.openedition.org/cedref/684