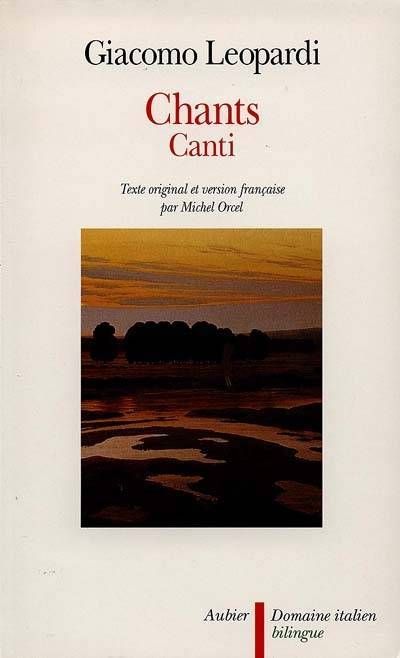L’actualité
législative impose depuis quelques semaines une inquiétude
particulièrement vive à propos de la capture et de la diffusion d’images
des forces de l’ordre. Si la légalité de ces images est aujourd’hui
remise en question, leur légitimité, elle, semble établie : faute
d’images, de nombreux cas de violences n’auraient eu aucune existence
médiatique, voire judiciaire. Mais un bref recul indique que les forces
de l’ordre elles-mêmes ne sont pas fondamentalement rétives à la prise
de vue : quelques éléments d’une généalogie de l’auto-représentation de
la police à l’écran permettent de comprendre l’image de cinéma comme
partie intégrante de l’arsenal des forces de l’ordre.
Les premières années du XXème siècle sont riches de films dont le
statut est difficile à déterminer selon les rubriques classiques de
l’histoire des media. Ni tout à fait actualités filmées, ni
reportages, ni mises en scène de fiction, ces films fonctionnent plutôt
comme attestations du réel : ils servent comme preuves de l’existence,
et comme objets de célébration de corps de métier, de lieux, de gestes
et d’outils par lesquels agissent les forces de l’ordre. La police,
l’armée et les représentants de l’autorité (judiciaire, légale)
constituent des sujets récurrents de ce cinéma d’attestation qui est
aussi un cinéma d’arrestation : exécutions légales et panoramas de prisons [1], interpellations de bandits célèbres [2], plans rejouant l’arrivée de prisonniers de guerre [3], charges de police montée [4].
Ces séquences, prises sur le vif ou reconstituées, sont toutes motivées
par le désir de produire une image emblématique et iconique de l’action
des forces de l’ordre. En d’autres termes, les reconstitutions n’ont
pas de valeur iconique dégradée par rapport à la captation de
l’événement originel. La raison d’être et la fonction de ces images,
natives ou reconstituées, reste la même : faire participer le cinéma à
la connaissance et à la reconnaissance des forces de l’ordre, afin de
susciter à la fois crainte et admiration.
Cinq films produits entre 1896 et 1905 expriment les formes et les
fonctions de ces portraits cinématographiques de l’institution. Le
cinéma y sert de véhicule à l’auto-représentation des forces de l’ordre,
ce qui constitue une fonction surprenante dans l’histoire des rapports
de surveillance : avant d’être employés à des fins de détection du
crime, les dispositifs de prise de vue ont servi à générer des images
idéales de la force publique en action. Ces films illustrent un
processus d’arrestation, au sens légal du terme, mais aussi au sens
physique : la police exerce un pouvoir d’immobilisation sur les corps
animés, vus à travers le cinématographe. Mais l’étude de ces films
révèle également des failles dans ce portrait glorifiant. Ces films
laissent paraître, en bordure des images, des gestes et des attitudes de
distanciation, voire de résistance à la prise de vue. Ces « gisant dans l’image ; traces fugaces échappées à la volonté ou à l’attention de l’opérateur, [qui] lancent un message en direction du futur » [5]
fissurent alors le portrait de l’institution, esquissant, dans la
représentation cinématographique, l’hypothèse d’une insubordination des
corps filmés.

1. Mounted Police Charge, 1896
En octobre 1896, l’opérateur William Heise filme pour Thomas Edison
une troupe de police montée, dans une large allée de Central Park, à New
York. Lancés au galop, une vingtaine de cavaliers s’approchent de la
caméra placée en face d’eux, au milieu de la route. L’effet est proche
de celui décrit, à propos de la projection de L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat, au début de la même année [6].
Mais ici, les cavaliers interrompent leur galop à quelques mètres de
l’appareil, domptant leur monture dans un même mouvement de
ralentissement collectif, et achèvent leur course face à la caméra,
quasiment immobiles. En première ligne, leurs visages sont presque
identifiables.
La Librairie du Congrès des Etats-Unis classe ce film, Mounted Police Charge,
dans la catégorie des « actualités ». Pourtant, il ne relate aucun
événement singulier pouvant se rapporter à un fait temporaire et
marquant, relatif à un épisode identifiable de l’Histoire ; cette
« charge » n’a pas la valeur d’un instant signifiant, rare, ou d’une
séquence de conflit - comme les dizaines de vues du tournant du
vingtième siècle, illustrant des prises de guerre ou des mouvements de
troupes lors de la guerre des Boers. On imagine plutôt que ces
mouvements à cheval étaient répétés fréquemment, dans des exercices
d’entraînement des troupes. Les faits et gestes illustrés dans Mounted Police Charge
ont probablement eu lieu des dizaines de fois. On peut même deviner
qu’ils étaient soumis à une répétition supplémentaire, impliquée par le
processus de prise de vue : d’une part, la répétition imposée par la
discipline de la cavalerie et l’apprentissage de l’art de monter en
selle et, de l’autre, celle qu’ont dû imposer les opérateurs au moment
du tournage, afin d’obtenir une prise satisfaisante. Ce film n’est donc
pas justifié par la capture d’un événement rare, mais par la volonté de
produire une image « réussie » de la police montée capable d’arrêter,
d’un seul mouvement, sa monture.
Ce qui compte, dans Mounted Police Charge, ce n’est pas la
course d’une part ou la pose terminale, figée, par laquelle s’achève le
film. C’est précisément le passage d’un état à l’autre, du mouvement
emballé mais maîtrisé de la troupe à sa halte, le passage de l’agitation
à l’interruption. La stase est l’état des corps filmés qui se
manifeste alors ; c’est l’état de l’image arrêtée qui exprime, par cet
arrêt même, sa puissance de gestion et de maîtrise du mouvement. L’image
cinématographique se fait statufiante, non par l’interruption
mécanique du mouvement, mais par l’exhibition d’un corps collectif
capable de dompter son propre mouvement. Car l’art de monter à cheval et
de maîtriser sa monture est, par essence, un art de la stase, qui
aboutit, s’il est réussi, à l’aspect d’une image arrêtée. La troupe de
police montée est un sujet qui produit des images stasiques, qui
expriment en puissance le mouvement qu’elles contiennent et qu’elles
sont capables de moduler, jusqu’à l’arrêt. La stase caractérise l’état
d’un mouvement ramassé, contenue en une image d’apparence arrêtée.
Dans Life of an American Policeman d’Edwin S. Porter (1905),
portrait de la police en action dans diverses situations du quotidien,
le sauvetage à cheval figure parmi l’éventail des interventions assurées
par les agents. Dans les allées d’un grand parc, une cavalière voit sa
monture affolée par le passage d’une automobile. Le cheval détale, frôle
un agent de la police montée qui prend la bête en chasse, la rattrape,
l’immobilise, et saisit la cavalière, épuisée, qui tombe de selle à
moitié évanouie. Cette séquence fait nettement écho à la pose
triomphante de Mounted Police Charge. Dans un film comme dans
l’autre, la police fait montre d’un double pouvoir d’immobilisation : de
soi (de sa monture ou d’une monture en furie), et de l’image qui
soutient sa propre représentation. Il n’y a donc pas lieu de dire, ici,
que le cinéma d’arrestation procède par régression, par rapport
au pouvoir vivifiant ou thaumaturge de l’image cinématographique. Au
contraire, cet acte d’immobilisation est la condition de représentation
de la police montée comme corps maître de soi et maître de l’image de
cinéma. Le mouvement s’interrompt dans un geste de maîtrise qui est à la
fois l’exploit lui-même et ce qui rend sa représentation possible :
l’exploit de la maîtrise de la monture et la condition d’avènement d’une
image stable, lisible, de la police. L’arrêt de l’image ne vaut pas ici pour arrestation
(au sens de capture, neutralisation presque déjà punitive) mais pour
stabilisation. C’est aussi le principe de la « parade à l’arrêt », comme
on pourrait la qualifier, de Mounted Police Charge : culminer
dans une image du réel qui dépasse la simple captation d’apparences
passagères et anodines (un exercice équestre, un jour d’octobre 1896 à
Central Park), exprimer les qualités de la police en général. Le cinéma
semble ainsi générer une image exemplaire de la police par la stase.
Si Mounted Police Charge produit une représentation
symbolique, voire fantasmatique, de la police en troupe de cow-boys, ce
film vise également une efficacité rhétorique bien précise, et s’inscrit
dans un instant déterminé politiquement et lisible historiquement. Les
effets de la représentation sublime de la police montée prennent sens
dans un contexte politique particulier.
Il est probable que les spectateurs Nord-Américains de cette époque
aient eu en mémoire quelques images des troupes de la Police Montée de
Natal (PMN), force établie en 1873 dans le but de soutenir l’action
coloniale britannique face aux rebelles de l’ancien Natal, actuelle
région du nord-est de l’Afrique du Sud, et démantelée en 1892 [7].
Ces forces hybrides, composées de natifs du Natal et de Britanniques,
occupaient des fonctions diverses, de la réglementation des commerces à
l’escorte de prisonniers, de la patrouille routinière à l’exécution de
tâches douanières [8].
Initialement restreinte d’un point de vue logistique, la PMN connut une
certaine gloire à l’issue de la bataille d’Isandhlwana, premier
affrontement majeur du conflit anglo-zoulou, en janvier 1879. La presse
reconnut la participation et la mort de nombreux membres de la PMN [9], ce qui contribua à dorer le blason de ce groupe qui souffrit de l’ambiguïté de son statut, entre force de police [10] et troupe à vocation militaire [11].
Difficile d’imaginer que ces troupes britanniques, loin de Londres et
encore plus des Etats-Unis, ont pu déterminer l’imaginaire collectif
lié à la police montée - la seconde guerre des Boers apportera un lot
plus conséquent de représentations, notamment cinématographiques, des
troupes à cheval. En revanche, une étude des débats portant sur
l’organisation de la police d’Etat entre 1899 et 1923 permet
d’appréhender plus spécifiquement le problème politique et culturel de
la police à cheval. Dans un article de 1924 [12],
Margaret Mary Corcoran synthétise ces débats : la police montée était
d’abord un corps actif dans des zones aux terrains rugueux, difficiles
d’accès, surtout au Canada et dans les régions montagneuses du
nord-ouest des Etats-Unis. Leur déploiement en milieu urbain n’est pas
allé de soi. Corcoran rapporte notamment de vives critiques à propos de
la militarisation de la police « montée et armée », et de la violence de
son action de répression lors de grèves ouvrières [13].
Elle fait également état d’avis contraires, qui défendent ardemment la
police montée, et mobilisent des arguments interprétables à la lumière
des images de Mounted Police Charge. Dans un texte de 1912 sur la
« police rurale », Charles Richmond Henderson défend cette force
« disciplinée, aux chevaux nobles, nés d’Arabes et de mustangs, prêts à
détecter, traquer, traduire devant les tribunaux, et punir les
hors-la-loi » [14].
La légitimation de la police à cheval passe ici par un retour à la
figure du maître pacificateur et justicier du far-west sauvage, capable
d’instaurer l’ordre et la « civilisation » [15].
Cet ordonnateur mythique ressemble à l’officier surveillant d’une sorte
de cavalerie de tous les jours, qui assure au quotidien le sauvetage
des innocents. Cette figure est syncrétique : le policier à cheval est à
la fois limier, détective, justicier et bourreau de tout individu
s’opposant au bon déroulement de la vie et au labeur des fondateurs de
la civilisation occidentale en train de s’établir sur des terres prises
aux populations amérindiennes largement considérées comme hostiles. Il
est avant tout celui qui rétablit l’ordre, de la même manière que
la police montée rétablit, à l’écran, la docilité de sa monture et la
pacification du mouvement en une image stable.
Les arguments en faveur de la police montée mobilisent ainsi la
figure du justicier garant de l’ordre dans les contrées sauvages. La
police montée se légitime par mythification davantage que par de stricts arguments rationnels ou statistiques. Un retour à Mounted Police Charge
permet une hypothèse quant au rôle du cinéma dans ce processus : ce
film présente, par le ralentissement des corps et leur transformation en
image réminiscente des héros du grand Ouest, une ressemblance entre le
policier à cheval et le héros des plaines sauvages, qui joue en faveur
des forces de police. Le sujet filmé construit lui-même son propre arrêt sur image, transformant l’image de cinéma en médaillon à sa propre effigie, et s’offrant aux réminiscences qui le légitiment.
Le dispositif de Mounted Police Charge fonctionne ainsi par rétention du mouvement, et produit donc une sensation de régression du cinématographique en photographique. Sensation seulement : « l’irruption violente du photographique » [16],
comme la décrit Raymond Bellour, est ici une condition de
représentation du pouvoir d’immobilisation (de la monture et du
défilement de l’image) qui signe la gloire du sujet représenté. On
parlera de l’effet statufiant de cet arrêt sur image organisé par
le sujet filmé lui-même, et non par une intervention sur le défilement
des photogrammes : c’est le processus par lequel l’image
cinématographique, en figeant le mouvement d’un individu ou d’un groupe
d’individus, acquiert la fonction et l’apparence d’une statue d’hommage,
c’est-à-dire d’une pose honorifique ramassée en une seule image fixe. À
l’écran, cette image est d’apparence photographique : elle est donc
bien davantage qu’une interruption pure et simple du mécanisme
d’animation cinématographique. Son immobilité est la résolution d’un
mouvement sous une forme arrêtée. L’image qui s’est interrompue est
encore vibrante du mouvement qu’elle contient. Les cavaliers de Mounted Police Charge
semblent ainsi prendre en charge le dispositif tout entier et devenir
les monteurs de leur propre portrait cinématographique, dressant à la
fois leur monture et l’image elle-même.
2. Grandma and the Bad Boys, 1900 ; Policeman and Burglar, 1901
Bien sûr, l’arrestation par l’image concerne davantage les cibles des
forces de l’ordre que les forces de l’ordre elles-mêmes. Elle sert plus
souvent à assurer le contrôle d’individus qu’à rendre hommage ou à
glorifier les agents. Allan Sekula [17], François Brunet [18] et John Tagg [19]
ont montré l’inscription progressive de la photographie dans le
quotidien des institutions d’internement et d’incarcération, cliniques
et asiles, orphelinats et maisons d’arrêt. Aujourd’hui, les archives
photographiques de ces milieux témoignent de ce que l’on pourrait
qualifier de routine photographique, comme on pourrait qualifier
le passage procédural devant l’objectif de l’appareil, à des fins de
mise en registre et d’identification des individus. Routine
photographique, et bientôt cinématographique : le regard surveillant
occupe une place capitale dans la construction narrative et esthétique
du cinéma des premiers temps. Tom Gunning a décrit l’esthétique du
« pris sur le vif » qui traverse ces films, à la fois en tant que sujet
de fiction et en tant que principe structurant de la narration [20].
Ce qui est pris, c’est le coupable, plus souvent que le policier. Mais
la dimension punitive de l’arrestation est indissociable de sa dimension
glorifiante pour le pouvoir qui l’accomplit.

Dans des films analysés par Gunning, comme Chicken Thieves (James H. White, 1897) ou Subub Surprises the Burglar
(Edwin S. Porter, 1903), un personnage tente de commettre un larcin,
pénètre dans un lieu interdit, enclos ou chambre à coucher. Il se trouve
alors puni par exhibition, forcé de soumettre son image à l’autorité.
Ce qui est capturé, c’est d’abord une image [21]. On trouve ce processus illustré dans plusieurs films tournés autour de 1900. Dans Grandma and the Bad Boys
(James H. White, 1900), deux garnements truquent une lampe à pétrole
dans la cuisine de leur grand-mère. Ils remplissent de farine le tube de
la lampe et se cachent sous une table. La femme entre, manipule la
lampe qui ne fonctionne plus et se trouve enfarinée. Elle saisit les
deux enfants et les plonge dans un tonneau de farine, puis les force à
s’asseoir de face. La farine, masque blanc, est d’abord un instrument
employé par les enfants pour tendre un piège ; elle se retourne ensuite
contre eux en devenant la matière première de leur châtiment, en
rehaussant la visibilité de leur visage tordu par les larmes, dessinant
ainsi le masque de leur culpabilité.
La farine permet l’acte d’image [22]
punitif que l’on trouve mis en scène dans plusieurs films tournés
autour de 1900. Ces masques collés au visage des garnements, cette
seconde peau accusatrice leur inflige d’être visibles. S’opère ainsi un
glissement de la complicité avec le spectateur : d’abord partagée avec
les garnements qui préparent leur mauvais coup, cette complicité lie
ensuite la grand-mère au spectateur du film devenu témoin de
l’humiliation. La capture forcée d’une image est déjà un geste
emblématique, à la toute fin du 19ème siècle, de l’exercice d’un pouvoir
d’identification et de surveillance des individus. La visibilité, ce
« piège » [23]
selon Foucault, s’inflige. Le marquage des coupables a changé de
forme : il ne s’inscrit plus littéralement dans la peau, par mutilation,
mais dans l’image prélevée de force aux individus jugés coupables.
On trouve un tel geste de capture photographique impérative dans Policeman and Burglar,
tourné en 1901 par George Albert Smith, ancien hypnotiseur et pionnier
du cinéma des premiers temps britanniques. Le dispositif est simple,
commun à des dizaines de films produits autour de 1900. Un voleur
cherche à échapper à un agent de police. Il tente de passer par une
porte située au centre de la scène, dans l’étroite profondeur de champ,
puis par une fenêtre creusée dans le mur de droite. Les deux hommes
luttent, tombent et roulent à terre, le policier maîtrise finalement le
malfrat. Puis, après un cut, l’agent présente le voleur de
manière frontale, dans l’axe de visibilité construit par l’angle de la
caméra, comme s’il l’offrait à la vue des spectateurs [24].
L’arrestation est double : elle passe par la capture et
l’immobilisation du corps, et, ce qui est plus déterminant encore, par
l’immobilisation d’une image du coupable. Comme dans Grandma and the Bad Boys, l’exposition frontale du malfaiteur acte sa soumission complète au système de surveillance.
La valeur de ce dernier plan (l’individu coupable brandi par l’agent,
dans une pose immobile) est complexe. Elle constitue d’abord une sorte
de portrait judiciaire de l’individu neutralisé, exposé et ex-posé, à la
fois capturé et dédoublé en une image à l’arrêt. En cela, le
plan a valeur d’insert, l’exhibition de l’individu immobilisé équivalant
à un coup d’œil sur le portrait de sa fiche signalétique. Mais ce
dernier plan vaut aussi pour icône du triomphe du pouvoir de capture, ou
pouvoir captivant, de la police : ce n’est pas seulement le
portrait d’un individu arrêté, c’est aussi celui de l’agent qui exerce
son pouvoir d’immobilisation. On trouve deux portraits réunis dans le
même plan : à côté du visage du captif se trouve celui du policier, qui
le tient comme un chasseur présente sa proie. Ce double portrait vaut
pour exemple et modèle de la capacité de la police à neutraliser les
individus, en présentant l’agent de police lui-même et sa prise. Le
dernier plan de Policeman and Burglar illustre la double fonction
« honorifique et répressive » du portrait photographique décrite par
Allan Sekula. Le portrait permet à la fois, selon Sekula, l’expression
revendicatrice d’un certain statut social et la production d’une image
de la déviance ou de la pathologie [25].
Versatile, la photographie peut ainsi condamner (l’individu arrêté par
la police) et consacrer (l’agent responsable de cette arrestation) en
même temps. Sa fonction honorifique est comparable à l’effet statufiant
décrit à propos de Mounted Police Charge. L’immobilisation du policier et de sa proie offre une vision statufiée, glorifiante, de l’acte de capture lui-même.
L’immobilisation du cambrioleur préfigure, par l’image, son destin de
captif ; l’image arrêtée est pour lui une cellule avant l’heure. En
revanche, l’immobilité sert le triomphe de l’agent puisqu’elle est la
condition de sa visibilité, après la confusion grotesque de la lutte au
sol. Policeman and Burglar exprime comme un pressentiment du
destin réservé aux agents de police, ridiculisés par tous les héros
burlesques du cinéma hollywoodien depuis les Keystone Cops des années
1910. C’est comme si, en mouvement, les agents étaient toujours menacés
de ridicule, et que seule la pose pouvait servir leur représentation
honorifique, pour reprendre le terme proposé par Sekula. Cette hypothèse
en appelle une autre : les agents de surveillance et de capture de la population sont le sujet d’un cinéma qui leur ressemble,
c’est-à-dire que la représentation filmique des individus chargés de
déceler et d’immobiliser les corps mime, elle-même, ce mouvement qui se
résout par l’immobilisation de l’image.
3. Arrest of Goudie, 1901
Le 2 décembre 1901, la police britannique capture Thomas Goudie,
employé de la Banque de Liverpool recherché dans tout le pays pour avoir
encaissé de manière illicite plus de 170 000 livres Sterling. Arrest of Goudie
révèle les lieu de l’arrestation : de longs plans parcourent les
façades du quartier où se cachait Goudie, arrêté après une traque de
plusieurs mois. La foule est amassée autour de la maison de Berry Street
qui abritait le coupable - une foule vraisemblablement attirée par la
présence de l’équipe de tournage, mais incarnant malgré elle la foule
qui était présente lors de l’arrestation de Goudie. Le film s’achève par
la conduite du coupable au poste de police, tenu aux coudes par deux
inspecteurs. Selon le catalogue du British Film Institute, il est
probable que ce film sans intertitre ait été montré à un public qui
connaissait déjà l’affaire, ou bien à qui les faits avaient été rappelés
à l’occasion de la séance [26].
Arrest of Goudie est tourné et monté très rapidement, et projeté pour la première fois trois jours seulement après les faits, le 5 décembre 1901 [27].
Dans un article retraçant la genèse du film, Vanessa Toulmin note que
la rapidité de production illustre la fonction d’« actualité filmée » du
cinéma des premiers temps, déjà décrite par Charles Musser [28].
Répliquer l’événement sensationnel par les moyens du cinéma, coup sur
coup : voilà qui rappelle fortement la stratégie appliquée par Edwin S.
Porter et Thomas Edison dans leur représentation de la mise à mort de
Czolgosz, l’assassin du président McKinley (Execution of Czolgosz
a été produit et tourné en quatre jours, entre le 29 octobre et le 4
novembre 1901, soit quelques semaines seulement avant le tournage éclair
d’Arrest of Goudie). Toulmin évoque Execution of Czolgosz, dont elle juge les fondus-enchaînés plus « ambitieux » qu’Arrest of Goudie [29].
Elle estime que ce dernier reste cependant un film novateur, ses
producteurs ayant anticipé un nouveau genre à part entière, celui de
l’« actualité reconstituée » (reconstructed actuality) [30]. Or, en observant la nature et le rythme des plans d’Arrest of Goudie, on note qu’ils s’inscrivent dans un régime du ralentissement, voire de l’immobilisation comparable à celui de Mounted Police Charge et Policeman and Burglar et caractéristique du cinéma d’arrestation.

La raison d’être d’Arrest of Goudie est d’abord
topographique : le film a été tourné sur les lieux mêmes de
l’arrestation, dans la rue où les deux officiers ont interpellé le
fugitif après une traque suivie par tout le pays. Or, ce film
« d’actualité reconstituée » décrit les lieux du crime selon une inertie
presque totale, évacuant tout mouvement au sein du cadre. Nous sommes
dans la rue où a eu lieu l’arrestation du siècle, mais nous n’y
déambulons pas : les rues sont figurées en plans fixes interminables.
Toulmin a minuté les deux premiers plans : soixante secondes pour le
premier, cinquante-quatre pour le second, soit près de deux minutes pour
deux plans figurant la façade d’une maison sous un angle, puis sous un
autre angle légèrement différent. En tout, près de la moitié du film est
constitué de plans immobiles. Plans de façade, très littéralement : ce
film consiste à être sur les lieux et se contente de donner du
temps à la simple présence de ces lieux. La pensée barthesienne de la
photographie fait ici retour : Arrest of Goudie ne semble pas
avoir grand-chose d’autre à offrir que le fait d’avoir été là, et de
présenter, sous les yeux de son spectateur, les lieux de l’événement -
trop tard, certainement, mais assez rapidement tout de même pour
présenter le quartier encore « chaud » de l’arrestation de Goudie - et
la foule s’amasse sur le pont, pour assister au tournage, comme elle
s’est sûrement empressée quelques jours plus tôt sur ce même pont pour
assister à l’arrestation.
Deux hypothèses se présentent, à propos de l’étrange longueur des plans d’ouverture d’Arrest of Goudie.
La première est pragmatique, liée aux conditions de projection du film.
La deuxième est relative aux lois propres au cinéma d’arrestation. Le
British Film Institute formule l’hypothèse selon laquelle les
spectateurs avaient connaissance des faits, ou bien que ceux-ci leur
étaient contés pendant le film. L’hypothèse d’un récit en direct,
pendant la projection, constitue la première explication possible quant à
l’inertie de ces deux plans sur la façade de Berry Street : leur durée
est faite pour accueillir la parole d’un bonimenteur ou d’un lecteur
d’actualités. Ces plans paraissent aujourd’hui, en raison de leur
mutisme, étrangement vacants, comme s’il manquait quelque chose.
La seconde hypothèse s’inscrit dans la continuité de notre réflexion
sur le cinéma d’arrestation : au cinéma, l’immobilité sert la mise en
scène du triomphe de la police. Plus encore : il ne peut y avoir de
représentation laudative de la police qui ne culmine dans une image
arrêtée. Les plans fixes de Berry Street ne figurent pas autre chose
qu’une forme de revanche par la lenteur, comme si le temps passé sur les
lieux de l’arrestation, après coup, permettait de faire durer le moment
de la prise du coupable qui, pendant si longtemps, avait fui. Le cinéma
offre ainsi de la durée pure, un bloc de temps continu qui s’oppose à
l’agitation chaotique de la traque de Goudie, largement relayée par les
journaux britanniques [31].
Le cinéma n’a ici d’autre fonction que de prendre son temps, afin de
représenter par une image arrêtée le triomphe sur le fuyard. Double
figuration, donc, de l’arrestation. La première, c’est l’arrestation
comme régime de figuration : le film montre ses sujets à condition de
les statufier, et tout le film tend à prendre la forme d’une série
d’images arrêtées. La seconde arrestation est plus littérale : c’est
celle de Goudie à proprement parler, qui est rejouée par des acteurs
dans la dernière séquence du film. Arrestation des lieux figée par la
prise de vue, arrestation de l’individu figurée par l’interprétation,
par le jeu.
Mais la représentation de l’arrestation prend une troisième forme,
qui ne concerne ni tout à fait la capture d’un lieu (Berry Street) ni
celle d’un individu (Goudie). Cette arrestation prolonge et contrarie à
la fois l’idée d’Arrest of Goudie comme portrait
cinématographique du triomphe de la police. Elle concerne la foule
pressée sur le pont surplombant Berry Street, qui rejoue malgré elle la
nuée de badauds ayant assisté à l’arrestation de Goudie. Ces individus
font presque littéralement partie du décor. Filmer Berry Street, c’est
porter le regard à la fois sur la planque du fuyard et sur les habitants
du quartier, qui constituent eux aussi le « paysage » de Berry Street.
Or cette foule se trouve elle aussi en arrêt, immobile ou presque,
tournée plus ou moins frontalement vers l’appareil de prise de vue. On
imagine difficilement les opérateurs dirigeant les badauds comme des
acteurs ou comme des figurants, et leur ordonnant de s’arrêter, en
nombre, tournés vers la caméra ; il faut imaginer que l’immobilisation
de la foule a eu lieu de manière spontanée.
Ainsi, la présence du cinéma et la présence de la police génèrent une
réaction équivalente de la part de la foule. C’est que le magnétisme de
la prise de vue sur les passants, lors du tournage d’Arrest of Goudie,
imite et rejoue celui qui est advenu lors de l’arrestation de Goudie :
la foule se presse au tournage comme elle s’est pressée à l’arrestation.
Plus encore, cette hypothèse permet d’envisager l’émergence, chez les
individus filmés, d’une conscience d’être vu qui n’opère pas
encore de distinction stricte entre l’être-photographié et l’être-filmé.
L’être-filmé génère une réaction qui ressemble encore, en 1901, à
l’être-photographié : les individus, face à la caméra de cinéma,
s’immobilisent. C’est que les appareils de capture d’images en mouvement
et les appareils de capture photographique se ressemblent : difficile
de savoir, en 1901, si l’on est filmé ou photographié. La pose prise par
la foule est, toutefois, assez méfiante, et ne ressemble pas tout à
fait à la pose que l’on prendrait pour s’offrir à un appareil de capture
photographique : les visages sont tournés furtivement vers l’objectif,
de biais ou par-dessus une épaule. L’attitude de la foule face à la
caméra prend une forme déjà caractéristique de l’attitude rétive
d’individus sous surveillance, qui fera l’objet d’un développement
ultérieur : une certaine rétention dans l’offrande de soi à la caméra,
comme si la foule s’exhibait volontairement tout en entretenant un
certain trouble dans son exhibition, c’est-à-dire en cherchant à rester
partiellement invisible, ou mal visible. La foule ne fuit pas, elle ne
refuse pas complètement d’être filmée, elle reste sur place ; elle se
tient immobile (ce qui lui permettait d’être bien vue sous
l’objectif photographique) tout en restant à distance, en masse
compacte, le visage volontairement mal offert à la lumière, en partie
caché par les cols, les chapeaux et les foulards (ce qui lui assure de
n’être pas si bien vue que cela). Voici, en germe, une attitude
collective de résistance à la prise de vue. Si Arrest of Goudie
répond à la volonté de célébrer l’action de surveillance de la police
britannique, il contient, dans ces plans de foule partiellement rétive à
la prise de vue, des poches de résistance à l’exhibition du monde
soumis au pouvoir policier.
4. Arrest in Chinatown, 1897
Un autre film permet de deviner les limites de la complicité entre les forces de police, la foule et la prise de vue. Dans Arrest in Chinatown
(1897), tourné par James A. White pour l’Edison Manufacturing Company,
un groupe d’hommes suit un convoi de policiers procédant à l’arrestation
d’un individu interpellé. Puis, dans un second plan, l’individu et
plusieurs agents montent dans une voiture à cheval qui entame son trajet
vers le fond du plan. À bord, un agent de police ôte son chapeau et
l’agite en souriant, tourné vers la caméra. On observe ici une
distinction manifeste entre ce que le fait d’être filmé fait à la foule
et ce qu’il fait à la police. Le lever de chapeau du policier exprime
une relation de complicité avec l’opérateur de prise de vue, qui en
retour, inscrit son visage triomphant dans la postérité.
Mais cet œil capte autre chose que le départ triomphant, chapeau au vent, de l’inspecteur. Arrest in Chinatown
est composé de deux plans. Dans le premier, la foule marche au même
pas, guidée par un petit groupe composé des agents et de l’homme qu’ils
interpellent. Au milieu de ce premier plan, la foule se scinde en deux :
une partie semble avoir pris conscience de la présence de la caméra.
Les marcheurs s’immobilisent alors, reproduisant le face-à-face
caractéristique entre une foule et une caméra observé dans Arrest of Goudie.
Ce face-à-face advient quand la foule n’est pas certaine d’être le
sujet de la prise de vue ni d’être même bien visible mais que, par précaution,
elle s’interrompt dans son action et reste en-deçà d’une franche
visibilité (en l’occurence, ici, grâce aux chapeaux enfoncés, maintenant
dans l’ombre, sous le soleil rasant, les yeux de leurs porteurs).

On observe ici une nette distinction entre deux régimes d’exhibition
face à la prise de vue, lorsque la conscience d’être filmés frappe les
individus : d’une part, la foule statufiée par la prise de vue, de
l’autre, l’agent agitant son chapeau, réclamant par de grands gestes un
peu de visibilité. C’est que le film ne construit pas la même image de
tous les individus, et que ces individus eux-mêmes en semblent
conscients. Certains interrompent leur marche et adoptent une attitude
qui ressemble à celle de la foule de Berry Street, et qui consiste à se
détourner partiellement de la caméra, tout en gardant un œil sur elle.
Alors l’interruption du cortège brise l’unité du tableau : en
s’immobilisant, les quelques hommes cessent soudain de participer au
mouvement collectif qui voit la police mener la foule derrière elle.
Ceux qui s’arrêtent se placent comme en-deçà du film en train de se
tourner. La conscience d’être filmés les pousse à briser le régime de
figuration en désignant, par l’arrêt et le regard furtif, la présence du
dispositif de prise de vue. Cet arrêt signifie aussi que les acteurs de
l’événement en deviennent les spectateurs : la conscience d’être filmé
provoque une désolidarisation de la foule, qui cesse de participer au
cortège à partir du moment où elle se sait vue. S’arrêter sous l’œil de
la caméra, c’est ici refuser de se donner pleinement en tant que foule.
Les corps à l’arrêt, chapeau en visière, ne participent plus à la
figuration orchestrée par le dispositif de prise de vue.
Le chapeau de l’agent acquiert lui une fonction radicalement
différente, et même opposée : agité comme un foulard au départ d’un
paquebot, il cherche au contraire à attirer le regard. C’est un au
revoir et un salut à la fois. Tout le contraire des chapeaux portés par
la foule d’Arrest in Chinatown comme d’Arrest of Goudie,
qui forment des caches. Pour l’agent, le chapeau sert de signal. Il doit
permettre, agité, de devenir visible. La foule et l’agent semblent donc
partager un instinct commun à propos de la caméra : il faut s’agiter
pour être visible, s’arrêter pour ne pas l’être. L’agitation de l’agent a
pour fonction d’attiser la prise de vue, quand l’immobilité constitue
pour la foule une forme de discrétion.
On peut ainsi identifier le retour de l’effet statufiant du cinéma évoqué à propos de Policeman and Burglar :
la prise de vue déploie ici aussi une puissance de célébration des
forces de l’ordre, en immortalisant la prise et le triomphe de l’agent.
Mais la caméra capte aussi des réactions périphériques qui ne concernent
pas la mise en scène de la police mais en forment le pourtour ou,
pourrait-on dire, le milieu. Policeman and Burglar est tourné en
studio ; la mise en scène est entièrement dévouée à la représentation de
la police et de sa prise, tout ce qui ne concerne pas cette
représentation a été évacué. Dans Arrest of Goudie et Arrest in Chinatown,
les conditions de tournage en pleine rue laissent transparaître des
éléments périphériques, des morceaux du monde, des attitudes
accidentelles, incontrôlées par les producteurs du tournage, et qui
n’entrent donc pas dans le jeu de complicité tissé entre la police et la
caméra. Ces attitudes et ces gestes effectués par la foule (regards en
biais, visages partiellement tournés vers la caméra, immobilisation à
distance) inaugurent la rencontre entre le cinéma et la foule sous le
signe de la suspicion. Les caméras de surveillance n’existent pas encore
à proprement parler, mais ces films esquissent doublement le potentiel
de surveillance de la prise de vue. Une première fois en permettant à la
police de manifester sa puissance d’arrestation (le captif de Chinatown). Une seconde fois, en inspirant à la foule des esquisses de gestes de camouflage. La réaction précède l’invention ;
les caméras ne servent pas encore systématiquement à surveiller
qu’elles génèrent déjà des gestes de résistance à la prise de vue.
5. Life of an American Policeman, 1905
Le cinéma des premiers temps semble, dès le départ, avoir été employé
pour servir l’image des forces de l’ordre, et travailler à un double
travail de révélation. Celle, d’une part, des individus jugés fautifs
(dans les films du « pris sur le vif » décrits par Gunning) et celle,
d’autre part, de l’action de la police, chargée du maintien de l’ordre,
c’est-à-dire de la surveillance et du châtiment des fauteurs de trouble.
Un large éventail de films nourrissent ce second volet, qui constitue
ce que l’on pourrait qualifier de parade cinématographique des
agents, illustrant l’idée selon laquelle l’exercice du pouvoir
surveillant passe d’abord par la production d’images du corps
surveillant lui-même, avant de viser des corps sous surveillance. Le
retour du photographique dans Mounted Police Charge, Policeman and Burglar et Arrest in Chinatown sert à produire des images à valeur emblématique des agents : geste stasique
des agents à cheval capables de maîtriser, dans un même mouvement, leur
monture et l’image cinématographique, portrait de l’agent tenant sa
proie immobilisée par le col comme une prise de chasse, et enfin, dans
le geste de l’agent ayant mené l’arrestation à Chinatown, séduction de
la caméra par agitation du chapeau.
Rendre l’action de la police visible et aimable : voici la première
tâche de ces autoportraits filmiques des forces de l’ordre chargés à la
fois de montrer le métier, selon une prétention réaliste, et
d’illustrer, par diverses saynètes, l’action héroïque des agents. Ainsi,
l’un des films les plus caractéristiques de la fonction portraitiste du
cinéma des premiers temps, Life of an American Policeman (Edwin S. Porter, 1905), travaille la même ambiguïté qu’Arrest of Goudie et Arrest in Chinatown :
ici encore, la mise en scène de l’action de la police capte,
accidentellement, des signes de la réticence des individus à se laisser
prendre dans le portrait cinématographique des forces de l’ordre. La
mise en scène de la police implique de représenter les rapports entre
les agents et la population qu’ils servent et, inévitablement, que cette
population déploie des gestes de résistance qui sabordent les
prétentions réalistes du portrait.
La scène a lieu au début de Life of an American Policeman. On
assiste au petit-déjeuner d’un agent, en famille, puis à sa sortie de
caserne, en même temps qu’une flopée d’agents qui se ressemblent comme
des vrais jumeaux. Life of an American Policeman dresse le portrait du policier américain « universel » : anonyme mais ancré dans l’American way of life ;
c’est un héros du quotidien. L’agent trouve, assis sur le perron d’une
rue déserte, deux enfants visiblement perdus. Il saisit le plus petit et
le porte dans ses bras, l’autre enfant suit. Plan suivant : à
l’intersection de deux rues commerçantes agitées, l’agent mène les
enfants jusqu’à l’étal d’un primeur. Il ôte son gant, pioche de quoi
nourrir les enfants, paye, le petit groupe s’éloigne de l’étal vers
l’avant-plan, sortant par la droite. Comme dans Arrest in Chinatown,
le groupe mené par l’agent est cerné par des badauds qui observent la
scène. De la même manière, le film saisit la réaction d’individus à
l’instant où ils se rendent compte qu’ils sont filmés. Ainsi, alors qu’à
l’arrière-plan, quelques observateurs restent immobiles - car
visiblement alertés de la situation de prise de vue et soucieux de
rester à distance -, un homme se trouve pris sans s’en rendre compte
sous le faisceau de la caméra. Chapeau sur la tête, il approche l’étal.
Manifestement, son attention est attirée par les fruits exposés
davantage que par le tournage. Il ne prend conscience de la présence de
la caméra qu’à l’instant où il s’en approche de très près, et, s’en
rendant compte, réagit prestement en saisissant le bord de son chapeau
afin de le rabattre et de masquer son visage, avant de disparaître par
la gauche du cadre. À côté du petit groupe mené par l’agent, une femme
voûtée, couverte par une écharpe noire, semble s’adresser à la plus âgée
des enfants récupérés par l’agent. Elle les accompagne un instant,
puis, à l’instant où son visage se trouve le plus ouvertement exposé
dans l’axe de la prise de vue, se détourne et s’éloigne, de dos.

La furtivité de ces apparitions et de ces disparitions rappelle
fortement la réaction de réticence à la prise de vue remarquée dans Arrest in Chinatown,
qui avait saisi le groupe d’individus soudain immobilisés à l’instant
où ils se savaient filmés. Ici, la prise de vue déploie un pouvoir
encore plus dissuasif que celui qui est exercé par la présence de
l’agent : c’est la détection de la caméra, et non celle de l’agent, qui
pousse la femme à se détourner et à fuir, à pas mesurés. La visibilité
reste ce « piège », selon l’expression foucaldienne, dont les premiers
sujets, au cinéma, pressentent le péril. Le rôle de la mécanique
cinématographique est ici tout sauf anodin : être vu par l’agent importe
peu, c’est être vu par un œil instrumental, mécanique, qui génère une
forme de défiance et d’inquiétude. Ainsi, ici, puisque la caméra
inquiète davantage que l’agent, s’ébauche par anticipation la future
substitution de ces agents par des dispositifs de surveillance
instrumentaux. À travers Life of an American Policeman,
l’instrument du portrait (la prise de vue) supplante le corps de métier
portraituré : c’est le regard instrumental sur la rue, plus que le
regard de l’agent, qui instaure le trouble chez les individus qui
passent dans son faisceau. La surveillance exercée par l’agent inquiète
peu ; le face-à-face avec l’objectif, lui, instaure un rapport
d’étrangeté et de méfiance qui s’avère déterminant, rétrospectivement,
quand on considère le rôle politique décisif joué par l’implantation de
caméras de vidéosurveillance depuis un demi-siècle.
Il semble que le portrait cinématographique de la police tourné dans
un cadre non entièrement complice (comme cette rue agitée) révèle, par
le détournement des regards filmés en périphérie de l’image,
l’artificialité de la mise en scène. Ce cinéma qui fait le portrait de
la police déploie aussi, simultanément, un regard qui s’apparente à un
regard surveillant : porté sur une foule anonyme, globale, qui ébauche
face à la caméra des gestes signifiant qu’elle ne participe pas à la
mise en scène, qu’elle se tient en retrait.
Que signifie pourtant cette incursion dans le réel, dans un film
largement mis en scène ? Pourquoi mêler cette représentation de l’agent
dans une foule filmée à son insu aux vignettes artificiellement
construites qui constituent la suite du film (le sauvetage d’une
suicidaire jetée dans un fleuve, le secours apporté à une cavalière
emportée par sa monture emballée) ? Il semble qu’en construisant
exclusivement son film à partir de ces tableaux minutieusement
construits, Porter aurait gardé la main sur la totalité des événements
figurant à l’écran, et que chacun de ces événements aurait contribué à
former le portrait élogieux des forces de l’ordre. Pourquoi, alors,
s’immiscer dans le réel qui foisonne d’individus qui manifestent, par
leur attitude face à la caméra, une certaine rétivité à la prise de vue,
et fissurent en quelque sorte le portrait cinématographique immaculé
des forces de l’ordre ?
Life of an American Policeman fait suite, thématiquement, à Life of an American Fireman,
tourné en 1903 par le même William S. Porter. Là où l’activité des
pompiers est filmée sur un mode aventureux, narrativement comme
diégétiquement, Life of an American Policeman prend pied dans un
cadre davantage réaliste. L’enjeu, en effet, n’est pas le même : il
s’agit de montrer les manières par lesquelles les forces de police
interviennent pour faciliter la vie quotidienne. Life of an American Policeman
est ainsi caractérisé par une certaine banalité de l’héroïsme policier.
D’où cette incursion dans le « vrai monde » figuré par le carrefour
peuplé de badauds et l’étal du marchand. Il fallait en effet faire
naviguer cet agent dans le bas-monde, dans un lieu de vie quotidienne,
et non, comme c’est le cas des autres séquences qui composent le film,
dans une situation de sauvetage spectaculaire minutieusement mise en
scène.
Or, il s’avère que ce passage dans la foule, qui devait servir à
représenter l’aisance avec laquelle le policier s’inscrit dans la vie
quotidienne de ses concitoyens, ouvre une brèche dans la représentation,
et fissure l’unité du tableau. Il n’y a pas d’immersion à
proprement parler : le corps du policier jure avec ceux qui l’entourent,
si bien qu’il paraît évident que l’agent et la foule n’appartiennent
pas au film de la même manière. L’agent est acteur : il feint l’absence
de la caméra selon l’attitude d’absorption que Michael Fried définit
comme « fiction de l’inexistence du spectateur » [32]
tandis qu’autour de lui, la foule exprime par sa retenue et ses
regards-caméra discrets qu’elle ne fait pas corps avec l’action, que sa
présence dans le film relève de l’accident, et non de la participation
volontaire. Plus encore, l’homme au chapeau et la femme voûtée à
l’écharpe fuient très littéralement dès qu’ils repèrent le dispositif.
La présence de la caméra ruine la spontanéité même de la vie qu’elle
était censée représenter, comme un effet Heisenberg appliqué à la prise
de vue : le cinéma ne peut percevoir que des comportements, des gestes
et des attitudes émis en réaction à, et non malgré, sa propre présence.
Le dispositif se heurte ici aux limites de sa prétention réaliste :
il fallait bien, pour rendre vraisemblable la fluidité de l’action de la
police dans la ville, filmer l’agent-acteur déambulant dans une rue
peuplée d’individus qui n’étaient pas complices du tournage - mettre un
pied dans le réel, en quelque sorte. Mais cette absence de complicité
saute aux yeux et trouble le portrait de la police comme rouage
essentiel de la vie quotidienne. Ces instants de résistance à la prise
de vue, éparpillés çà et là aux marges des plans, se révèlent
fondamentaux pour penser ce qui se joue, c’est-à-dire l’expression de la
valeur intrusive du dispositif de prise de vue, qui adopte, avec
quelques décennies d’avance, les fonctionnalités de l’image de
surveillance. Cette valeur intrusive est révélée par les réactions des
corps à l’écran, et par les myriades de gestes discrets qui instaurent
une réticence à la prise de vue. Le portrait de la police en action
produit, simultanément à l’image des agents, des signes de ce que la
prise de vue inspire comme résistances chez les individus filmés malgré
eux.
Il existe ainsi deux rapports à la prise de vue, dans Life of an American Policeman :
le premier est intentionnel, il lie l’agent au dispositif chargé de
dresser son portrait par l’image. Le second est accidentel et concerne
l’entrée de la foule anonyme dans le cadre de la prise de vue. Ce second
rapport se caractérise par une certaine réticence : en présence de la
caméra, la foule ne se laisse pas dépeindre facilement. La posture de
retrait dans laquelle les curieux se tiennent, comme la main tendue
comme un cache devant le visage de l’homme étourdi, enrayent le
processus qui devait enrôler la foule dans le portrait filmé de la
police. Ce que Life of an American Policeman rend finalement
visible n’est pas l’action des forces de l’ordre à proprement parler,
qui est truquée, mais la volonté de ne pas s’exposer qui saisit les
individus en présence du dispositif de prise de vue. Les individus
filmés expriment, vis-à-vis de la caméra, des comportements qui
caractérisent déjà toute situation de rencontre non-désirée avec un
dispositif de surveillance : une certaine prudence, une forme de repli
de l’apparence qui se caractérise à l’écran par des gestes de
détournement du visage, d’évitement du regard, et de maintien d’une
distance entre le dispositif de prise de vue et soi. En d’autres termes,
les bribes d’une stratégie de dissimulation de soi, d’un voilement de
l’apparence en réaction au processus de dévoilement orchestré par la
caméra.
L’exhibition de ce pouvoir trouve en effet des limites dans les
gestes et les attitudes des individus pris malgré eux dans le jeu de la
représentation cinématographique des forces de l’ordre. Quand les forces
de l’ordre font leur cinéma, le monde environnant ne leur emboîte pas
nécessairement le pas. La foule, prise pour un décor neutre, produit des
signes concurrents à la construction du portrait cinématographique
idéal des forces de l’ordre. La leçon de ces films est capitale, dans la
perspective d’une analyse des rapports de surveillance qui se font et
se défont entre les dispositifs et les individus ciblés. Ces films font
apparaître une forme de défiance à la prise de vue, qui semble plus
importante que la défiance opposée aux forces de l’ordre : se trouver
sous le regard de la caméra semble plus inquiétant que de se trouver
sous celui de l’agent. Les actualités filmées (Arrest in Chinatown) et les saynètes tournées en pleine rue (Life of an American Policeman)
ont pour effet commun de faire figurer la rencontre inaugurale entre le
cinéma et le monde, en captant les réactions d’individus se rendant
compte, pour la première ou l’une des toutes premières fois, qu’ils sont
filmés. Et cette rencontre est placée sous le signe de la méfiance, les
corps et les visages exerçant une forme de précaution instinctive à
l’égard de la prise de vue. Arrest in Chinatown comme Life of an American Policeman
permettent de saisir l’ampleur de la découverte : la mise en scène du
pouvoir surveillant de la police est d’abord une révélation du pouvoir
surveillant de la prise de vue elle-même.