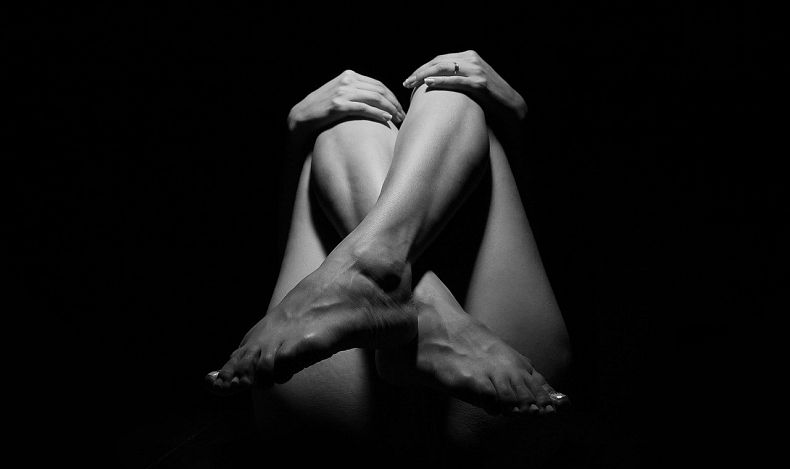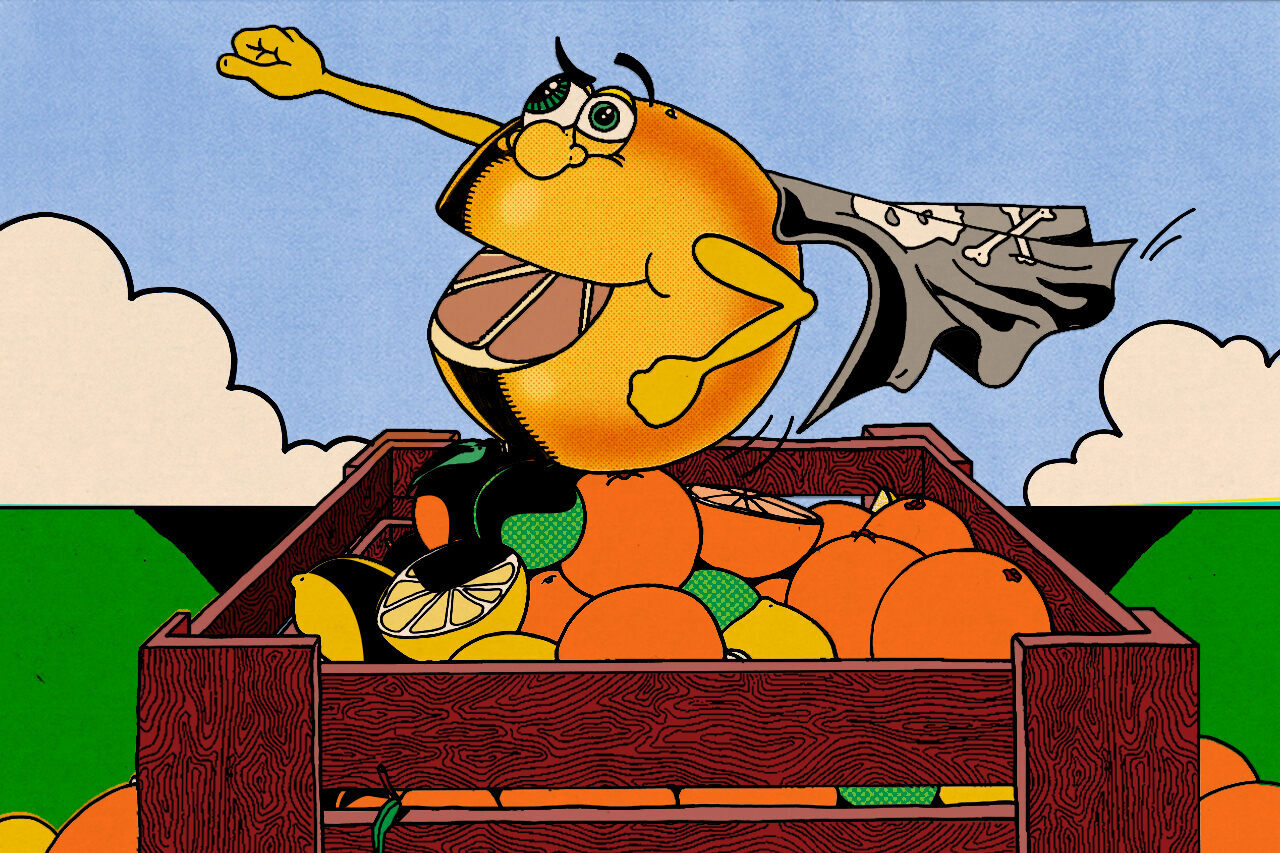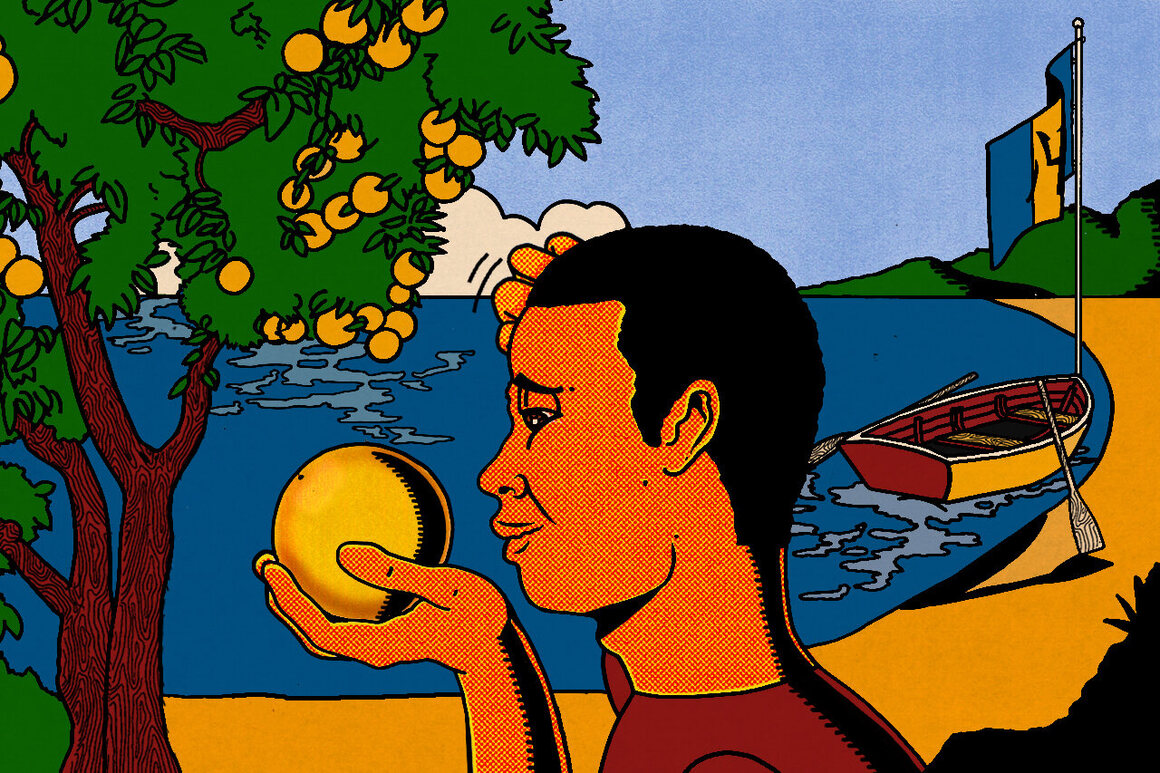À en croire S. Chiche, s’il est un enseignement à tirer de l’histoire de la psychanalyse envisagée sous l’angle de l’érotisme, c’est que l’invention de Freud ne fournit ni doctrine ni modèle à suivre.
Du souvenir d’enfance reconstitué par Freud autour de sa mère, nue dans un wagon lit, aux amours transgressives d’Anaïs Nin, Sarah Chiche balaye une série d’histoires, érotiques dans tous les sens du terme. Les protagonistes ont expérimenté autant de figures possibles de l’amour et du sexe. Tous ont un lien avec la psychanalyse, mais aucun ne s’est fié à une doctrine pour orienter ses choix.
Qu’avons-nous appris sur l’amour et la sexualité ?
« La psychanalyse enseigne-t-elle quelque chose d’inédit sur l’amour et la sexualité ? », « A-t-elle créé un nouvel érotisme ? », se demande Sarah Chiche au seuil de son Histoire érotique de la psychanalyse. On s’étonne que des questions aussi essentielles n’aient pas encore été posées de manière aussi directe. D’autant que, Sarah Chiche le rappelle, jusque dans les années 90, nombreux étaient ceux qui se représentaient l’analyse comme la voie à suivre pour accéder à plus de liberté et d’épanouissement sexuel. Cette confiance n’est plus partagée, et aujourd’hui, la question de ce qu’apporte la psychanalyse en matière d’amour et de sexualité se pose car les pratiques ont évolué, en matière d’érotisme comme en ce qui concerne les arrangements entre amour et sexualité. Devant ces changements, nombre de psychanalystes ont paru rester sur le gué, semblant campés sur des positions conservatrices sur des sujets comme l’homosexualité, la question transgenre, etc.
La chute des illusions est peut-être l’occasion de rétablir ce qu’on est réellement en droit d’attendre de la psychanalyse. S’il est un point sur lequel Freud nous a éclairés, explique Sarah Chiche, c’est sur l’étroite immixtion entre l’amour et la haine. Aimer, c’est se rendre dépendant de l’autre, c’est lui reconnaître plus d’importance qu’à soi-même, à ceci près que, pour pouvoir aimer, il faut être soi-même quelqu’un. L’abandon à l’autre est gros d’une réaction narcissique, et cette réaction, c’est la haine.
La compréhension du lien indéfectible entre amour et haine est l’apport incontestable que l’on doit reconnaître à la psychanalyse. Pour le reste, des psychanalystes, des patients, des artistes ayant côtoyé la psychanalyse se sont trouvés face à des situations auxquelles chacun a répondu en fonction de ce qu’il était. Sarah Chiche s’en remet à l’histoire, ou plutôt à une série d’histoires individuelles qui ont compté dans l’histoire de la psychanalyse. Ces récits racontent l’étendue des configurations possibles sans prétendre constituer un enseignement.
La galerie des grandes amantes de la psychanalyse
Parmi les personnages de cette Histoire érotique, certains appartiennent à la galerie des classiques de la psychanalyse : les deux patientes de Freud que furent B. Pappenheim et Dora, la maîtresse de Ferenczi (Gizella Pálos), sa fille (Elma) que l’élève de Freud voulut un temps épouser, l’amante de Jung (Sabina Spielrein), la princesse Bonaparte, Anna Freud dont les amours homosexuelles avec Dorothy Tiffany Burlingham ont gardé leur part de mystère. Sylvia, la deuxième femme de Jacques Lacan qui ne put divorcer de G. Bataille que plusieurs années après la naissance de la fille qu’elle avait eue avec Lacan, Catherine Millot, qui inspira largement à Lacan ses méditations sur l’amour mystique.
Si ces figures plus ou moins anciennes sont convoquées, c’est pour autant qu’elles peuvent parler aux amants d’aujourd’hui et qu’elles inspirent à l’auteur des réflexions contemporaines. L’affaire Spielrein/Jung que le film A Dangerous Method a popularisée est donc reprise, mais ce qui attire l’attention de Sarah Chiche, c’est la différence entre les deux femmes de Jung et entre les deux types de relations qu’il a entretenues avec chacune d’entre elles. Jung apparaît finalement comme un homme qui ne peut pas éprouver l’amour et le désir pour une même personne - comme tant d’autres. À quoi Sarah Chiche ajoute que la question retrouve son acuité et sa vérité si l’on admet que cette difficulté à aimer et désirer la même personne n’est pas le fait des hommes, comme l’a cru Freud, mais qu’elle concerne au même titre les deux sexes et/ou les deux genres.
Un monde psychanalytique plus vaste
Mais Une Histoire érotique de la psychanalyse ne se contente pas de nous promener parmi des personnages déjà visités. On y apprend beaucoup. Le lecteur connaissait-il le rôle d’inspiratrice et de mécène indirecte – et ambiguë – de la psychanalyste et traductrice Blanche Reverchon auprès du poète Pierre Jean-Jouve ? Savait-il que cette rencontre avait permis une métamorphose et un épanouissement de l’écriture du poète ? On découvre aussi comment en 1810, le Code civil a déplacé le sens du mariage. D’institution garantissant la reproduction du couple, il est devenu un pacte économique protégeant le capital familial. La question de la reproduction n’étant plus à l’ordre du jour, la fellation et la sodomie dans les foyers ont cessé d’être pénalisables. Toutes les formes de sexualité devenaient légales à partir du moment où elles associaient des adultes consentants. On comprend alors que la jeune discipline médicale a récupéré le rôle de censeur moral de ces pratiques.
Sur un tout autre plan, on découvre des soubresauts ignorés parmi les épisodes des ventes et reventes du tableau de Courbet, L’Origine du monde. On doit aussi à Sarah Chiche d’élargir l’horizon de la culture des écrits analytiques, qui ont souvent tendance à revenir sur les mêmes lieux. Jamais à notre connaissance un auteur de psychanalyse n’avait parlé jusque-là du groupe de Bloomsbury, qui réunit au début du XXe siècle Virginia Woolf, Léonard Woolf (son futur mari), l’économiste John Maynard Keynes, mais aussi Lytton Strachey, le traducteur de l’œuvre de Freud en anglais, etc. Ces créateurs de génie, adeptes de ce que l’on appellera soixante ans plus tard le « polyamour », sont portés par un idéal sur lequel la psychanalyse n’a pas grand-chose à dire. Mais pour Sarah Chiche, leur expérience correspond à ce qu’elle appelle une manière « plus vaste » d’aimer, expression importante dans l’œuvre de l’auteur des Enténébrés.
Des fausses perversions aux effets réels de l’emprise
Entre deux histoires plus ou moins publiques, Sarah Chiche glisse une évocation de l’un ou l’autre de ses patients. En matière d’imprévisibilité, ces vies privées ne le cèdent en rien aux grands récits. Elles permettent aussi à l’auteur de parler à partir de sa clinique. C’était d’autant plus important que, en tant que pratique, la psychanalyse a suscité des difficultés nouvelles pour ceux qui l’exerçaient. L’amour de transfert, Sarah Chiche le rappelle, est un vrai amour, et toute la question est de savoir quand sa transgression peut être une rencontre réelle – car cette possibilité ne peut pas être exclue – et quand elle constitue un ratage de la cure. Sarah Chiche avait consacré en 2010 un roman (L’Emprise) à la dépendance d’une patiente vis-à-vis d’un thérapeute manipulateur, et elle se montre ici très sévère avec les complaisances du monde psy. Elle rappelle le mot de Joyce Mc Dougall, qui en 2001 qualifiait d’« incestées » ces patientes séduites par leur psy alors que leur analyse les avait fait régresser.
À plusieurs reprises, Sarah Chiche s’appuiera sur cette psychanalyste trop oubliée, auteur du concept de « néosexualité ». Joyce Mc Dougall est en effet celle qui permet de penser les pratiques sexuelles sans visées reproductives et de les exclure de la sphère des perversions. Jusqu’à elle, la référence était la théorie freudienne de la « fixation de la libido », et certains Freudiens s’étaient autorisés de cet évolutionnisme pour prétendre essayer de convertir leurs patients homosexuels à l’hétérosexualité. Sur ce sujet, un certain nombre de Lacaniens s’étaient révélés eux aussi particulièrement normatifs.
Une Histoire de femmes
Les femmes occupent la place centrale de cette Histoire érotique de la psychanalyse. « Les femmes dont il est question dans ce livre brûlent d’un feu que rien ne vient éteindre », écrit Sarah Chiche dans son introduction, comme s’il allait de soi qu’une histoire érotique devait être d’abord une histoire de femmes. Le livre est paru en 2018, quelques mois après la polémique provoquée par la chronique dont S. Chiche avait été à l’initiative (« Nous revendiquons une liberté d’importuner, indispensable à la liberté sexuelle »). Sans vouloir réduire cet ouvrage foisonnant au contexte de ce débat, il est difficile de ne pas se demander ce qu’il précise de la position de l’auteur sur le mouvement Metoo.
À ceux qui s’étonnaient de la distance de Sarah Chiche par rapport aux revendications de nombreuses femmes, elle répond par un ouvrage consacré à des femmes audacieuses. Dans un temps où les hommes sont beaucoup regardés au prisme de leurs pulsions, l’impossible assouvissement sexuel est ici du côté des femmes. Une Histoire érotique de la psychanalyse plaide pour que la variété des femmes soit prise en compte et que la flamme du désir leur soit, à elles aussi, reconnue. Cette flamme apparaîtra d’autant mieux que l’on voudra bien la considérer sous toutes ses formes, y compris les plus paradoxales. Sous la plume de Sarah Chiche, un destin comme celui de la chaste B. Pappelheim est brûlant d’érotisme.
Un érotisme, un style
Chacune des femmes de cette Histoire érotique pourrait à sa façon souscrire à la déclaration de Lou Andréas-Salomé placée en exergue : « Je ne peux conformer ma vie à des modèles, ni ne pourrai jamais constituer un modèle pour qui que ce soit ; mais il est tout à fait certain en revanche que je dirigerai ma vie selon ce que je suis, advienne que pourra. » La psychanalyste explique la révélation fulgurante que cette phrase a constituée pour l’adolescente qu’elle était. Mais au-delà de l’auteur, la parole de Lou apparait comme le fil conducteur de l’ouvrage, démentant toute possibilité de transmission en matière d’amour et de sexualité. Si Une Histoire érotique de la psychanalyse a quelque chose à nous apprendre, c’est que la psychanalyse ne nous enseigne rien au sens où elle ne prescrit pas de vérité ou de norme. A chacun – et surtout à chacune - de trouver ses propres arrangements, ses propres configurations, son propre style.
Et le style de Sarah Chiche justement est de plus en plus personnel et affirmé. Les questions sont posées sans détours (« Les psychanalystes sont-ils homophobes ? ») et la « confiance radicale dans Eros » qui constitue l’éthique de la psychanalyse habite l’écriture de cette Histoire. Sarah Chiche n’est pas de ceux qui envisagent la psychanalyse comme une psychothérapie rangée. C’est pour elle une traversée à risque, qui peut achopper sur l’écueil du transfert. En même temps, la force de la foi en Eros ne doit pas nous aveugler sur cette autre éthique qui exige de tenir compte de l’effroi que peut inspirer un excès de plaisir dont l’autre ne voulait pas. L’expérience de Dora – une jeune adolescente suivie par Freud - est un traumatisme de ce type, et Sarah Chiche est aussi incisive dans la description de la manipulation collective dont la jeune fille a été l’objet qu’elle est ferme dans son plaidoyer pour la liberté d’aimer et de désirer à sa façon.
Par ce style à la fois personnel et vrai, Sarah Chiche ravive le tranchant de l’apport de la psychanalyse. Elle en décape l’enseignement sans jamais céder ni au pédantisme, ni au langage de l’entre soi. C’est dire si la lecture d'Une Histoire érotique de la psychanalyse est stimulante. Elle invite chacun – et au moins autant, chacune – à oser inventer son style après tant de femmes et d’hommes qui ont compté dans l’Histoire de la psychanalyse.