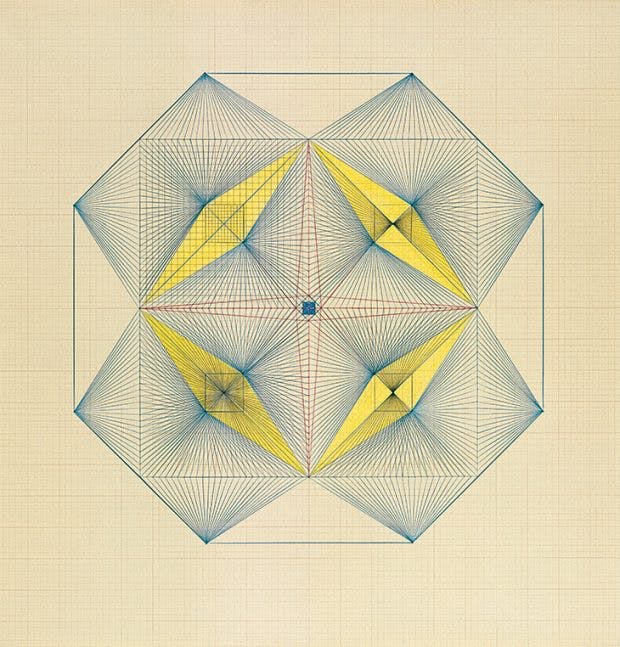Michel Foucault : Le trip dans la vallée

Michel Foucault et Michael Stoneman © David Wade
Dans le récit de voyage, Foucault en Californie, publié aux Éditions Zones, un jeune universitaire californien retrace son road-trip sous LSD avec Michel Foucault dans la Vallée de la Mort. Un portrait hallucinant qui mêle anecdotes, pensées inédites du philosophe et instantanés d’une époque.
 C’est bien lui sur la photo. Grandes lunettes de soleil à la Polnareff, crâne et sourire ultra bright, patte d’eph et éternel col roulé : Michel Foucault. Cette fois, il ne pose pas dans un bureau saturé de livres, mais bien en plein milieu de la Vallée de la mort, à côté d’un certain Michael Stoneman en mai 1975. Avec le petit ami de ce dernier, Simeon Wade, les trois hommes viennent de passer deux jours et une nuit dans le désert américain pour un trip sous LSD, qui sera « l’une des expériences les plus importantes de (la) vie » du philosophe. C’est ce qu’on appelle un beau voyage. Cette image est l’une des quatre photos exclusives qui illustrent le récit de Simeon Wade, Foucault en Californie. Bien sûr, on ne peut résister à la tentation de scruter ces clichés sur papier glacé avant même de commencer la lecture du livre.
C’est bien lui sur la photo. Grandes lunettes de soleil à la Polnareff, crâne et sourire ultra bright, patte d’eph et éternel col roulé : Michel Foucault. Cette fois, il ne pose pas dans un bureau saturé de livres, mais bien en plein milieu de la Vallée de la mort, à côté d’un certain Michael Stoneman en mai 1975. Avec le petit ami de ce dernier, Simeon Wade, les trois hommes viennent de passer deux jours et une nuit dans le désert américain pour un trip sous LSD, qui sera « l’une des expériences les plus importantes de (la) vie » du philosophe. C’est ce qu’on appelle un beau voyage. Cette image est l’une des quatre photos exclusives qui illustrent le récit de Simeon Wade, Foucault en Californie. Bien sûr, on ne peut résister à la tentation de scruter ces clichés sur papier glacé avant même de commencer la lecture du livre.
Ce voyage est d’abord un mythe, une rumeur colportée à la pause, dans les salles des profs et sur les bancs de l’université, presque une blague à laquelle on ne croit pas vraiment mais qui suscite la rêverie. Jusqu’au jour où l’on retrouve des preuves : un carnet de voyage, des photographies, quelques lettres signées de la main du maître… En 2014, c’est justement à la recherche de ces traces que se lance Heather Dundas, une doctorante de l’université de Californie du Sud après avoir entendu parler d’un manuscrit rapportant la première nuit sous LSD de Michel Foucault. Celle qui déteste le philosophe compte en profiter pour écrire une satire sur les universitaires et sur celui qui incarne pour elle « tous les privilèges et l’arrogance de la philosophie critique ». La chercheuse parvient à rencontrer l’auteur du manuscrit, un certain Simeon Wade, maître de conférences en histoire à l’université de Claremont. Après de nombreux échanges et quelques cafés au Starbucks, il lui confie le dernier exemplaire de son texte rédigé en 1990, lu et validé par Foucault lui-même, mais refusé par plusieurs éditeurs car jugé trop sulfureux. Petit à petit, Heather Dundas délaisse son projet polémiste initial pour s’intéresser véritablement au texte de l’historien et à l’expérience limite qu’il a voulu réaliser. Elle finira par signer la préface de son récit et à permettre, près de 45 ans après le voyage, la première édition de ce Foucault in California. Le texte vient de paraître en France, traduit par Gaëtan Thomas, aux Éditions Zones.
Histoire d’une initiation aux champignons
Ce voyage est d’abord un mythe, une rumeur colportée à la pause, dans les salles des profs et sur les bancs de l’université, presque une blague à laquelle on ne croit pas vraiment mais qui suscite la rêverie.
Tout commence en 1975, lorsque l’auteur des Mots et des choses est invité pour une série de conférences à Berkeley. Adulé outre-Atlantique, chacune de ses interventions fait salle comble et génère des hordes de jeunes gens prêts à tout pour l’apercevoir. Mais malgré le patte d’eph et les lunettes noires, Michel Foucault n’est pas une rock star, et reste bien embêté devant de telles scènes de liesse. Il refuse d’apparaître comme un maître à penser et prend l’habitude de s’éclipser dès qu’il le peut, ne répondant que très rarement aux sollicitations de ses admirateurs. Parmi eux, le jeune historien Simeon Wade, projette depuis des mois de rencontrer celui qu’il considère comme « le plus grand penseur de notre temps, de tous les temps peut-être » et à qui il a déjà envoyé plusieurs lettres restées sans réponse. Lorsqu’il apprend la venue de Michel Foucault en Californie, il y voit l’occasion rêvée de le faire venir dans son université, à Claremont, pour un séminaire. Il projette aussi de lui faire une toute autre proposition, une invitation pour un voyage un peu spécial dans le parc national de la Vallée de la Mort. Le but de Wade n’était pas simplement de rencontrer Michel Foucault, mais également de l’initier aux champignons psychédéliques, expérience qu’il avait lui-même vécue l’année passée avec son compagnon, le pianiste Michael Stoneman.
Contre toute attente, les deux amants parviennent à approcher le philosophe qui accepte la visite des grands espaces américains, sans se douter encore de l’ampleur du voyage. Mais le trip est lancé et le livre de Simeon Wade prend des airs de journalisme gonzo dès les premières pages, lorsqu’il énonce le but de son projet : « Telle était ma formule : premièrement, prendre le plus grand intellectuel du monde, l’homme qui avait dépassé l’idée selon laquelle « le savoir c’est du pouvoir » pour comprendre que « le pouvoir produit du savoir » ; deuxièmement, administrer à cet intellectuel un élixir céleste, une pierre philosophale digestible capable de démultiplier à l’infini la puissance cérébrale – un enchantement. Je serais l’alchimiste et documenterais l’expérience. La formule était ainsi libellée : Michel Foucault + la pierre philosophale + la vallée de la Mort (Californie) + Michael Stoneman. »
Sur la route pour la Vallée de la Mort, le couple fait part au philosophe du projet psychédélique qu’il accepte sans hésitation. Bien qu’il s’agisse de sa première prise de LSD, Michel Foucault est un habitué des drogues et notamment de l’herbe qu’il fume régulièrement avec quelques étudiants après ses cours. En chemin, il leur raconte d’ailleurs comment il reçut en contrepartie d’un débat avec Chomsky à la télévision hollandaise, un beau lingot de ce qu’il appellera le « hasch de Chomsky ».
Un intérêt philosophique ?
Une fois dissipé le plaisir de l’anecdote et jeté le coup d’œil goguenard sur les photos à la mode seventies, c’est un nouvel éclairage sur l’œuvre du philosophe que nous propose ce livre, à en croire la promesse formulée dès la préface. Selon l’auteur, il serait fort à parier que la rédaction d’une partie de L’Histoire de la sexualité ait été influencée par cette expérience sous LSD. Michel Foucault, qui continua de garder contact avec Simeon Wade et Michael Stoneman, confie dans sa correspondance avoir brûlé les tomes II et III de son Histoire de la sexualité et vouloir recommencer son « livre sur la répression du sexe » (5 octobre 1975) suite à leur excursion dans le désert. En effet, le premier tome intitulé La Volonté de savoir paraît en 1976, et ce n’est que huit ans plus tard que Michel Foucault publie L’Usage des plaisirs et Le Souci de soi, dans leur version définitive. Laps de temps qui pourrait correspondre à la période de réécriture que le philosophe décrit à ses nouveaux amis américains.
Si la lecture de ce livre frustre le plus souvent notre appétit philosophique, elle nous offre pourtant quelques précieux indices sur les réflexions du philosophe au cours du trip.
Si la lecture de ce livre frustre le plus souvent notre appétit philosophique, elle nous offre pourtant quelques précieux indices sur les réflexions du philosophe au cours du trip. C’est en ces termes que Simeon Wade rapporte les paroles de Michel Foucault : « Je suis très heureux, nous dit-il, ses yeux laissant couler des larmes. Ce soir, je suis parvenu à une perception inédite de moi-même. Je comprends maintenant ma sexualité. » Il serait tentant, bien que peu catholique, de comparer cette découverte sous substance aux pratiques du christianisme primitif, étudiées par Michel Foucault comme fondements de « l’herméneutique de soi ». En effet, entre l’examen de conscience suivi d’aveux et la confidence en pleine expérience psychédélique, il n’y a qu’un pas. Ce que Foucault recherche au cours des dernières années de sa vie, à travers les écrits des Pères de l’Eglise, est l’apparition d’une forme de subjectivité, un rapport à soi nouveau qui passe par l’expérience de la chair et qui conduit à l’élaboration d’un savoir sur soi-même. Bref, des « techniques de soi », dont il semble inaugurer l’étude au cours de cet été 1975. Se peut-il que ce trip dans la Vallée de la Mort lui ait servi d’expérience cruciale ? C’est du moins ce que l’auteur de Foucault en Californie voudrait croire.
Michel Foucault ne cherche ni à penser, ni à produire du discours, il se contente de faire une expérience et de la ressentir, pour le plus grand plaisir de ses interlocuteurs (et le nôtre)
La réponse à cette question, finalement, importe peu. Mais la force de cette scène, et le témoignage qu’en donne Foucault dans sa correspondance ranime le mythe de la révélation sous substance. Pour justifier son projet, ce « périple de l’autre côté du miroir », Simeon Wade fait d’ailleurs référence à l’usage des champignons hallucinogènes par les Grecs, les Aztèques, les Vikings et même par Saint Jean, qui aurait absorbé un ancêtre du LSD sur l’île de Patmos, avant de vivre l’expérience mystique qui lui donna la vision du livre de l’Apocalypse. Si l’on suit cette tradition, l’expérience psychédélique par absorption semble se distinguer de l’écriture sous influence. L’événement décrit dans ce récit n’est pas comparable au processus créatif halluciné bien connu de Walter Benjamin adepte du haschich, d’Henri Michaux sous mescaline ou encore des écrivains beatnik, comme Allen Ginsberg fan de LSD. Au contraire, Michel Foucault ne cherche ni à penser, ni à produire du discours, il se contente de faire une expérience et de la ressentir, pour le plus grand plaisir de ses interlocuteurs (et le nôtre) qui prennent en note quelques-unes de ses rares paroles délirantes : « Nous avons conçu l’univers – une procession majestueuse de bagatelles élégantes, un spectacle intemporel. Tout a l’air d’une vaste plaisanterie à côté de la vision qui s’offre à nous. »
Une traversée vers un ailleurs
«Je n’ai pas passé toutes ces heures à réfléchir à des concepts. Ça n’a pas été une expérience philosophique pour moi mais quelque chose d’entièrement différent. »
L’expérience du trip sous LSD est relatée comme une véritable épreuve, une traversée vers un ailleurs qui ne peut se dissocier d’une certaine mise en danger et d’une modification du sujet absorbant. Le philosophe en ressort changé, « parvenu à une perception inédite de (lui)-même ». Et c’est en ce sens que l’expérience psychédélique pourrait être considérée comme une des « techniques de soi ». C’est d’ailleurs quelques années plus tard, lors d’un séminaire à l’université du Vermont en 1982, que Michel Foucault définit son concept : « les techniques de soi, qui permettent aux individus d’effectuer, seuls ou avec l’aide d’autres, un certain nombre d’opérations sur leur corps et leur âme, leurs pensées, leurs conduites, leur mode d’être ; de se transformer afin d’atteindre un état de bonheur, de pureté, de sagesse, de perfection ou d’immortalité. » Cette attention portée à soi, ce « souci de soi » passe notamment par une pratique et la mise en place de « techniques de soi » qui se distinguent alors de l’élaboration d’une pensée philosophique, d’un savoir. Et c’est sans doute la raison pour laquelle le récit de Simeon Wade ne place pas de grands énoncés philosophiques dans la bouche de Michel Foucault. La spécificité de ce trip, si nous prenons le parti de le considérer comme une « technique de soi », est précisément qu’il échappe au discours abstrait et à toute théorie philosophique, car il s’agit tout au contraire d’un savoir éprouvé, pratiqué, qui conduit le sujet à une meilleure connaissance de soi sans pour autant faire l’objet d’un discours. Et Michel Foucault, en descente, résume le voyage ainsi : « Je n’ai pas passé toutes ces heures à réfléchir à des concepts. Ça n’a pas été une expérience philosophique pour moi mais quelque chose d’entièrement différent. » S’il est bien difficile d’admettre que la philosophie s’élabore à coup de buvards, il est pourtant intéressant de souligner la concomitance de cette expérience avec les changements observés dans la pensée du dernier Foucault et son entreprise de définition d’une herméneutique du sujet.
La portée philosophique du livre reste à être démontrée, mais le rêve de Simeon Wade se réalise. Il vit un moment privilégié avec celui qu’il admire et nous le fait partager des années plus tard. Foucault en Californie est le récit d’un voyage initiatique écrit sur le vif qui se lit comme un roman hallucinant où les dialogues tissés du tac au tac mêlent les sujets les plus prosaïques aux engagements politiques du philosophe. On plonge dans l’atmosphère de l’époque et l’on rejoint le cercle de discussion qui scelle l’amitié naissante entre les trois hommes. Le ton de l’auteur devient par moment celui d’un évangéliste dressant le portrait de celui qu’il adore encore plus parce qu’il n’est qu’un homme. « – J’aimerais que tout le monde vous voie comme une personne. / – Mais je ne suis pas une personne, répondit Foucault sèchement. / – Très bien, comme un être humain. / – C’est pire, dit Foucault en riant. »
C’est un Foucault plus intime, humble et discret que l’on découvre à travers ses pages. Refusant de se faire servir, il n’hésite pas à remonter les manches de son col roulé pour couper du bois, se contente d’un repas frugal et discute gymnastique et yoga avec ses jeunes amis autour d’une tequila sunrise. Au fil des discussions, Foucault se dévoile, devient bavard et se livre sur ses goûts en matière d’art : il préfère le cinéma au théâtre, en particulier Hitchcock, Fellini, Polanski et Antonioni, mais déteste Godard. On le découvre grand admirateur de Magritte, avec qui il a entretenu une correspondance et dont il avoue ne pas toujours avoir compris la subtilité. Il affirme ne pas aimer la littérature mais confie tout de même que Malcolm Lowry, Thomas Mann et surtout William Faulkner ont beaucoup compté pour lui. Lors d’une soirée étudiante, il n’hésite pas à souligner les limites de certains intellectuels français. Sartre est à ses yeux un philosophe « abscons » qui a manqué tout un pan de l’analyse historique du XXe. Lévi-Strauss est un « conservateur » qui ne quitte pas suffisamment son bureau pour connaître le monde. Ce name-dropping amusant se poursuit tout au long de ce court récit qui peint avant tout l’esprit d’une époque et d’une génération. Si le texte de Simeon Wade ne répond pas tout à fait à l’ambition foucaldienne du « livre-bombe », il produit tout de même un joyeux « feu d’artifice ».