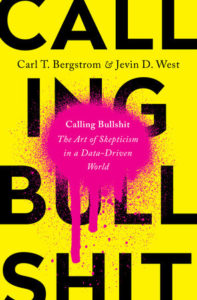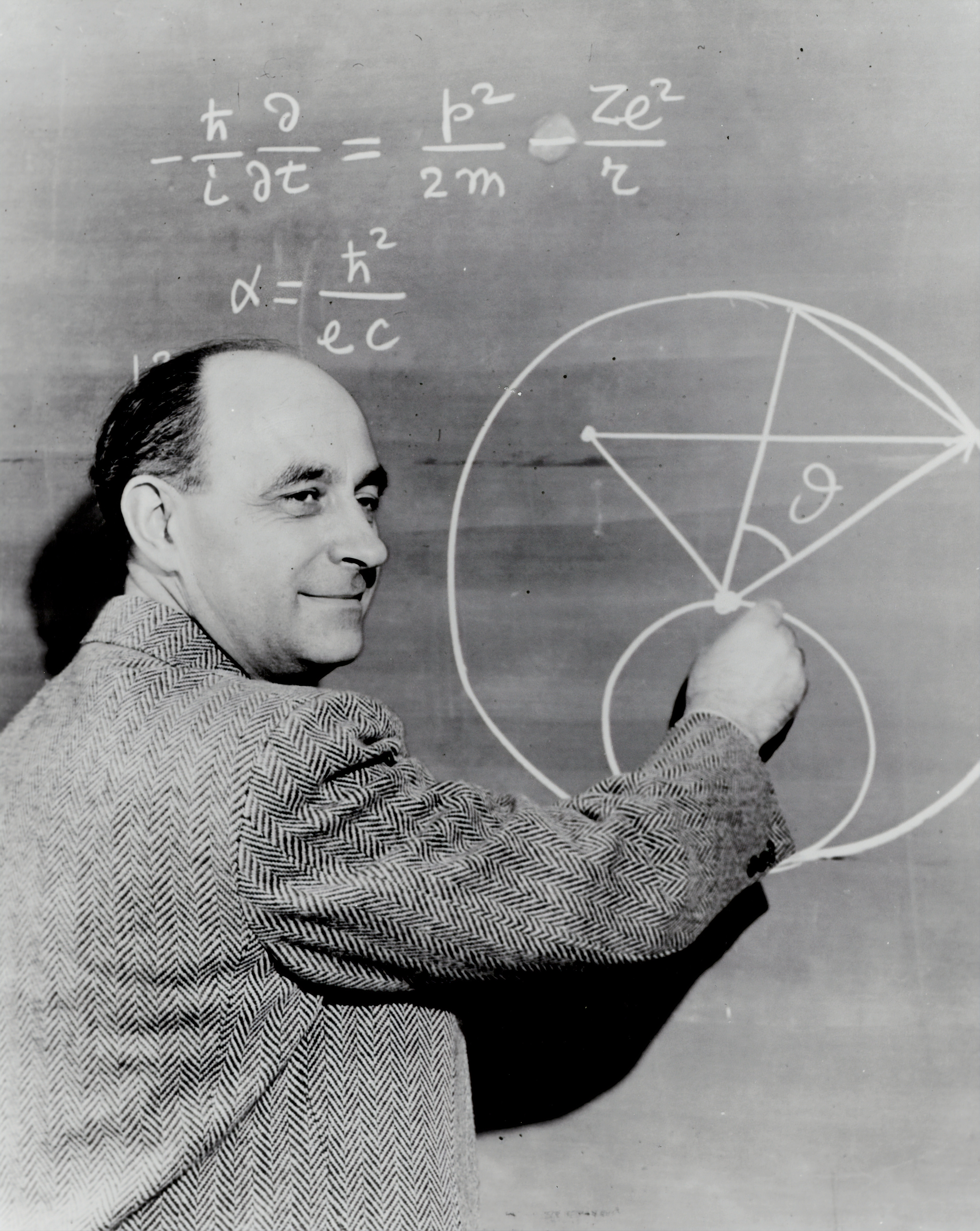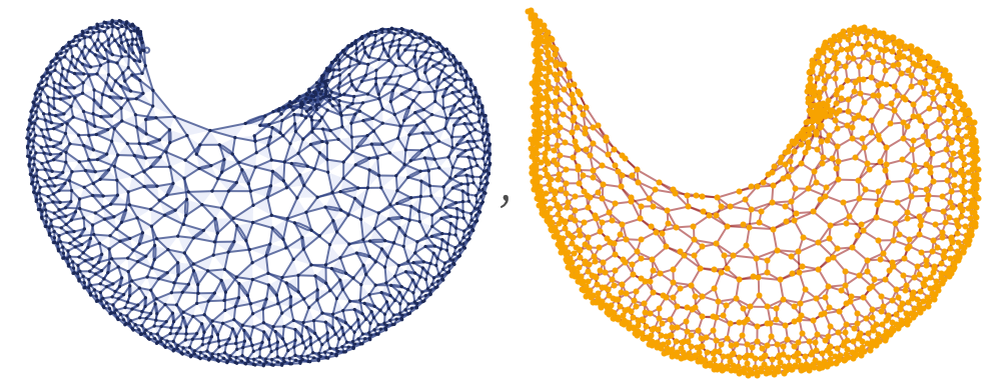| |||
|
Posted: 05 Aug 2020 06:02 AM PDT
Pa  uvres
livres de ce printemps ou parus au début du déconfinement quand tout le
monde avait bien autre chose à penser… Mais justement, penser (à) autre
chose était tellement nécessaire, au moment cette « sortie », comme une
soif en pleine chaleur. uvres
livres de ce printemps ou parus au début du déconfinement quand tout le
monde avait bien autre chose à penser… Mais justement, penser (à) autre
chose était tellement nécessaire, au moment cette « sortie », comme une
soif en pleine chaleur.Ce fut un petit livre rouge et vert, paru chez Nous, qui m’aida à me remettre dans mes propres pas : Naissance de la phrase de Jean-Christophe Bailly, l’insituable qui pourtant a l’étendue dans son œil de travail. La question du langage est depuis toujours une de ses questions : « le pari aura été de supposer à la question de l’origine des langues (et donc, de l’apparition du langage) celle de la venue en nous, des phrases que nous essayons de former ». Ceci concerne les deux textes du livre, le second étant davantage consacré, mais sur le même thème, au livre de Williams Carlos Williams et au film de Jim Jarmusch au titre éponyme Paterson.Celui qui ne parle pas encore, l’infans, a besoin d’une langue déjà formée, existante non seulement bien sûr pour communiquer mais aussi pour exister. Toutefois il nous arrive de chercher nos mots, de buter sur l’un d’entre eux, d’en oublier avant de les retrouver. « Ce que nous percevons dans des moments resserrés, si nous nous laissons entraîner, c’est l’antériorité absolue où le langage a dû puiser pour être et devenir, c’est le monde muet auquel il renvoie et d’où il provient. » Le langage avant la langue (maternelle), c’est-à-dire aussi, du silence, du non prononcé, « un frayage humain », « un écho » et un éveil du sens, tout ce qui s’est perdu en chemin qui rend si difficile l’expression de nos émotions. « Phraser (parler, écrire) », c’est chercher et écouter cette origine. Nourri des réflexions sur ce sujet de Humboldt et bien sûr de Herder et de Benveniste, Bailly réfléchit à la recherche de l’impossible justesse (quand parvenons-nous exactement à dire ce que nous pensons ou ce que nous ressentons ? Si rarement, si imparfaitement, que souvent, nous gardons le silence ou nous nous regardons, le regard étant le passage peut-être le plus proche de cette justesse recherchée… mais aussi, lorsque nous ne parvenons plus à parler (peut-être l’origine des larmes ? enfin, ceci est une pensée qui me traverse). « La conscience d’un flottement » ... (le « es schwebt » de Webern cher à Lacoue-Labarthe, vers lequel tout ce livre est tendu, adressé, ça flotte, « il » (un neutre) flotte…). Il y a toujours quelque chose « avant », quelque chose, « un pur départ du sens », « une impulsion », avant même le langage, comme une intention. On pense alors au fredon (ce qui insiste, qu’on retrouve souvent, sous le motif différent de l’obsession, chez Pascal Quignard), au chant, ce faible chant, chantonnement comme inconscient de lui-même, à demi-voix dans un moment de bonheur ou tout au contraire d’inquiétude. C’est le Singbarer Rest cher à Paul Celan (traduit par Ph. Lacoue-Labarthe par « résidu chantable »), proche du marmonnement, dans la même recherche de l’origine, le commencement si léger de la musique, peut-être. Le langage d’une certaine manière n’est que traduction, ouverture d’un monde ou du monde. En arrière-plan on retrouve la « dictée », « chant interne de la langue », ce « phraser » : essayer de faire une phrase, essayer de formuler une prononciation, qui amène à la diction. A l’origine de cette réflexion, le peuple des chasseurs cueilleurs des Tupis-Guaranis au Paraguay, étudié par Hélène Clastres. En effet chez ce peuple, le père doit concentrer toute son attention, sa pensée (penser étant d’abord être attentif) bien avant la naissance de son enfant, afin de lui ouvrir un chemin, et un seul. De sorte, dit Jean-Christophe Bailly que « l’être à venir est identifié à une phrase, et l’existence de tout être humain considérée comme un phrasé (…) ce qui est donné à l’enfant n’est pas tant le nom qu’il va porter que l’accès au langage lui-même, que ce qui lui permettra de se porter dans le monde. »Nous ne saurons jamais vraiment ce qui fut à l’origine des langues mais nous pouvons rêver ou penser à ce qui fut « ce monde dénué de noms et de verbes », (pas de grammaire, donc …) et que c’est justement celui-ci qui a « fonctionné comme le seuil même où s’est ouvert le langage. » Qu’en est-il du dessin paléolithique, alors ? Un signe, « un signe, et de sens nul » dirait Hölderlin, un pur signe, un signe avant que ne naisse l’image (autre grand champ de travail de Jean-Christophe Bailly), avant les « figures » ou les « empreintes ». Le but fragile de nommer, de l’émergence d’une phrase, de l’élaboration d’un récit. Pour clore le petit livre rouge et vert, vingt pages lumineuses sur Paterson, le livre et le film, ce film suspendu, aérien, tout entier écho des voix des passagers dans le bus, des paroles si gracieuses, du corps gracile, des gestes créatifs de la compagne de Paterson (« une femme pareille à une fleur ») le chauffeur de bus poète, le bruit de l’eau… Sur le même thème de ce qui précède : avant le poème : « quelque chose qui n’est pas nommé », et « pendant » le poème « la traversée, par le langage, d’une accalmie qui est aussi une tension ». Dans Paterson le film, il ne se passe presque rien, ce qui donne cette suspension. Il y a comme un bavardage léger et constant, auquel on ne prête qu’à moitié l’oreille, peut-être justement ce qui précède le moment où Paterson le personnage du film prend son carnet pour écrire un poème. Il s’efface pour laisser affleurer ça en lui, tout sauf de l’inattention, tout au contraire « tout un travail ». « Le langage ne produit du sens que parce qu’il est l’écho d’une sens qu’il a entendu. ». « Le sonore vient ajouter l’élongation d’une trace insaisissable où tremble le passage de la vie — soit cela même dont le poème fait son matériau le plus propre ».J’ai pensé, plusieurs fois durant le temps de la lecture de ce livre, à celui de Keith Basso, L’eau se mêle à la boue dans un bassin à ciel ouvert (Zones sensibles) qui étudie les liens entre espace et langue chez les apaches occidentaux en Arizona. Comme il est dit dans la préface de Carlo Séveri : « … un nom de lieu, en apache, est une image décrite par des mots. Il montre ensuite qu’un nom de lieu apache indique une direction du regard ». On retrouve ici, à la place du père du peuple des tupis-guaranis, celle de l’ancêtre qui n’est jamais qu’un père ancien, qui « occupant le lieu pour la première fois ce point dans l’espace, a « vu ainsi » le lieu, et l’a nommé tel qu’il le voyait ». L’ancêtre n’a donc pas seulement marqué ce lieu d’un nom prêté, pour le distinguer d’autres lieux ; il y a aussi inscrit sa propre présence invisible dans la description verbale du lieu, puisqu’il y a, pour ainsi dire, transcrit son regard. Toute personne qui passe par là se met donc à la place de l’ancêtre. La parole qu’il ou elle énonce – le nom du lieu – est celle de l’ancêtre. Celui qui voit, et qui énonce le nom, voit donc le lieu à partir de ses yeux. »On en revient au regard mais aussi à celui qui transmet, et à celui qui revient vers lui. Là-bas, pas de nom de lieu, juste la description du lieu où l’on passe, évidemment mouvante puisque le paysage peut s’éroder, changer mais en même temps reste malgré tout reconnaissable. Où ni les dates ni l’Histoire n’existent, puisqu’elles ne sont que racontées et que chacun la raconte autrement. C’est bien sûr un déplacement par rapport au propos de Jean-Christophe Bailly, mais il y reconnaîtra le parallèle et les possibles. Tout est flottant. Comme le battement d’une aile. Isabelle Baladine Howald Jean-Christophe Bailly, Naissance de la phrase, Nous, 2020, 62 p., 12€ |
|
Posted: 05 Aug 2020 05:45 AM PDT
 Les
livres de David Mus sont presque toujours associés à la marche à pied, à
l’état de qui-vive que peut procurer cette activité, état toujours
prompt à transcrire les premières proximités. Ce poète nous a habitués
dans chacun de ses livres à un vers en déploiement constant, qui s’ouvre
au jour, à l’espace entier de la page – comme une peinture en quelque
sorte –, avec des phases de répit, des saillances, des aplats si l’on
veut, et des concentrés de pensée plus ou moins alerte. Les
livres de David Mus sont presque toujours associés à la marche à pied, à
l’état de qui-vive que peut procurer cette activité, état toujours
prompt à transcrire les premières proximités. Ce poète nous a habitués
dans chacun de ses livres à un vers en déploiement constant, qui s’ouvre
au jour, à l’espace entier de la page – comme une peinture en quelque
sorte –, avec des phases de répit, des saillances, des aplats si l’on
veut, et des concentrés de pensée plus ou moins alerte.Ce nouvel opus publié à Rome chez Empiria, contribue au genre « français » des livres « sur Rome », initiés par Du Bellay, poursuivis par Stendhal ou encore Zola. On décèle comme un retour aux fondamentaux, bien que, et il est capital de le souligner, de livre en livre, ils n’aient jamais été perdus de vue chez ce poète : rendre visible et conjuguer la parole à l’expérience d’un quotidien qui n’a de cesse d’aller de l’avant. Une grande discipline est imposée dans ces 22 « Tableaux romains » et un exergue, écrits entre 2015 et 2018 ; moins d’étal, de largesse, d’amplitude dans la versification. On ne rivalise pas avec Gaspard Dughet (…) Poussin peint dans son frigo l’air humide qu’éclaire l’ampoule mais voici au fond de la sépulture de marbre des Colonna deux bergers un frais matin attendant le soleil tout neuf au bord d’un étang (…) Dans leur manière de faire affleurer une fraîcheur perçue de plusieurs siècles en arrière, une fraîcheur qui infléchit la pensée pour lui donner un rythme, une maîtrise, en même temps qu’une sérénité que seule l’expérience du temps apprend, ces Tableaux romains pourraient constituer le pendant contemporain – une cinquantaine d’années les séparent – des Tableaux d’après Brueghel de William Carlos William. Dialogue avec les représentations, les arts connexes, les saints qui inspirent, tentatives de monter en épingle la vivacité fixée dans du marbre, ou dans un tableau, dans ce que le poète (en immersion continue dans sa ville élue) aura croisé de palais, de sculptures, d’églises, sa vie durant. Tout cela, comme né d’une seule et même grande saison, qui aura mûri dans la conscience aigüe du promeneur pour lui procurer un grand bonheur de composition. Une rectitude manifeste, candeur aussi, et qui n’est rien d’autre que le résultat d’un effort de parole sans cesse dirigée vers l’évidence, à l’image même de la nouvelle ligne du métro romain « C » qui, après de multiples difficultés de construction, fréquente désormais de quelques pieds sous terre les foulées romaines du poète. Aucun interdit bien sûr, pas plus que de recommandations, à lire un poème à la lumière de son référent, ou à regarder un tableau au timbre du détournement verbal du poète, l’opération est à double sens, nous fournissant avant tout une aide pour « voir » et prendre conscience de ce qui entoure, de ce qui est bel et bien présent, dehors plutôt qu’ailleurs1 dirait David Mus, et toujours « en-avant de soi » selon André du Bouchet. A un second niveau de lecture, on pourrait envisager que ces « Tableaux romains » aient semble-t-il été écrits pour susciter des vocations. Le rythme du poème se calque par évidence sur l’essuie-glace que font les yeux qui observent chaque centimètre carré d’une toile peinte, ou pourquoi pas d’une mosaïque, sur les mouvements de la main qui palpe le stuc pour en sentir le lisse ou rugueux qui traverse les siècles. Une « école de la sagesse » devenue « école d’art », où des étudiantes « à reluquer » ont remplacées les moines. Mathieu Nuss 1 Dehors plutôt qu’ailleurs, Julien Nègre éditeur, 2016 David Mus, Tableaux romains / Quadri romani (introduction de Fabio Ciriachi), éditions Empiria (Rome), 2018, 96p., 12€
Posted: 05 Aug 2020 05:07 AM PDT
 Henri Droguet publie Grandeur nature aux éditions Rehauts. Henri Droguet publie Grandeur nature aux éditions Rehauts. TEXTO Le vent plus qu'imparfait la brise drue murmure brisure friture à lanturlus balaie des arpents d'or décroise les flots précipités rythmiques formidablement puis lassement ravage et démantèle l'hirsute hercynienne herbe de guingois les guinguettes breloques & berniques et c'est le demi-jour lingot vermillon l'incertaine clarté déjà qui s'exténue dans l'ombre perméable épaisse d'un sous-bois congestionnés barbelés barbus qui s'avancent inévitables les nuages (ouate cartilage et papier crépon) déroulent leurs fanfreluches leur histoire farouchement libre sans figures sans intrigues ni commencement ni rien qui ne finit pas il y a toujours dans le noir un orage lointain qui s'apprête à bondir désordonner tondre la mer où s'entremangent la barbue l'émissole le congre et la baudroie un gibet grince les corneilles se taisent net les ajoncs les coucous les jonquilles fleurissent le bord de l'étroit ruisseau qu'on enjambe d'un pas un pétrolier meugle dans la brume qui sent le lait le fourrage ensilé le crin des chevaux au pré un chien bleu furtif et chimère liche ses badigoinces novembre la nuit la veille au pays de papoésie déjà quelqu'un meurt de sa belle mort on se tient là encore et encore comme une poule sur un tonneau de goudron on aime — ah! les heureux soupirs et l'apaisant vertige! —on écrit à tombeau ouvert pour trouver le bon usage du silence se dé/dire et tenir la mort à distance /// PARADE La mer c'est pré gagné champ d'écailles & placenta croustillé sourcier fulgurant misérable miroir paillasse à compagnon* et gamelle aux étoiles l'énorme crépitant fossoyeur mémoriel chaudron des métaphores et route dans l'ouvert pour le partage le dénuement la besogne malgré les toujours incertains savoirs ça mûrit vaguement dans les grains les bruines les songes pour aller au fond d'un enclos un homme bleu se laboure et pleure ricane rigole et pleure Le vent épais(sement) découche roule dans l'île aux cent promesses le gratte-cul le laiteron la salicorne et le cresson un peuplier verdit l’aube confuse et laiteuse c’est (30 mai 2019) *André Frénaud Henri Droguet, Grandeur nature, éditions Rehauts, 2020, 82 pages - 16€ - sur le site de l’éditeur |